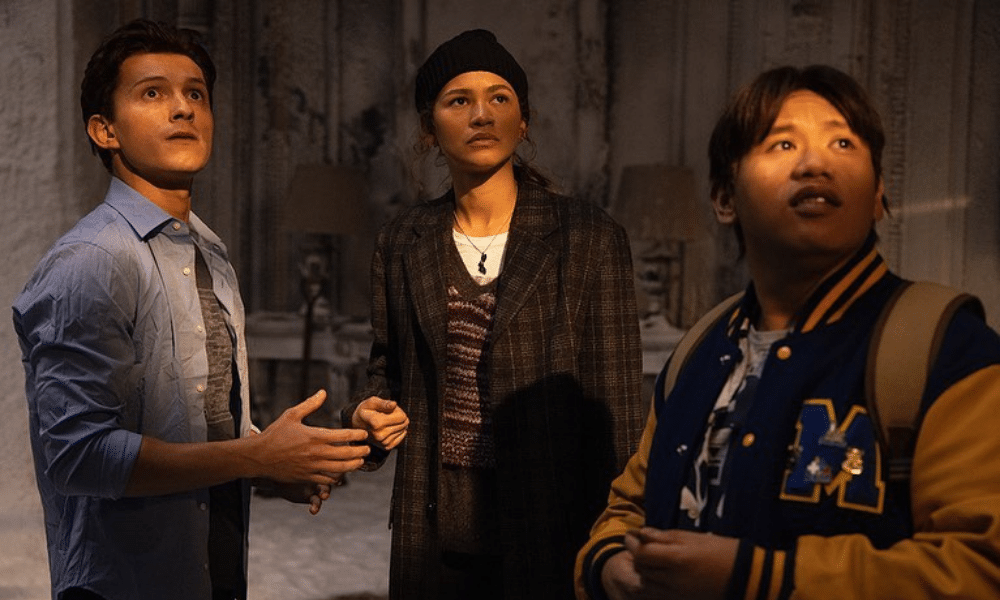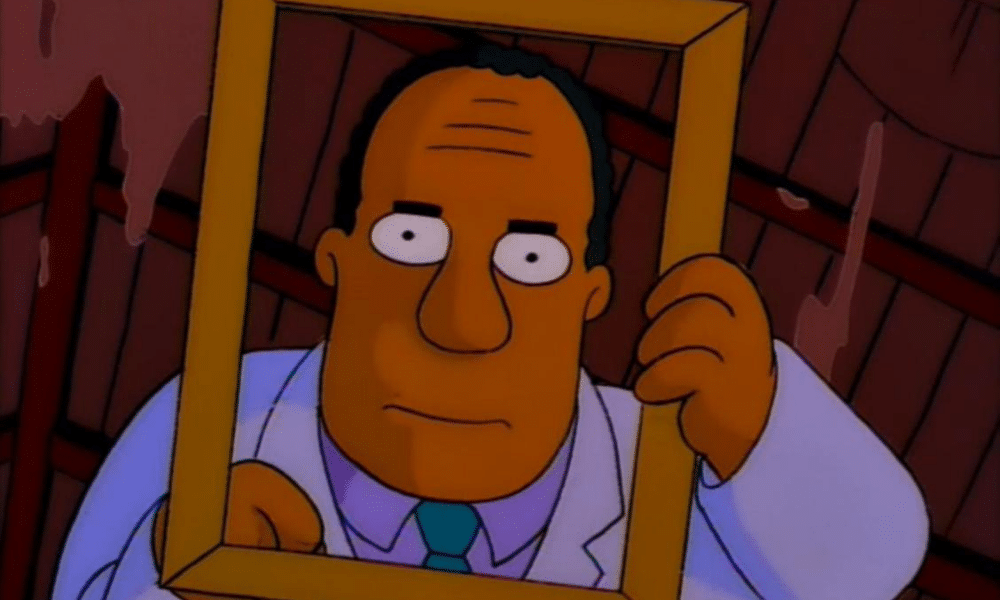À 56 ans, tout lâcher pour partir aux quatre coins du monde devient une nécessité - BLOG
CHANGER DE VIE - C’est fou comme vivre, c’est habiter. Tout autant que travailler et être parent. Il est tellement évident que l’on doit résider à un endroit précis que l’on n’y pense quasiment jamais. Idem pour le boulot. Idem pour les enfants....

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

CHANGER DE VIE - C’est fou comme vivre, c’est habiter. Tout autant que travailler et être parent. Il est tellement évident que l’on doit résider à un endroit précis que l’on n’y pense quasiment jamais. Idem pour le boulot. Idem pour les enfants. On le fait, point.
Pourtant, moi qui navigue entre Berlin (mon lieu de résidence), la France (où vit ma famille) et les USA (le pays de mon mari), je vois bien, chaque jour, que pour pouvoir construire son avenir, il faut se placer dans un lieu.
Je ne suis pas la seule à m’être posé la question récemment: “Mais par quelle galère je me retrouve là, coincée entre 4 murs, enchainée à mon ordinateur, alors qu’il fait un temps pourri?” J’ai passé une bonne part de la pandémie à me demander ce que je faisais ici.
“Mais qu’est-ce que je fais ici?”
Je suis dans la cinquantaine, je travaille sur Internet, mon conjoint aussi, tandis que mon fils étudie au loin. Berlin, c’est loin d’être la ville de mes rêves: le ciel y est plombé la moitié de l’année, les loyers explosent et les autochtones y sont moins que souriants. Je n’ai aucune raison, ni vague ni impérieuse, de rester sur place.
Vous avez envie de expliquer votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à temoignage@huffingtonpost.fr et consulter tous lestémoignages que nous avons publiés. Pour savoir comment proposer votre témoignage, suivez ce guide!
Et donc j’ai dû m’en créer. Pour moi qui suis une femme, quinqua, ça a été de forger des amitiés qui m’incitent à rester. Une amie, c’est une vraie raison de vivre. Pendant l’enfermement de la pandémie, j’ai appris à demander à des relations ou des inconnues si elles voulaient bien marcher avec moi. Une personne à la fois, chaque jour ou presque. J’ai essuyé quelques refus, quelques non-réponses. Mais la plupart ont accepté.
Et c’est ainsi que j’ai parcouru des centaines de kilomètres dans les parcs déserts, en parlant du passé, de l’avenir, des regrets, des espoirs -souvent des enfants.
Je suis toujours épatée de voir comme on peut construire les attaches fortes en y passant du temps. Beaucoup s’imaginent que c’est une histoire de circonstance, de coïncidence. Comme si trouver une amie, c’était se trouver un amoureux -un truc miraculeux qui n’arrive pas souvent, ou seulement dans la jeunesse. En réalité, c’est en multipliant les opportunités qu’on y arrive. Et plus on connaît de personnes, plus on se coule dans leur univers, moins elles nous inspirent de réticences, de craintes, de préjugés.
C’est la même chose pour le logement.
Où habiter, alors qu’a priori je suis libre comme l’air?
Quelle énergie, de s’imposer de choisir. Et donc de renoncer. Il est bien plus simple de s’installer quelque part par obligation: pour le travail, pour l’école, pour s’occuper de ses parents, pour une raison médicale. L’obligation crée le lieu, qui crée le réseau, qui crée les liens, et voilà: on y reste, et on accepte d’y rester.
Je me retrouve aujourd’hui dans une situation similaire à celle des digital nomads, cette génération de “millenials” née entre 1980 et 2000. Sans famille, ils possèdent leur entreprise sur leur laptop et naviguent entre les villes qui veulent bien les accueillir: Chang Mai (Thaïlande), Budapest (Hongrie), Buenos Aires (Argentine) ou encore Cape Town (Afrique du Sud).
Trois conditions sont nécessaires pour cette vie itinérante: causer anglais, choisir un lieu sûr, et avoir une bonne connexion Internet (quelle chance, à mon âge, et de pouvoir m’installer dans des lieux ultra-cosys, sans mégoter sur l’épaisseur du matelas).
Je m’interroge évidemment sur leurs motivations, sur mes motivations: vivre au soleil, dépenser moins, éviter les impôts, rester jeune? Est-une une façon de se boucher les yeux, de ne pas participer à l’effondrement des modèles sociaux occidentaux? Ou est-ce une nouvelle forme de colonisation irresponsable qui vampirise des ressources pas chères, ne se mêle pas à la population locale, dissémine des modes de vie prétentieux et anéantit d’autres visions de la jeunesse?
Devenir libre, un rêve pour une mère
Mais pour une mère, devenir libre de choisir de vivre où l’on veut, sans horaires, c’est quasiment inconcevable. Irréel. Forcément, on en rêve.
Car la partie la plus désagréable de la maternité, c’est précisément de se conformer à des dead lines super serrés, de découper son temps en minuscules tâches quasi anecdotiques et répétitives, qui n’en finissent jamais, mais qui créent un stress pas possible. Évidemment, au bout de plusieurs années, avec un peu d’imagination, on voit que le cumul de ces tâches mène quelque part, et c’est une grande fierté. Mais quel effort, pour les femmes un peu lunaires comme moi, qui doivent limiter continuellement l’improvisation et travailler assidûment l’organisation.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, après le départ de mon fils, une année de confinement strict et d’épuisantes restrictions, je sens l’appel de la liberté revenir au galop.
Voilà. Je rêve devant les photos de Bali (Indonésie), de Medellín (Colombie) et celles de Wellington (Nouvelle-Zélande). Ça n’est pas mon 1er coup d’essai, je suis déjà partie il y a 25 ans, seule et en sac à dos, pendant des mois, au travers de l’Asie du Sud-est… après avoir démissionné de mon (bon) boulot parisien.
Je me souviens d’ailleurs de ce couple d’ouvriers à la retraite originaire de Belgique, rencontré au hasard de mon périple, qui passait chaque année 6 mois sous le soleil tropical. À fuir la grisaille et à combattre la dépression. En deux soirées partagées autour d’un repas, ils avaient ouvert quelque chose dans ma tête, qui ne s’est jamais refermée depuis: un jour, je choisirai aussi les saisons de ma vie.
Et puis ce coup-ci, je partirai avec mon mari et nos deux jobs; il y a pire, comme situation. J’ai appris depuis toujours à combattre la solitude, je sais que je retrouverai des amies, avec qui je marcherai dans les parcs. Et que je n’oublierai pas les autres, celles qui restent à Berlin, ou ailleurs, toute l’année.
Je sais aussi que je rencontrerai d’autres couples vieillissants, qui osent mettre en œuvre un rêve de vie exotique et baladeuse. Sans forcément polluer à outrance leur pays d’accueil ni snober les habitants.
Et je sais que cette fois, le plus dur ne sera pas de convaincre mes parents de l’intérêt de ces voyages… mais de rassurer mon fils que nous reviendrons. Oui.
Enfin, probablement. Un jour.
Vous pouvez suivre Véronique Mokski sur son blog: Les Nouvelles Femmes.
À voir également sur Le HuffPost: Grâce au confinement, cette étudiante a pu monter sa propre chocolaterie

 "Loin de l'aventure fantasmée, je continue de poursuivre mes rêves en ces temps de crise sanitaire mondiale"
"Loin de l'aventure fantasmée, je continue de poursuivre mes rêves en ces temps de crise sanitaire mondiale" Le jour où elle a quitté sa vie parisienne pour le surf
Le jour où elle a quitté sa vie parisienne pour le surf