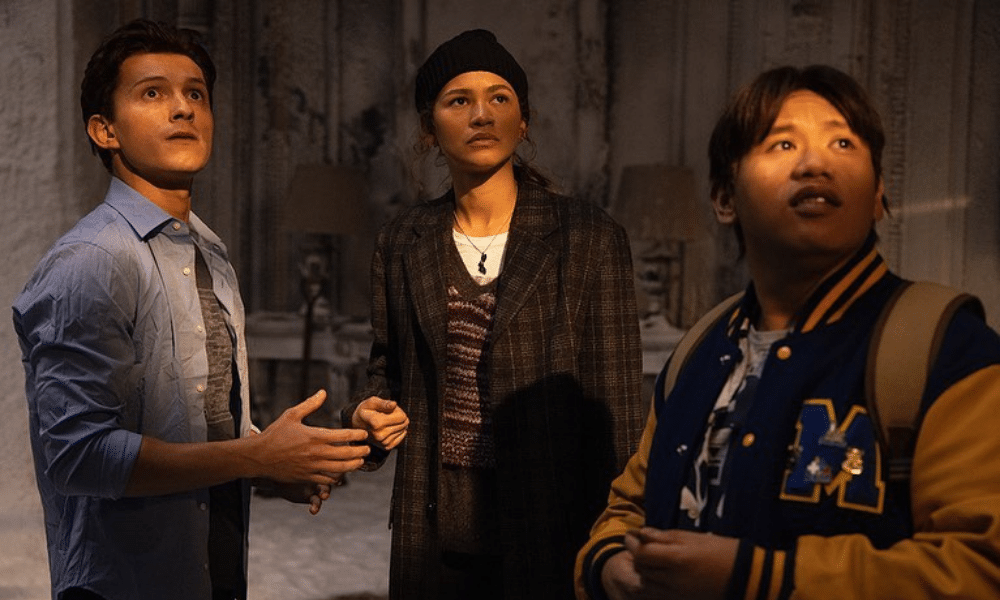Avec “Priscilla”, Sofia Coppola signe un nouveau grand film féministe
“I want a life of my own”, dit Priscilla (incarnée par Cailee Spaeny, révélation du film et justement récompensée par le prix d’interprétation à Venise) au moment où elle sent que l’étau du clan Presley se resserre sur elle. Évidemment, il...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

“I want a life of my own”, dit Priscilla (incarnée par Cailee Spaeny, révélation du film et justement récompensée par le prix d’interprétation à Venise) au moment où elle sent que l’étau du clan Presley se resserre sur elle. Évidemment, il est déjà trop tard lorsqu’elle formule ce vœu pieux. Vouloir avoir une vie à soi en tant que jeune fille tout en n’y parvenant pas est au fond le grand sujet du cinéma de Sofia Coppola. Depuis bientôt un quart de siècle, elle filme comme personne la prime féminité coincée dans des cages dorées où le confort matériel n’a d’égal que l’inconfort d’une existence cadenassée par des figures patriarcales. Ces vies-là se mesurent à l’aune des désobéissances conquises et des servitudes endurées.
Fille d’une légende du Nouvel Hollywood, la cinéaste s’est sans doute aussi posé la question à elle-même : comment avoir un cinéma à moi, au-delà des privilèges que me confère ma prestigieuse ascendance paternelle ? Le coup de génie de son œuvre est d’avoir insufflé cette dimension autobiographique à toute sa filmographie. Avoir un cinéma, ou une vie à soi, c’est d’abord – et à ce titre Sofia Coppola est dans la droite ligne de l’essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi –, pointer les ravages des entraves exercées sur les femmes.
Sofia Coppola fidèle à elle-même
L’une des grandes réussites de ce huitième long est qu’on le sent hanté par tous les autres films de la cinéaste. De Virgin Suicides, on retrouve la figure ostracisante d’un père bourgeois et strict, mais surtout soucieux de préserver l’hymen de sa fille comme s’il s’agissait de sa propriété, quitte à l’empêcher de vivre. De Marie-Antoinette subsiste l’arrachement au foyer pour en retrouver un autre où solitude et contraintes riment avec luxe et prestige : après tout, c’est bien du sobriquet de King qu’Elvis était affublé.
Au sein du clan Presley, Priscilla est elle aussi “lost in translation” et finalement une proie sans défense, esseulée par un déplacement géographique et un nouvel entourage dévoué à son mari. Dans la façon dont Sofia Coppola filme la jouissance que Priscilla éprouve dans le début de sa relation amoureuse, il y a aussi quelque chose de The Bling Ring, le sentiment euphorisant d’avoir réalisé le casse du siècle, la conquête miraculeuse du cœur le plus désiré de l’Amérique, ouvrant les portes d’une célébrité sans limite.
Une relation d’emprise
Présenté en compétition à Venise et inspiré des mémoires de Priscilla Presley, le film débute en 1959, au moment où elle rencontre Elvis (interprété par un Jacob Elordi qui roule un peu des mécaniques) alors que ce dernier effectue son service militaire en Allemagne, et se poursuit par le déménagement à Graceland, avant de se clore sur leur séparation en 1972. Des treize années qu’auront duré leur relation, Sofia Coppola parvient à la fois à expliquer l’ivresse d’un 1er amour et du sentiment grisant d’avoir été choisie par l’une des plus grandes stars du monde, mais surtout la nature abusive d’une relation d’emprise.
Outre la controverse autour de leur écart d’âge et du fait qu’elle était mineure au début de leur histoire, Priscilla filme la façon dont Elvis l’a fait tomber dans la consommation de somnifères et d’amphétamines à gogo, l’a trompée à tour de bras, l’a coupée de sa famille, lui dictait sa façon de s’habiller et de se comporter et, pour couronner le tout, la violentait à la fois verbalement et physiquement.
Désobéir au patriarcat
Dans Priscilla, il est question de contrechamps, non seulement celui à l’Elvis de Baz Luhrmann sorti l’an dernier, qui représentait les abus de l’artiste comme autant de dommages collatéraux à l’édification d’un génie lui-même victime de son impresario, mais aussi de contrechamp au spectacle et à l’artifice. L’acmé du film est le drame intime, domestique, qui se déroule loin des spotlights, égratigne le mythe de l’artiste torturé en déployant toute la toxicité.
Coppola y atteint une forme d’ascèse stylistique presque clinique. Depuis Marie-Antoinette qui les célébrait encore, les attraits du luxe n’ont cessé de perdre en éclat dans son cinéma. Dans Priscilla, le vernis est définitivement poncé. Ne subsiste que la représentation du mensonge de l’opulence matérielle. Son œuvre, qui a passionnément filmé la texture des tissus, démontre ici à quel point leur raffinement est largement inférieur à l’assujettissement qu’ils représentent lorsqu’ils sont offerts par des figures d’autorité masculines.
Le dépouillement, le renoncement à l’éclat comme procédé de désobéissance au patriarcat, telle est donc la réponse que semble avoir aujourd’hui trouvée Sofia Coppola pour poursuivre le projet d’un cinéma à soi, à l’instar de son héroïne qui finira par littéralement tourner le dos à Graceland pour peut-être, enfin, vivre sa vie.
Priscilla de Sofia Coppola (É.-U., 2023, 1 h 50), avec Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Jorja Cadence. En salle le 3 janvier.