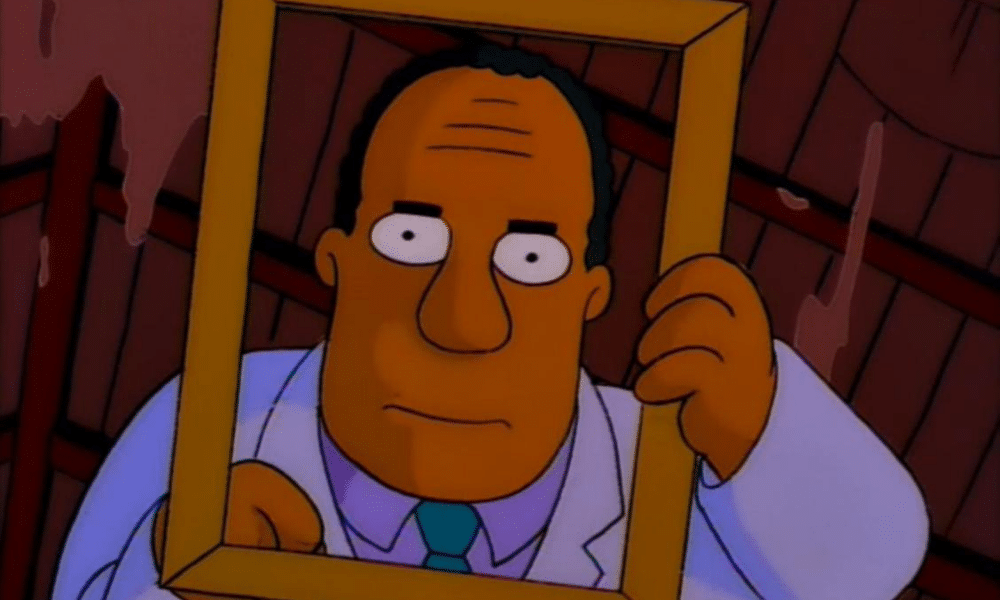Benoît Magimel : “Le cinéma, j’ai vite compris que ce serait la seule chose que je pourrais faire”
Tu as eu une très belle année, professionnellement. Tu l’as vécue comme telle ? Benoît Magimel – Oui, tout à fait. Et j’avoue qu’après les choses très positives qui ont été dites ou imprimées sur mon interprétation dans De son vivant d’Emmanuelle...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Tu as eu une très belle année, professionnellement. Tu l’as vécue comme telle ?
Benoît Magimel – Oui, tout à fait. Et j’avoue qu’après les choses très positives qui ont été dites ou imprimées sur mon interprétation dans De son vivant d’Emmanuelle Bercot, puis le César du meilleur acteur obtenu pour ce film en février dernier, je pensais que ça allait forcément retomber. Pourtant, je suis allé de bonnes surprises en bonnes surprises : l’accueil très chaleureux à Cannes de Pacifiction, le beau succès public de Revoir Paris…
Le César pour De son vivant, c’est l’accomplissement d’un trajet très difficile, puisque le film a été interrompu par un accident de santé de Catherine Deneuve, puis le confinement. Il a failli ne pas reprendre. C’est un film sauvé du chaos.
Oui, le film a traversé beaucoup d’épreuves. La 1ère étant que je n’avais pas, au départ, très envie de le faire. J’ai l’impression que les rôles qu’on vous propose sont comme des signes que la vie vous envoie. Et cette histoire d’un homme atteint d’un mal incurable me faisait flipper. Le scénario m’a bouleversé, mais ça me faisait vraiment peur, par superstition. Je savais que, pour préparer le rôle, je n’allais pas me documenter, rencontrer des gens malades, ça m’aurait paru obscène. Il fallait plutôt plonger à l’intérieur de soi pour comprendre ce qu’un tel événement produit. Et ce plongeon me faisait peur, je ne me sentais pas armé pour le faire.
J’avais 44 ans quand Emmanuelle m’a proposé le film, je songeais déjà à faire un check up, cette histoire de maladie m’angoissait. Et puis, à 44 ans, perdre plus de vingt kilos, ça nique le corps, c’est très mauvais. D’ailleurs, je n’ai pas retrouvé mon corps dans le même état de marche qu’avant le tournage. Mais j’ai quand même accepté le film. Il a été interrompu, d’abord, par l’accident de Catherine, puis par le covid. À la deuxième interruption, j’étais presque soulagé, je me suis dit qu’on n’allait pas le finir. En même temps, je pensais beaucoup à Emmanuelle Bercot, à l’enfer qu’elle traversait. Quand on a repris, en août 2020, j’avais fait le chemin, je comprenais mieux la méthode de Gabriel Sara, le médecin qui joue son propre rôle dans le film et dont la méthode consiste à dire tout le temps toute la vérité au malade… J’étais prêt pour le rôle.
Le sujet, également très sombre, de Revoir Paris (le traumatisme des attentats de novembre 2015), lui, ne te faisait pas peur ?
Le sujet du film n’est pas si sombre. Il traite de la façon dont on se répare. Il y a quelques années, j’avais tourné un film sur les forces spéciales. Je m’étais donc plongé dans des questions proches : comment vit-on après avoir tué des gens, comment on surmonte d’avoir vu certains collègues mourir… À l’époque, l’encadrement psy n’existait pas vraiment. Les mecs me racontaient que, spontanément, ils se retrouvaient. Ils avaient besoin de se revoir. En dialogue avec Alice Winocour, j’ai choisi de jouer le personnage de Revoir Paris comme si il n’avait pas été affecté, comme si il avait la force de vivre au-dessus de tout ça. C’est l’amour qui va l’aider à ne pas être dans le déni, à capituler et lâcher prise. Désormais, dans ses bras à elle, il va pouvoir guérir vraiment.
“Il n’y a d’ailleurs pas beaucoup de films qui ressemblent à Pacifiction.”
Quand on te voit dans Pacifiction, on se dit que tu n’as jamais fait quelque chose qui ressemble à ce que tu y fais. Ni que tu as déjà fait un film qui ressemble à celui-là.
Oui, c’est sans doute le cas. Il n’y a d’ailleurs pas beaucoup de films qui ressemblent à Pacifiction. Pour ma part, j’ai l’impression d’y jouer un personnage en train de faire un numéro. Un numéro d’acteur, ou de politicien, qui consiste à manipuler les gens, en manipulant des formules. Le film est très largement improvisé. Mon travail de préparation a consisté à ingérer la rhétorique des hommes politiques, pour la retrouver naturellement dans toutes situations.
On imagine que le tournage, en immersion en Polynésie française, a dû être un expérience personnelle forte ?
Ah oui, vraiment. J’ai pu mesurer l’hostilité de la population polynésienne par rapport à ce que représente la France métropolitaine. Albert (Serra), durant les mois de repérages, a rencontré beaucoup de locaux, a tissé des liens qui a permis qu’ils s’impliquent dans le film, de façon très investie. Mais bizarrement, moi qui suis arrivé après, c’est un peu comme si j’étais vraiment un haut-commissaire de l’état français [rires]. Je me souviens d’une scène où je tournais avec trois marins tahitiens, j’ai vraiment dû ramer pour les séduire et que leur méfiance tombe. Travailler avec Albert, c’est aussi très particulier. Pendant les prises, il ne regarde pas ce qu’il filme, il l’écoute au casque. Il dirige à l’oreille. Tu joues et tu le vois se balader sur le plateau, sans te regarder. Au début, c’est déconcertant. Moi, ça m’a plu. Je m’y suis fait très vite. Et j’aime beaucoup le climat du film, son esthétisme.
As-tu traversé des moments d’inconfort durant le tournage ?
Ma peur était d’avoir l’air d’être l’acteur au milieu de non-acteurs. C’est toujours un très grand danger de faire l’acteur face au naturel déconcertant d’un non-professionnel. Et en même temps, ça ne sert à rien d’essayer de jouer naturel. C’est un peu perdu d’avance, car ça ne s’imite pas. Ma préoccupation était de ne jamais être ennuyeux, de faire tout le temps quelque chose d’un peu inattendu.
Il y a peu de films où on a autant le sentiment de te voir. Sur l’écran, on voit à égalité ton personnage et toi, en train d’en tirer les ficelles et de t’amuser en le faisant.
J’ai du mal à m’en rendre compte. Mais c’est sûr que le film est différent de ce que j’ai fait jusqu’à maintenant, ne serait-ce que parce qu’il n’y avait pas de texte. Juste une grande arche qui évoluait au fil du tournage et où on avait une très grande liberté pour développer ce qu’on voulait. J’aimerais beaucoup faire un film avec cette méthode. Mais je crois quand même que ça ne marche que si le personnage, comme celui de De Roller (le nom de son personnage dans le film, ndlr), est un spectacle.
Dans la scène où tu franchis en jet-ski une vague géante, tu te sentais en danger ou tout était préparé pour que tu te sentes en sécurité ?
Le sauveteur qui conduisait l’engin était vraiment un mec d’expérience. Je me souviens que, quand je suis monté derrière lui, j’ai eu le réflexe de dire en montrant la côte : “Elle est pas belle notre île ?”, en me souvenant d’un politicien en campagne qui disait lors d’un reportage, “Elle est pas belle notre ville ?”. De la pure langue de bois ! [rires]. Puis j’ai vu cette vague arriver… de nous sentir monter puis redescendre… mais j’avais confiance en ce conducteur. Je savais qu’il savait le faire.
“Chabrol me poussait toujours à aller plus loin”
S’il y a dans ta carrière quelque chose qui s’approche de ce que tu fais dans Pacifiction, c’est peut-être ta collaboration avec Claude Chabrol. Notamment La Fille coupée en deux, où l’ironie, l’amusement à jouer un personnage au bord du ridicule, était visible à l’écran.
Ah oui, c’est très vrai. Justement, quand j’ai rencontré Quentin Dupieux pour Incroyable mais vrai, il m’a aussi parlé de La Fille coupée en deux, de la façon très désinvolte, très lâchée, dont je jouais ce jeune aristocrate. D’ailleurs, Quentin Dupieux partage avec Chabrol un sens très sûr pour pousser le curseur un peu loin, mais en s’arrêtant avant la caricature.
Tu as tourné trois films avec Chabrol. Il a compté pour toi ?
Beaucoup, oui. Sa mort a été une grande tristesse. Je pensais qu’il était parti pour tourner jusqu’à cent ans. J’ai été très gratifié qu’il fasse appel à moi, parce que je connais ses films depuis que j’étais gamin, qu’il incarnait une image un peu mythique du cinéaste français. Je n’ai pas pu faire le 1er film qu’il m’a proposé. Mais il m’a quand même proposé le suivant. Puis le suivant. Puis encore le suivant. J’avais le sentiment qu’on aurait pu en faire encore et encore. On s’amusait beaucoup ensemble. Il me poussait toujours à aller plus loin, à prendre le risque d’en faire trop, du ridicule. Il m’a dit une fois : “Tu sais, moi j’ai monté Othello avec Roger Hanin qui jouait avec l’accent pied noir. Il ne faut avoir peur de rien” [rires].
Justement, l’énorme bashing sur Marseille, la série Netflix où tu joues avec l’accent marseillais, ça t’a atteint ?
Non, franchement pas du tout ! Sur aucun film que j’ai tourné, je n’ai eu autant de retours de spectateurs. La série a été vue dans le monde entier. C’est la 1ère production française de Netflix. Tous les rouages n’étaient peut-être pas encore au point. On a effectivement beaucoup moqué les accents. Mais je suis content d’avoir fait cette série. Ne serait-ce que parce qu’elle m’a permis de jouer pour la 1ère fois avec Gérard Depardieu. Quand j’avais une quinzaine d’années, on m’avait proposé de jouer le petit ami de Marie Gillain dans Mon père, ce héros, de Gérard Lauzier. Mais je n’avais aucune envie de me retrouver face à Depardieu dans un rôle par très intéressant de petit copain un peu baltringue. Je me suis dit qu’une meilleure occasion se présenterait. Le tournage long d’une série était en fait l’occasion idéale de passer beaucoup de temps avec lui et j’ai adoré.
Tu as un peu arpenté tous les territoires du cinéma français, du film d’auteur au blockbuster national, d’Emmanuel Finkiel (La Douleur) à Cédric Jimenez (La French), de Rebecca Zlotowski (Une fille facile) à Guillaume Canet (Les Petits mouchoirs)…
Oui, j’ai envie de tous ces territoires. J’ai toujours eu envie d’une carrière la plus large possible, en alternant des films plus grand public et des films très risqués. Par exemple, faire La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq, c’est vraiment un pari. On se demande, en le faisant, si ça va être très mauvais, ou plutôt un objet d’art un peu particulier, qui, dans le temps, trouvera son public. En tout cas, c’est amusant de prendre le risque. Tu parlais d’Emmanuel Finkiel et de son adaptation de Duras, La Douleur. En effet, c’est un réalisateur qui m’a beaucoup impressionné.
Ta performance dans La Douleur est également assez impressionnante, très puissante.
Je pense avoir trouvé le personnage par son poids. L’idée était d’être hyper massif, lourd. C’est un homme qui, pendant l’occupation, continue à bien manger et il fallait que ça se voit. C’est un personnage de collabo, mais il fallait le représenter de façon suffisamment délicate et nuancée pour qu’il soit aussi un peu touchant. On m’a d’ailleurs proposé beaucoup de rôles de salauds attachants à la suite de ce personnage.
“Ce qui, parfois, me chagrine, c’est l’impression que le cinéma est peut être moins central qu’autrefois.”
Tu fais ce métier depuis l’âge de douze ans et La Vie est un long fleuve tranquille. Traverses-tu des moments de fatigue de ton métier ?
Oui, ça m’arrive. Notamment quand des films auxquels je crois ne marchent pas. Ce qui, parfois, me chagrine, c’est l’impression que le cinéma est peut être moins central qu’autrefois. Il y a tellement de chaînes, tellement de plateformes… Les films, et donc les acteurs qui les interprètent, ont perdu de leur aura. Il y a toujours des films qui font événement, mais on peut se perdre dans une telle profusion de propositions.
En ce moment, tu tournes beaucoup. As-tu peur, parfois, du burn-out ?
Depuis 2017, je n’ai pas arrêté. J’ai tourné 19 films en cinq ans. C’est vrai que j’aimerais bien ralentir, maintenant. Prendre un moment pour moi. J’ai envie d’écrire. J’aimerais bien réaliser. Je ne sais pas encore vraiment ce que j’ai envie de expliquer, mais je sais que j’ai envie de mettre en scène, de diriger des acteurs, de fabriquer un film avec une équipe.
Et dans ton métier d’acteur, il y a-t-il des choses que tu n’as pas encore accomplies et qui restent un objectif ?
J’aimerais bien tourner un western. C’est un genre qui m’a tellement fait rêver quand j’étais môme…
Qui est ton acteur de western préféré ? John Wayne ? Clint Eastwood ?
J’en aime beaucoup. Même Elvis Presley, je l’adore dans le western qu’il a tourné. J’aime à la fois le western de l’âge classique, tous les John Ford, Rio Bravo de Hawks, et le western moderne, Leone, Peckinpah… Avec peut-être une préférence pour Peckinpah. Il a vraiment apporté quelque chose de très neuf au genre. Butch Cassidy et le Kid, avec la présence de Bob Dylan, c’est vraiment génial. Eastwood a été très loin aussi dans la démystification. Chez Peckinpah, Eastwood, les hommes de l’ouest sont vraiment des hommes, pas des héros. Il n’y a plus de rituel du duel ; si tu peux tirer dans le dos de ton ennemi, tu le fais. Il y a une noirceur, un pessimisme, une façon de montrer la peur, qui fait bifurquer le genre.
C’est pas gagné, non, pour un acteur français de trouver un rôle dans un western hollywoodien ?
Alain Delon a tourné un western avec Toshirō Mifune qui s’appelle Soleil Rouge. Et puis, il y a La Fayette. La France a envoyé beaucoup de soldats français à l’époque aux États-Unis… Ça peut se trouver… [rires].
Tu as commencé à travailler à 12 ans. Tu es devenu père à 24. Beaucoup de choses te sont arrivées un peu précocément. Tu as pu en souffrir ?
Non, je ne crois pas. J’étais assez tôt très débrouillard. J’ai arrêté l’école à 15 ans. J’avais assez confiance. Mon agent me disait de faire attention, que la carrière de pas mal d’acteurs enfants s’arrêtait avant l’âge de vingt ans. Le cinéma, quand j’y ai goûté, j’ai vite compris que ce serait la seule chose que je pourrais faire. Mais j’ai mis du temps avant de pouvoir le dire. Maintenant, je l’assume. Je pense qu’il y a une fée sur mon berceau [rires].
Est-ce que tu dirais que ton 1er rôle, celui de Momo dans La Vie est un long fleuve tranquille, te ressemble finalement beaucoup. Un garçon qui peut passer des Groseille aux Le Quesnoy sans souci, qui saura toujours s’adapter …
Complètement. Dans le film de Chatiliez, il y a déjà tout. Le grand écart entre d’où on vient et où on va. Momo arrive chez les Le Quesnoy et, en cinq minutes, il trouve comment se comporter. Quand j’étais plus jeune, je me suis souvent trouvé dans des situations où j’avais pas les codes, où j’avais vraiment des complexes, mais je crois que j’ai toujours su donner le change. C’est un truc de bon sens. Et aussi de survie.
Pacifiction d’Albert Serra, avec Benoît Magimel, en salles.











![Un Si Grand Soleil en avance : résumé de l’épisode du mardi 5 janvier 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img1.acsta.net/newsv7/21/01/04/15/10/3565824.jpg?#)
![Demain nous appartient : ce qui vous attend dans l'épisode 844 du mercredi 20 janvier 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img4.acsta.net/newsv7/21/01/19/15/02/0057746.jpg?#)

![Demain nous appartient : ce qui vous attend dans l'épisode 845 du jeudi 21 janvier 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img3.acsta.net/newsv7/21/01/20/16/01/0143226.jpg?#)