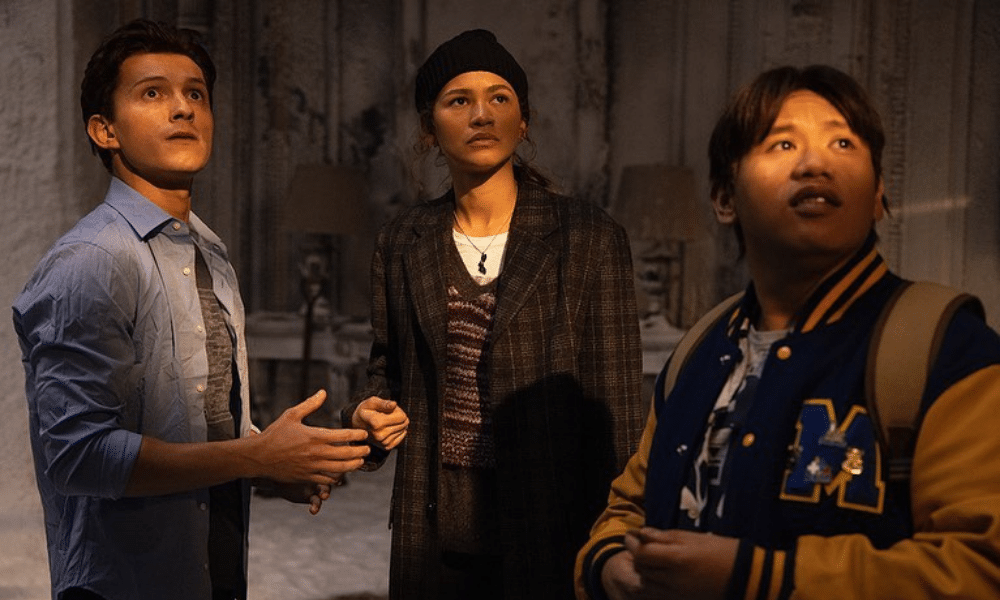Cannes, Jonathan Glazer et dissonance cognitive
Dans les files d’attente, en plein jour devant les salles comme dans les fêtes et les clubs au cœur de la nuit, lors d’une pause clope entre deux remixes d’eurodance 90’, tous·tes les festivalier·ères ne causent que de ça : que penser de The...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Dans les files d’attente, en plein jour devant les salles comme dans les fêtes et les clubs au cœur de la nuit, lors d’une pause clope entre deux remixes d’eurodance 90’, tous·tes les festivalier·ères ne causent que de ça : que penser de The Zone of Interest de Jonathan Glazer ? L’aimer est-il vraiment possible ? Le film est vraiment tout sauf aimable. Mais ne pas penser incessamment dans les 24 heures qui suivent sa projection n’est définitivement pas possible.
Le film restitue le quotidien de la famille d’un commandant SS responsable d’Auschwitz, dont le logement de fonction est adossé au camp. Le film inscrit l’horreur absolue dans les recoins des plans : des enfants aryen·nes jouent dans une piscine tandis que derrière elles et eux s’élève un nuage de fumée ; une mère de famille vaque à ses occupations domestiques dans son salon, tandis qu’à travers la fenêtre on aperçoit un mirador ; sur la vitre de la chambre de la grand-mère se reflètent dans la nuit de gigantesques flammes…
Folie métonymique
Le film semble atteint d’une folie métonymique, rejetant à la périphérie ce qui est essentiel, privilégiant l’anodin sur le monstrueux, et l’effet d’effroi que produit ce tramage de l’horreur dans la plus plate quotidienneté qui l’a rendu possible est d’une puissance émotionnelle sidérante. L’élaboration formelle du film – avec sa netteté effrayante (très courtes focales qui ne laissent aucune zone de flou, texture numérique de l’image d’une précision presque surréelle, comme si le film voyait plus que ce qu’un œil humain peut voir), son dispositif de vidéo-surveillance où la caméra se campe à certains emplacements indifféremment des déplacements des personnage – est également inouïe. Pour camper la machinerie de mort nazie, Glazer met au point une machinerie formelle folle. Et il parvient à éviter le risque de la tautologie par des décrochages brutaux (une scène en négatif entre conte et hallucination, un flashforward saisissant sur Auschwitz aujourd’hui).
La force du film tient pour beaucoup à l’écho qu’il trouve dans notre époque. Que se passe-t-il aujourd’hui sous nos yeux qu’on voit et qu’on ne voit pas ? Qu’est-ce qui est là, en train de brûler, et qui ne nous empêche pas de continuer à vivre comme si rien ne se passait ? Oui, décidément, nous sommes toutes et tous en situation de dissonance cognitive.
Édito initialement paru dans la newsletter spécial Cannes du 20 mai. Pour vous abonner gratuitement aux newsletters des Inrocks, c’est ici !












![La Faute à Rousseau : les premières images de la série avec Samira Lachhab (Demain nous appartient) et Charlie Dupont [EXCLU]](http://fr.web.img1.acsta.net/newsv7/21/01/26/16/52/2969008.jpg?#)