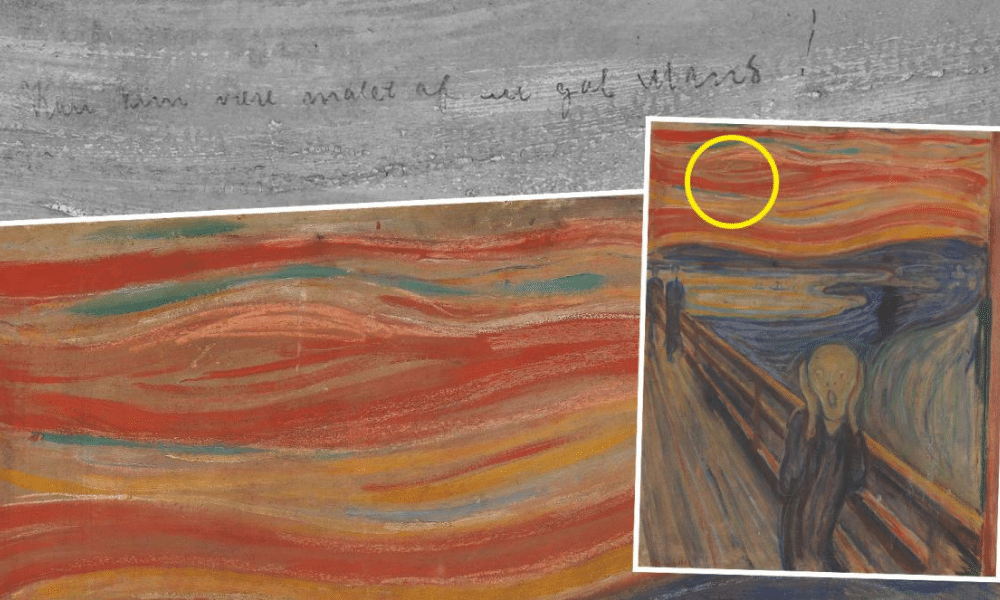“Chungking Express” ou la consécration pop de Wong Kar-wai
Nous sommes à Hong Kong, en 1994, Wong Kar-wai a 36 ans. Son nom n’évoque pas encore grand chose ailleurs dans le monde, où ses films n’ont pas été diffusés (excepté une sélection de son 1er long, As Tears Go By, à la Semaine de la critique...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Nous sommes à Hong Kong, en 1994, Wong Kar-wai a 36 ans. Son nom n’évoque pas encore grand chose ailleurs dans le monde, où ses films n’ont pas été diffusés (excepté une sélection de son 1er long, As Tears Go By, à la Semaine de la critique de 1989 – non convertie en distribution). Pourtant, à domicile, il a déjà eu le temps de connaître non seulement la saveur exaltante du succès (Nos années sauvages, son second long, a triomphé aux Hong Kong Film Awards), mais aussi aussi celle, plus aigre, d’un début de chute : Les Cendres du Temps, le “wu xia pian” pharaonique qui était censé marquer son adoubement en tant que jeune auteur prometteur, s’enlise. Le tournage de cette superproduction issue du genre roi du film de sabre s’éternise, multiplie les avaries et interruptions, et le budget a totalement explosé. Pour se sortir des sables mouvants de son magnum opus, WKW entreprend un projet indépendant à l’occasion d’une pause de deux mois. Il s’agit d’un film fauché, contemporain, libre, instinctif – tout ce que Les Cendres du temps ne sont pas – : Chungking Express.
Qu’est-ce que c’est, Chungking Express ? D’abord un lieu : Tsim Sha Tsui, le quartier hongkongais où a grandi l’auteur, un endroit propice aux fictions (brassage d’Occidentaux et d’Asiatiques, forte criminalité…) mais aussi à une approche incroyablement kaléidoscopique de l’espace, avec ses boutiques et ses appartements comme concassés les uns à l’intérieur des autres, confondant horizontalité et verticalité, percés par des voies et des travées qui semblent presque passer au beau milieu des habitations . Exemple : le Mid-Levels Escalator, le plus long trottoir roulant du monde et décor central du film passant sous la fenêtre de l’appartement de Tony Leung.
>> A lire. aussi : Wong Kar-wai, une révolution
On est pratiquement chez Michael Mann
A l’intérieur, forcément, tout se mélange aussi, les genres, les rencontres et surtout les histoires : deux fois la même, en vérité, à savoir celle d’un flic en chagrin d’amour qui rencontre une nouvelle fille. Le 1er, qui vient de se faire larguer et trompe son malheur en s’inventant d’étranges règles de vie (acheter des boîtes d’ananas qui périment en mai, “parce que May aimait les ananas”), tombe sur une mystérieuse bandite en perruque blonde et lunettes rouges (à qui il donne au passage sa théorie sur les trois seules raisons de porter des lunettes de soleil la nuit : être aveugle, se la jouer ou cacher ses larmes – drôle d’aveu de la part de WKW qui ne quitte jamais les siennes). C’est la partie polar léger du film, qui s’amuse avec des archétypes néo-noirs comme on joue à se déguiser, non sans infuser paradoxalement tout son sens du tragique amoureux et de la mélancolie urbaine – saxo en reverbe sur l’aurore hongkongaise bleutée : on est pratiquement chez Michael Mann.
Le second acte, porté par l’égérie wongienne Tony Leung Chiu-wai, suit un fil plus romcom : un nouveau flic, une nouvelle fille, mais un principe d’approche et de séduction beaucoup plus espiègle, incarné par l’irrésistible malice de Faye Wong et ses stratagèmes amoureux (chiper les clés de son crush pour nettoyer et redécorer en secret son appartement de garçon à la dérive). Avec sa coupe à la garçonne, l’actrice a donné un visage à la légende du film : quiconque veut en raviver le souvenir ne pense qu’à elle, accroupie dans l’escalator ou dodelinant de la tête derrière la caisse de son snack.
Un Rubik’s cube en mouvement permanent
Il n’y a en tout et pour tout que quatre personnages dans Chungking Express, et pourtant, c’est comme s’il y en avait cent ; il fait inexplicablement l’effet d’un grand film choral, une fresque urbaine peuplée de cœurs brisés, ultra séduisants bien que quasi fous, tous aux prises avec d’inquiétants comportements borderline et obsessionnels liés à la nourriture (les boîtes d’ananas), aux objets (Tony Leung console son mobilier après s’être fait larguer : “Elle est partie, c’est comme ça…”), à la musique (California Dreamin’ de The Mamas & The Papas, en boucle et à volume max dans les oreilles de Faye Wong).
Cet effet de démultiplication, ce sentiment de grand brassage des êtres, des objets et des formes peuplant une ville, doit aussi beaucoup au chef-opérateur Christopher Doyle, l’autre plus grand collaborateur de Wong Kar-wai, qui prête d’ailleurs au décor son propre appartement de Chungking Mansions. De tout le film, il n’y a peut-être pas un seul plan avec moins de quatre couleurs dominantes, comme un Mondrian en mouvement permanent, ou un Rubik’s cube, sur lequel viennent élégamment s’apposer les moirures et les striures des vêtements – haut rayé pour Faye Wong, chemise de bûcheron pour Tony Leung.
>> A lire aussi : En 1997, Wong Kar-wai s’interrogeait déjà sur le futur de Hong Kong
Film-jukebox
C’est un film qui ne explique rien qui n’ait déjà été raconté mille fois auparavant ou mille autres fois depuis – des histoires d’amour, de perte et de retrouvailles, que le long métrage se désintéresse même en partie de boucler. Et pourtant, c’est indéniablement le film de la “révolution Wong Kar-wai” (titre d’un gros coffret DVD rouge que l’on trouve dans toutes les étagères cinéphiles qui se respectent), celui par lequel il a conquis la cinéphilie mondiale, avec une triomphale diffusion à l’étranger rapidement convertie en sélection cannoise (pour Happy Together en 1997), avant la consécration d’In The Mood for Love et de 2046.
Une “patte” WKW s’incarne ici, peut-être même ici comme nulle part ailleurs dans son œuvre : un fétichisme particulier des lumières urbaines, des néons, des flous de mouvements, des cœurs solitaires perdus dans les entrailles de la ville. C’est avec Chungking que Wong s’installe dans la famille élargie des grands stylistes pop du cinéma international des 90’s, comme Tarantino (l’affiche américaine précède le titre d’un “Quentin Tarantino Presents” : c’est avec ce film que le cinéaste fraichement palmé commence son autre grande carrière, celle de prescripteur) ou Gus Van Sant (qui débauchera d’ailleurs Christopher Doyle), avec un esprit de film-jukebox taillé pour les hybridations et les citations.
Du jazz orchestral de Dinah Washington (What A Difference A Day Makes) au reggae de Dennis Brown (Things in Life) en passant bien sûr par California Dreamin’ (autre écho tarantinien : impossible en revoyant le film aujourd’hui de ne pas penser à la reprise du morceau par José Feliciano dans la plus belle séquence de Once Upon a Time in Hollywood), la playlist du film semble conçue pour entêter, parce que les morceaux sont des tubes sublimes, et parce qu’ils passent tous au moins trois fois. Il en va de même des motifs visuels : la mode, les clips, le cinéma des années suivantes ressasseront les fétiches de Chungking. Son influence se sent encore aujourd’hui, revendiquée directement notamment par Barry Jenkins, qui reconnait en Wong Kar-wai sa plus grande inspiration.
‘Yasuke’ Trailer: LaKeith Stanfield to Voice First African Samurai in Netflix Anime Series










![Un Si Grand Soleil en avance : résumé de l’épisode du vendredi 8 janvier 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img2.acsta.net/newsv7/21/01/06/15/48/2736399.jpg?#)