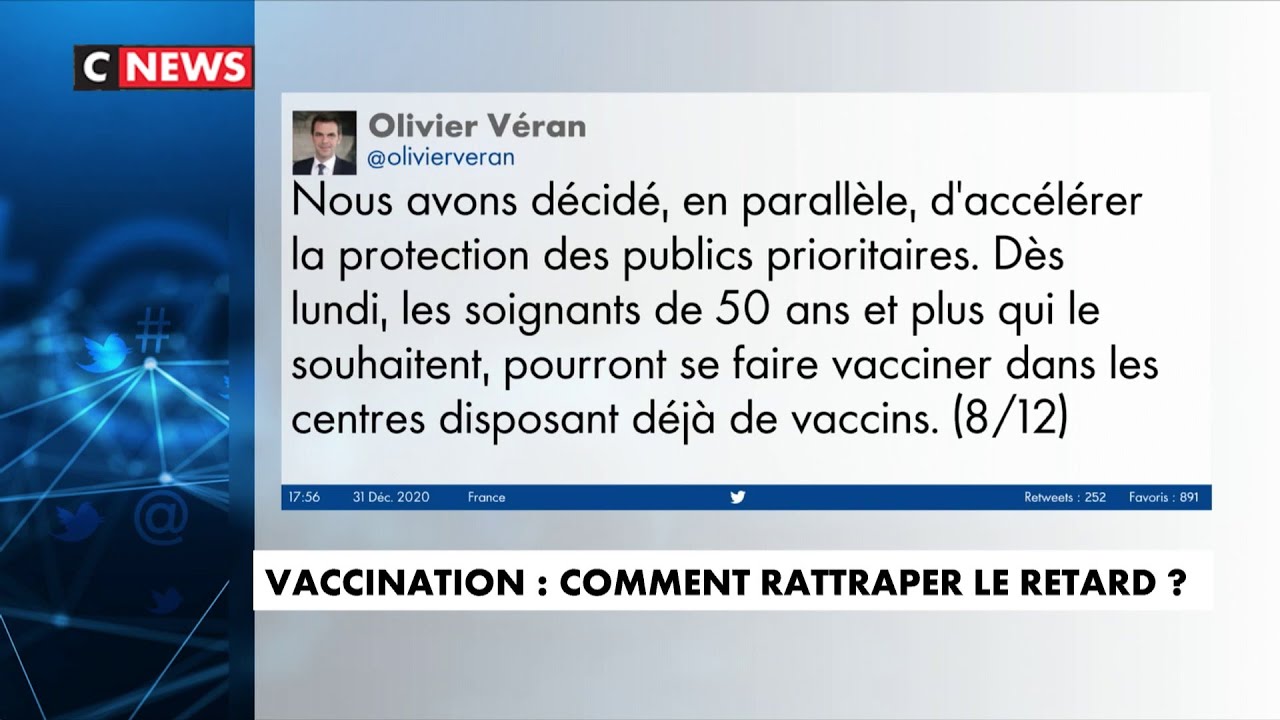Cola Boyy : “Je veux être la voix et le reflet des combats du quotidien en musique”
Coproduction du label Record Makers et celui lancé par MGMT, Prosthetic Boombox signe le 1er essai discographique de Cola Boyy. Avec son casting cinq étoiles (The Avalanches, Andrew VanWyngarden de MGMT, Myd, Nicolas Godin…) et son storytelling...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Coproduction du label Record Makers et celui lancé par MGMT, Prosthetic Boombox signe le 1er essai discographique de Cola Boyy. Avec son casting cinq étoiles (The Avalanches, Andrew VanWyngarden de MGMT, Myd, Nicolas Godin…) et son storytelling à toute épreuve (Matthew Urango, de son vrai nom, souffre d’une malformation de la colonne vertébrale et a été amputé d’une jambe à l’âge de deux ans), l’album voit le musicien américain se payer un rayonnant hymne à l’estime de soi, qu’il couple avec une grande justesse à son activisme politique.
L’occasion, donc, de revenir avec lui sur le statut d’artiste-militant, de causer matérialisme et marxisme, de son rapport à l’industrie de la musique et à la France.
On explique que c’est le label parisien Record Makers qui a découvert ton compte SoundCloud il y a quelques années. Tu viens de faire paraître ton 1er album solo, Prosthetic Boombox. Quelle est ta relation à la France et à sa capitale ?
Cola Boyy – J’avais passé plusieurs années à jouer dans d’autres groupes avant ça [El Mariachi et Sea Lions, ndlr] alors j’étais déjà venu à Paris une fois avant ma rencontre avec Record Makers… Mais depuis cinq ans que je suis signé sur le label, c’est vrai que je viens beaucoup plus, à raison d’au moins quatre fois par an. Ça fait du bien, je me sens un peu ici comme dans une maison secondaire. J’ai rencontré beaucoup de gens depuis le temps, je me suis fait des amis et des collègues, c’est un peu comme une autre famille pour moi.
Tu es attentif à ce qu’il se passe sur la scène française en général ?
Dans la mesure où j’en fais désormais plus ou moins partie, forcément ! Je n’y connaissais pas grand-chose avant de signer chez Record Makers, mais depuis, je me suis mis à rencontrer du monde et à écouter beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Il y a quelque chose de fantastique en France sur les rapports des artistes entre eux, le réseau… Chaque mois, j’ai l’impression de découvrir un nouveau producteur génial et à portée de main.
J’imagine que c’est ainsi que tu as rencontré Myd, Nicolas Godin et Pierre Rousseau, ou encore Infinite Bisous, tous basés à Paris et présents au générique de ton disque. Ça s’est passé de la même manière pour The Avalanches et MGMT, avec qui tu ouvres et clôtures respectivement l’album ?
Pas vraiment, j’avais des amis communs avec Andrew [VanWyngarden, moitié de MGMT, ndlr], mais il a fini par tomber de lui-même sur mon compte Instagram, puis sur SoundCloud. À partir de là, on est entrés en contact et il m’a proposé de venir en tournée avec MGMT, donc ça s’est fait de manière assez naturelle… Pour The Avalanches, c’est assez drôle, car je me rappelle avoir joint leur manager pour leur demander de mixer mon 1er EP. On m’avait répondu qu’ils n’étaient pas disponibles, alors j’avais laissé tomber et ce sont finalement eux qui, bien plus tard, m’ont envoyé un message sur Instagram : “Salut Matthew, on adore ton travail, ça te dirait de nous rencontrer et de chanter sur notre album ?” C’était surréaliste au début, mais j’ai bien sûr accepté. Ils m’ont envoyé cinq démos et j’ai choisi celle de We Go On. En deux, trois jours, j’avais écrit mon couplet, je leur ai envoyé et ils étaient directement satisfaits. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a été question d’inviter Mick Jones [guitariste des Clash, aussi présent sur le morceau, ndlr] sur le titre : un truc de fou, j’ai encore du mal à réaliser tellement j’étais fan des Clash en grandissant.
>> À lire aussi : Myd, le loser magnifique prêt à enflammer nos soirées d’été
Tu expliques souvent avoir grandi avec le punk, dans une scène très éclectique. Comment es-tu arrivé vers la soul, le disco et le funk ?
Je pense simplement que ce sont aussi des styles avec lesquels j’ai grandi, que mes parents écoutaient. Et c’est aussi une part des cultures noire et latino dont je suis issu que j’ai voulu mobiliser, quand je me suis lancé dans mon projet solo à 22 ou 23 ans. Comme on faisait de l’indie pop avec les groupes où je jouais, je sentais le besoin de conjuguer l’idée d’une carrière solo avec une musique plus personnelle. Alors je me suis dirigé naturellement vers le funk, sans savoir en jouer du tout, mais en voulant juste faire de mon mieux. Je pense que cette décision venait aussi du fait que bien que des artistes comme Dâm-Funk existent, j’avais le sentiment que ce n’était pas le style qu’on entendait le plus, et je voulais essayer quelque chose de nouveau.
Justement, pour en revenir à la France, on a le sentiment que le revival de ces styles musicaux (la néo-soul par exemple, mais on peut même remonter au disco avec Daft Punk et aux inspirations de la French Touch) est très majoritairement porté par des groupes d’artistes blanc·hes. Non pas qu’on devrait interdire à qui que ce soit de faire telle ou telle musique selon sa couleur de peau, mais le fait que presque aucune personne non-blanche ne bénéficie de cet héritage de musique noire ne peut-il pas être dérangeant ?
C’est un point intéressant, j’imagine que démographiquement beaucoup d’artistes de couleur se tournent aujourd’hui davantage vers le hip-hop, le rap ou le r’n’b… Je pense que c’est plutôt une question de culture que de musique. La culture repose aujourd’hui sur des bases économiques, dans la façon dont elle répond à des problèmes systémiques et se dissémine à un moment donné ou non dans une population plus large – en l’occurrence, celle des Blancs. En fait, ce n’est pas un constat étonnant, dans la mesure où c’est la trajectoire d’un grand nombre de cultures. À mes yeux, ça met surtout en exergue le rôle du capitalisme dans cette circulation des cultures et ce système d’influences, ça ne sert pas à grand-chose de s’arrêter au constat “des Blancs qui jouent de la musique noire”.
On y arrive inévitablement : tu te revendiques communiste, mais tu es aussi militant, engagé auprès des travailleur·euses de ton Oxnard natale. Comment fais-tu coexister ces statuts avec ta position d’artiste ?
C’est simple : tout art est politique. Si tu essayes de dépolitiser ce que tu fais, tu vas juste te retrouver avec quelque chose qui sert les intérêts des bourgeois par défaut, puisqu’ils ont imposé leurs standards dans le mode de production artistique. Alors je me demande constamment comment rendre service aux gens avec ma musique : l’idée est de proposer un reflet de leur vie et de leurs galères en incitant à l’optimisme, la rébellion et la défense des droits. Mais je choisis de ne pas le faire d’une façon vulgaire, je ne suis pas là pour scander “révolution, révolution, révolution !” parce que je pense que ça ne cause pas à grand monde. Au contraire, je suis partisan de m’intéresser à ce qui constitue la vie de tous les jours, de causer des galères quotidiennes : je pense que faire résonner ce genre de choses dans ma musique est aussi une façon de gagner la confiance d’un public, et donc le meilleur moyen par la suite de causer de révolution… C’est ce que j’ai toujours en tête quand je compose, et dans la mesure où l’industrie de la musique est régie par les règles du capitalisme, je pense que c’est ce que je peux proposer de mieux avec mon art : être la voix et le reflet de ces combats du quotidien en musique.
>> A lire aussi : Irmin Schmidt : “Jimi Hendrix, c’est la raison pour laquelle j’ai fondé CAN”
Et c’est possible de maintenir cette démarche à une heure ou beaucoup d’artistes voient leurs propos être dépolitisés, où on reproche à d’autres la superficialité de leur engagement ?
Je n’ai pas de problème à te dire tout ce que je viens de te expliquer. En fait, la plupart des journalistes m’interroge là-dessus en entrevue. Et c’est drôle parce que parfois, je me sens frustré de ne causer que de ça, alors je finis par balancer :”ce serait cool qu’on cause plus de musique” [rires]. Ce que je regrette, c’est que j’ai le sentiment que certaines personnes ne comprennent pas que ma musique et mon activisme sont intrinsèquement mêlés, et que causer de ma musique est inévitablement une façon de causer de politique. Car même si j’évite d’être trop in-your-face là-dessus, je le conçois toujours de manière consciente. Ce n’est pas quelque chose de pervers : l’enjeu est d’apprendre à manipuler ce discours de sorte à ce qu’il apparaisse quand on ne veut pas le voir et disparaisse quand on s’y intéresse trop.
Sur le fond, comment gères-tu le degré de radicalité de ton message ?
C’est une question de dosage : ça m’arrive de me demander si je n’en mets pas trop dans une chanson ou si j’en cause de la bonne façon… Parce que je ne veux pas me retrouver dans une niche, à n’être écouté que par des gauchistes – du moins ceux qui passent leur vie à dérouler à quel point ils sont de gauche. Je veux que ma musique cause au plus grand nombre, car c’est le meilleur moyen d’unifier les gens. Ma démarche serait vaine si j’essayais simplement de prêcher des convaincus, au risque même de ne pas être assez radical pour certains…
Cet ancrage militant que porte ta musique se retrouve aussi dans les influences musicales que tu mobilises. Je pense notamment à ton single Kid Born In Space, d’orientation afrofuturiste, qui n’est pas un courant anodin à invoquer…
Je pense que c’est dans l’entre-deux, une décision qui vient autant du fait que je calcule ce à quoi ma musique doit ressembler que je me laisse de la liberté… C’est aussi important : si je m’arrache parfois les cheveux sur mon message, ma seule obsession est aussi souvent de me demander “Ok, comment je peux rendre ça catchy as hell ?” [rires]
Est-ce que tu penses que ton propos peut toucher tout le monde ?
Je pense que la compréhension des combats qui ne nous concernent pas est limitée, mais s’en tenir à dire “tu ne peux pas comprendre ce que je vis” est tout aussi vain que le constat en lui-même… “D’accord, mais qu’est-ce que tu veux que j’y fasse ?” En dehors de ça, il y a bien des choses qui lient les gens entre eux de toute façon, comme notre rapport au travail, à l’argent… Alors autant y revenir quand on n’arrive pas à faire de pont plutôt que de tout compartimenter. Sinon à ce rythme, en tant que Noir, latino et handicapé, c’est sûr que mon message ne va pas toucher grand monde ! Et on pourrait encore creuser pour trouver des particularités, mais ce n’est justement pas quelque chose dans lequel je veux rentrer. Si on ne se concentre que là-dessus, les choses n’avanceront jamais. À mes yeux, quiconque écoute ma musique est une petite victoire.