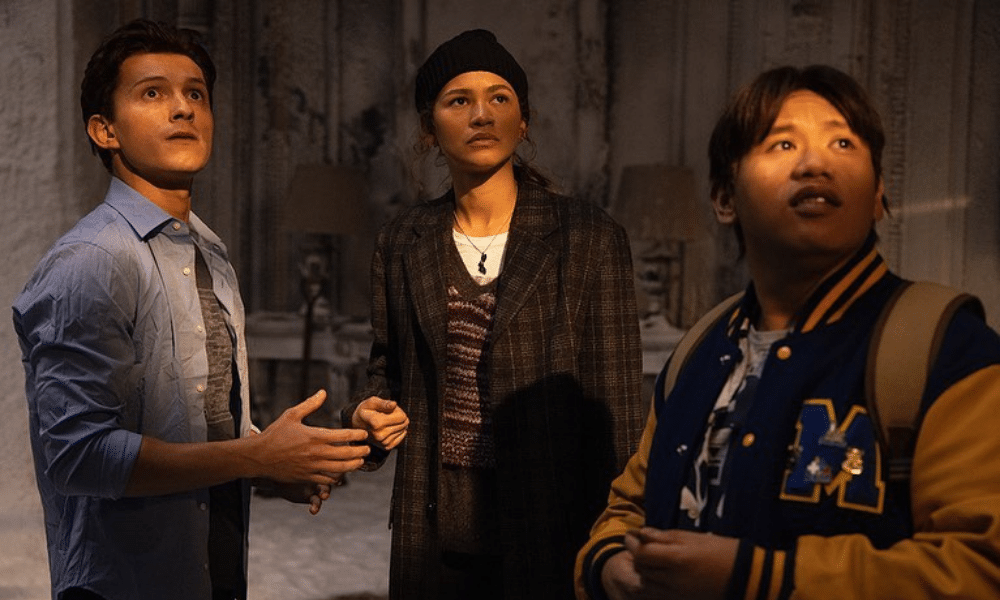“Il était une fois à Hollywood”: le roman d’un paradis en expansion
Si Tarantino n’était pas tenu par ses producteurs ou son éditeur, par l’exigence d’un format raisonnable, force est de constater qu’Il était une fois à Hollywood n’en finirait plus de se prolonger, de se tourner et de s’écrire. C’est ce qui...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Si Tarantino n’était pas tenu par ses producteurs ou son éditeur, par l’exigence d’un format raisonnable, force est de constater qu’Il était une fois à Hollywood n’en finirait plus de se prolonger, de se tourner et de s’écrire. C’est ce qui explique sans doute la fascination suscitée par le film : l’intuition qu’il s’agit-là plus que d’un simple objet culturel délimité, mais d’un monde en expansion qui déploie ses tentacules sous d’innombrables formes : bande originale, projet de série, version rallongée de dix minutes, rumeur d’une version de 4 h, scènes coupées, surgissement de nouvelles scènes coupées, commentaires ininterrompus des fans qui, à leur tour, prolongent le geste… C’est l’immense beauté du film que d’être ce rêve éveillé duquel on ne voudrait jamais sortir.
À ce titre, la novellisation vient prolonger le rêve. Mais il faut clarifier un point, que ne fait pas la version française empaquetée comme un roman (alors que l’américaine est pensée comme un véritable objet surgi du passé) : Il était une fois à Hollywood est moins un objet littéraire que cinématographique, un travail sur la mémoire du film dont les scènes s’étalent en surimpression durant toute la lecture. En entrevue, Tarantino évoque d’ailleurs son refus d’écrire de manière “littéraire”, et de fait, sa prose reste cantonnée à un style sous-littéraire, façon novellisation d’époque, rédigée à l’arrache par un écrivassier effroyablement véloce et sympathique. Autrement dit, voici l’œuvre infra-littéraire d’un cinéaste archi-conscient, maladivement cultivé, bavard et analytique, qui tente de courir après la possibilité d’un geste innocent, profane.
>> À lire aussi : “Once Upon a Time in Hollywood” : un Tarantino virtuose et tordu
Tout le plaisir de la lecture est alors dans cette sophistication qui trouve à l’intérieur de ses propres ressources une forme de virginité. En témoigne cette structure faite de chapitres autonomes où l’on sent le simple et pur plaisir de expliquer : le déclin d’Aldo Ray, un épisode télé, la Manson family, le passé de Cliff Booth ou plus simplement une banale journée de tournage. Tarantino prend son temps, s’attarde, s’allège de la mission de devoir faire converger son récit vers une conclusion ou un dénouement. Le cinéaste se rêve tout à la fois : sociologue, historien, cinéphile, mais d’abord et avant tout, enfant obsessionnel qui nous ouvre son coffre à jouets et trouve dans l’écriture un moyen de soulager son cerveau de tout ce name-dropping patiemment accumulé – cette érudition qui fait office, chez lui, de rapport sensible au monde.
Un monde regardé à hauteur d’enfant
Par rapport au film, le roman opère de nombreux déplacements passionnants et radicalise un peu plus le geste qui consiste à décrire les moindres détails d’un paradis. Un paradis qu’il faut absolument protéger du malheur. Le texte refuse encore un peu plus la dramatisation (la fin est radicalement différente), obéissant au programme inscrit dans son titre : le “once upon a time“ figure l’éthique d’un cinéaste qui veut que rien n’arrive de grave à ses chers personnages – seul moyen pour que cet univers atteigne à une forme d’éternité. Ainsi, Rick Dalton, assailli par son sentiment du déclin, dépassé par une nouvelle génération d’acteurs, n’est pas sauvé par son passage du divertissement au cinéma, mais par le soutien de l’inoubliable Trudi Fraser, l’enfant-actrice zélée. À travers elle, se dit l’humble et bouleversante morale du roman : qu’il est noble, digne et ardu de expliquer des histoires à des millions de gens, même si ce n’est que pour les divertir. L’importance que prend la petite actrice, véritable ange gardien, donne la clé de l’œuvre qui, du film au roman, est un monde regardé à hauteur d’enfant. Et si l’on en doute encore, un autre passage nous le confirme : lorsqu’un musicien demande à Rick Dalton un autographe pour son fils, “le petit Quentin”.
Se dessine en creux, un geste warholien, une sorte d’ode à toutes les manifestations du profane : magazines, émissions radio, séries télévisées, publicités, marque de nourriture pour chiens, acteurs de seconde zone, romans de pacotille. Il était une fois à Hollywood se veut le conte hypermnésique d’une sous-culture qui ne s’agit jamais d’ennoblir (Dalton rate son passage au cinéma “artistique”, Tarantino ne fait pas de littérature), mais d’aimer pour elle-même. Comme un enfant ne peut s’empêcher d’aimer son enfance et, plus tard, le souvenir qu’il en garde : du visage d’un figurant à la télé à la texture d’une après-midi californienne.
Il était une fois à Hollywood (Fayard) de Quentin Tarantino, 416 p., 23 €