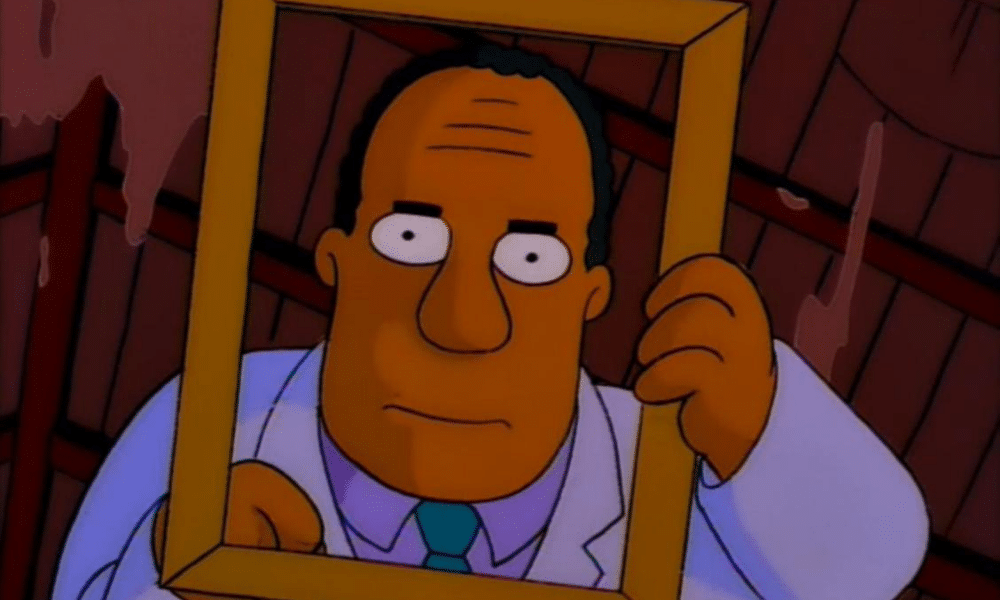Irmin Schmidt : “Jimi Hendrix, c’est la raison pour laquelle j’ai fondé CAN”
Les plus jeunes pourront fanfaronner en se rappelant du temps où Damo Suzuki jouait avec les Parisiens de Yeti Lane à l’Espace B et dire à leurs gosses impassibles qu’ils y étaient, il y aura toujours dans les parages un vieux briscard pour...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Les plus jeunes pourront fanfaronner en se rappelant du temps où Damo Suzuki jouait avec les Parisiens de Yeti Lane à l’Espace B et dire à leurs gosses impassibles qu’ils y étaient, il y aura toujours dans les parages un vieux briscard pour vous rappeler qu’il tapait du pied au 1er rang du concert de CAN en 1973 au Bataclan.
Fondé en 1968 par deux disciples du compositeur allemand Karlheinz Stockhausen (Holger Czukay et Irmin Schmidt), le guitariste Michael Karoli et le métronome Jaki Liebezeit, la formation de Cologne continue d’être citée par les anciens autant que par une jeune garde intrépide, toujours prompte à passer I Want More en soirée et à répéter à qui veut bien l’entendre que Kanye West a repris Sing Swan Song (1972) sur son tube de 2007 Drunk and Hot Girls.
>> A lire aussi : Rencontre avec Irmin Schmidt (CAN) : “Ma musique est pleine de ma mémoire”
Si les albums du groupe sont trouvables chez votre disquaire le plus proche (ainsi que sur les plateformes de streaming), il est en revanche plus difficile de se procurer des enregistrements live de bonne qualité, malgré la profusion de bootlegs et de bandes pirates qui traînent ci et là. Outre un best-of live paru en 2011 (Live 1971-1977), CAN ne documentait pas, jusqu’à aujourd’hui, ses performances scéniques. Voilà qui est chose faite, avec ce Live in Stuttgart 1975, fruit d’un énorme travail de tri et mise à niveau, et 1er disque d’une série que l’on espère très longue.
Entretien avec Irmin Schmidt, seul rescapé des pères fondateurs du groupe, et gardien d’un temple aux fondations inébranlables.
Après avoir replongé dans les archives des CAN et publié The Lost Tapes (2013), vous dévoilez aujourd’hui un 1er album live du groupe. Un travail de documentation plus complexe, puisque vous ne disposiez pas d’enregistrements officiels.
Irmin Schmidt – Pour les Lost Tapes, il était plus facile de faire des choix, même si cela a représenté beaucoup de travail. Or, cette fois, les enregistrements ne provenaient pas de nos archives, mais de bandes enregistrées par des fans et des amateurs. Elles viennent notamment de la collection d’un homme, à Londres, qui possède de nombreux bootlegs qu’il a lui-même mis en boîte ou qu’il a accumulés en chinant. Naturellement, la plupart de ces enregistrements sont de piètre qualité. Le travail de sélection a donc consisté à faire le tri entre ce qui était utilisable et ce qui ne l’était pas.
Vous aviez encore beaucoup d’heures d’enregistrements à votre disposition ?
Oui, et je n’ai d’ailleurs pas terminé de tout passer en revue. Nous avons à ce jour l’équivalent de quatre albums potentiellement prêts, et j’ai l’espoir de trouver davantage d’enregistrements.
A l’époque, CAN n’enregistrait pas ses concerts. Vous ne ressentiez pas le besoin de documenter les instants live du groupe ?
Cela ne nous intéressait pas, on n’y a jamais vraiment pensé, je dois dire, même s’il y a eu quelques tentatives. Chaque fois que nous avons essayé de capter un concert, quelque chose ne marchait pas. C’était comme une malédiction. Je me rappelle, une fois, pour Virgin, nous avons enregistré un live dans un studio mobile. A la fin, en écoutant les pistes, la guitare de Michael Karoli et la voix de Damo Suzuki ne figuraient pas sur l’enregistrement ! La même chose s’est passée lors du tournage du Free Concert à Cologne, en 1972 (documentaire réalisé par Peter Przygodda, proche collaborateur de Wim Wenders, ndlr). L’enregistreur était en panne, il a donc fallu utiliser le son de mauvaise qualité de la caméra.
Je suis récemment retombé sur le live de CAN mis en boîte pour l’émission Rockpalast, en 1970. Kraftwerk jouait aussi ce soir-là.
Oui, le concert avait lieu sous une tente. C’est la seule fois où on a joué avec Kraftwerk, dans sa mouture originale, avec Ralf (Hütter) et Florian (Schneider) à la flûte. C’est Klaus Dinger (de Neu !) qui jouait de la batterie. Je crois que c’était notre 1er concert avec Damo Suzuki, d’ailleurs. On va probablement essayer d’en faire un disque.
La jeunesse allemande semble déconcertée sur cette vidéo. Comme si elle découvrait une nouvelle forme de performance rock. Vous avez mis du temps à faire entendre votre musique ?
Le public semble assez confus, effectivement. En Allemagne, dans les années 60, la musique rock était celle qui venait d’Angleterre. Pas des Etats-Unis ! D’Angleterre. Les Pretty Things, Kinks, Beatles. Nous, on était tellement différents ! La presse écrivait qu’on ne pourrait jamais jouer du rock. Et puis on a fait nos 1ères tournées en Angleterre, et ça a plu, parce que, pour une fois, un groupe allemand n’essaie pas d’imiter les Anglais. A partir de là, on a été acceptés par les Allemands, parce qu’outre-Manche, et en France aussi où l’on avait joué pour la 1ère fois au Bataclan, on venait d’être adoubés.
Le live à Stuttgart que vous publiez aujourd’hui est-il retranscrit dans son intégralité ?
Ce que j’essaye de faire avec cette série d’albums live, c’est de rendre compte du fait que nous improvisions notre musique sur scène. Nous n’avons pas de setlist, on réagissait à l’atmosphère, à l’ambiance, à l’acoustique. On créait spontanément sur scène. Le concert de Stuttgart qu’on sort aujourd’hui était probablement plus long, mais nous n’avons conservé que les bandes utilisables, avec le souci de garder une trame cohérente. Il est important pour moi que les concerts aient une certaine architecture et une dramaturgie, même si la musique est improvisée. Je ne voulais pas d’un best-of. Il peut sembler parfois que la tension baisse et que le public n’est plus attentif, mais j’ai voulu conserver cela, parce qu’il s’agit de conserver l’esprit de ce moment.
Les concerts de CAN pouvaient durer des heures, j’imagine que les contraintes techniques des enregistrements pirates de l’époque ne permettaient pas une captation intégrale des shows du groupe ?
Je n’ai effectivement pas trouvé de cassette d’une durée telle. Soit parce qu’il n’y avait pas assez bande, soit parce que le gars qui enregistrait a fini par en avoir marre de tenir son micro. Il y a des moments sur certains enregistrements où, vraiment, on constate que le type qui tenait son appareil en direction de la scène baisse soudainement le bras, camouflant ainsi le son du concert. J’ai un enregistrement de Birmingham sur lequel on retrouve un seul morceau, mais qui dure une heure. C’est une énergie absolument dingue. Mais la qualité n’est malheureusement pas assez bonne pour en faire un disque.
>> A lire aussi : Un coffret révèle de stupéfiantes et inédites bandes de CAN
En 1975, Malcolm Mooney, 1er chanteur du groupe, et Damo Suzuki, qui lui succédera, ne font déjà plus partie du groupe. Les concerts ne sont alors plus qu’instrumentaux. Cela vous a-t-il obligés à envisager la scène différemment ?
Il y a sûrement eu des changements, oui. Mais cela se remarque aussi dans l’évolution de notre discographie. Par exemple, à Stuttgart, nous n’avions vraiment pas besoin de chanteur. Les chanteurs, chez nous, n’ont jamais été des “frontmen”, mais plutôt des instrumentistes utilisant la voix. Damo, il n’a pas chanté de vrais textes, il mélangeait au moins trois langues différentes, avec des mots qui lui venaient spontanément en tête. Pas vraiment la définition de ce que les gens attendent d’un chanteur de rock qui écrit ses textes et a un message à délivrer.
Michael Rother (Harmonia, Neu !), nous confiait qu’il ne souhaitait pas exposer son public à des séances chaotiques d’improvisation sur scène parce que le public finit toujours par s’ennuyer. Avez-vous eu l’impression en réécoutant ces bandes d’avoir évité cette forme de chaos avec CAN ?
Je ne sais pas. Nous quatre – Holger, Jaki, Michael (Karoli, le guitariste) et moi –, venions de différentes traditions musicales. La forme d’expression que nous avions, centrée sur la spontanéité et l’improvisation, était notre forme d’expression privilégiée depuis toujours. Jamais personne n’arrivait en studio en disant : “J’ai composé ce morceau.” On répétait beaucoup. Sur scène, on s’écoutait et la musique sortait naturellement. Ce n’était malgré tout pas toujours des moments de grâce, parfois cela ne fonctionnait pas, même sur scène. Mais c’était le risque.
Un risque qui créait une intensité, une tension telle que le public ne s’ennuyait pas. Il savait qu’il assistait à une création particulière. Il était inclus dans ce processus étonnant et fascinant. On a fait une fois un set d’une heure, avec entracte. Avant de remonter sur scène, on s’est dit : “C’était tellement de la merde, que le public a dû partir.” Eh bien non, tout le monde était resté. Et cette énergie nous a permis de faire un deuxième set réussi.
Regrettez-vous de ne pas avoir joué vos disques sur scène ?
Non, on n’a jamais fait cela. On a fait des citations de motifs, de mélodies, ce genre de choses. Mais à chaque fois, ces éléments étaient si modifiés qu’ils étaient à peine perceptibles. Lors d’un concert à Londres, le public n’avait de cesse de demander que l’on joue You Doo Right en scandant le nom de la chanson, alors qu’on l’avait jouée ! Mais le titre avait mué en quelque chose de nouveau et personne ne l’avait reconnu. Sur la compilation Live 1971-1977, il y a aussi une version de Dizzy Dizzy méconnaissable.
Vous avez arrêté tôt de faire des concerts, dès 1977. Vous étiez arrivés au bout de quelque chose ?
Oui, en 77. Je crois que notre dernier concert a été donné à Porto. En replongeant dans ces bootlegs, je me rends compte que nos derniers concerts n’ont pas le même esprit. Il me semble que cet idéal d’improvisation vivait ses derniers moments. J’y ai trouvé des routines, un essoufflement. On a commencé à jouer des morceaux, l’organisme était rouillé, comme si nos capacités de télépathie s’effaçaient peu à peu.
A quoi ressemblait la vie au sein du groupe avant de monter sur scène ?
Il y avait quelques règles. Par exemple, 20 minutes avant de monter sur scène, personne n’avait le droit de nous rejoindre en loge, pas même Hildegard, ma femme. Nous n’étions que nous quatre. On ne répétait pas, on ne faisait pas de musique. On avait une sorte de rituel de silence, qui demandait de la concentration. On cherchait à devenir un organisme autonome.
Avez-vous déjà vu des groupes sur scène qui vous ressemblent ou vous ont inspiré ?
Non, pas vraiment. Naturellement, beaucoup de groupes ont recours à des solos improvisés, mais je crois que le seul qui m’a scotché, c’est Jimi Hendrix. Quand je l’ai vu, il a commencé son morceau, puis il s’est mis à chanter, avant de tout chambouler. C’était quelque chose de totalement enflammé, déstructuré et improvisé. Hendrix, c’est la raison pour laquelle j’ai fondé CAN.
 CAN sur scène (courtesy de Spoon Records)
CAN sur scène (courtesy de Spoon Records)
Au sein de votre groupe, plusieurs écoles musicales se télescopaient. Vous et Holger Czukay étiez des disciples de Karlheinz Stockhausen, Jaki Liebezeit, à la batterie, venait plutôt du jazz, quand Michael Karoli traînait davantage dans les milieux rock. Que pensait Stockhausen de la musique de CAN ?
Ma formation classique était aux antipodes de la spontanéité et de la musique improvisée. Je me rappelle que Boulez, par exemple, détestait vraiment l’improvisation. Avec Stockhausen, c’était différent. Il s’était laissé convaincre un jour de faire un blind test avec des disques rock de l’époque. Et puis on lui a joué Aumgn, l’un des morceaux de notre album Tago Mago (1971). Il a tout détesté, assurant que l’écoute de ces chansons lui faisait physiquement mal, sauf notre morceau. “Ça c’est de la musique”, avait-il dit, fasciné. Quand il a su que le morceau était de nous, il a répondu : “Ça ne m’étonne pas, ce sont mes élèves !”
Vous dîtes souvent ne pas être nostalgique, ni très sentimental. Le fait de replonger dans ces archives sonores a-t-il ravivé des souvenirs ?
Comme vous le dites, je n’ai aucune sorte de nostalgie. Quand j’écoute un concert comme celui de Stuttgart, c’est comme si j’écoutais un autre groupe. Quand un disque est réussi, il ne m’appartient plus, il est dans le monde. C’est quand quelque chose n’est pas réussi que ça peut faire mal. Stuttgart, c’est un bon concert. La seule chose que je peux vous dire, c’est que je n’ai aucun souvenir de ce concert, probablement parce qu’il était réussi (rires).
En parlant de se rappeler du passé, avez-vous en tête un souvenir marquant d’une prestation de CAN en concert ?
Je me rappelle les concerts quand quelque chose de spécial s’y est passé, comme une rencontre, ou un événement insolite. A Birmingham, je me rappelle très bien, parce que j’étais malade. Je sortais d’une grippe avec une forte fièvre, et j’avais mélangé des médicaments avec du speed. Et le speed combiné à la fièvre, c’est dangereux (rires). Pendant le concert, je suis tombé dans les pommes, sur l’orgue, qui a fait un sacré boucan. Je suis resté inconscient un moment, et quand je suis revenu, le public m’a acclamé parce qu’il pensait que cela faisait partie du show.
Une autre anecdote que je explique dans la biographie du groupe : à Bristol, un motard des Hells Angels bègue, qui s’était faufilé dans nos loges pendant l’entracte pour nous rencontrer, s’est soudainement mis à causer normalement. Et ses amis ont pensé que CAN avait fait un miracle. C’était un moment très touchant. Il s’est remis à bégayer le lendemain, mais l’espace d’un instant, il a pu communiquer comme les autres. Il ne s’arrêtait plus.
C’est le genre de choses dont je me rappelle, plus que les concerts.
Live in Stuttgart 1975 (Mute/[PIAS]), à paraître le vendredi 28 mai