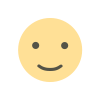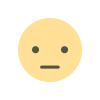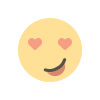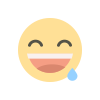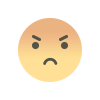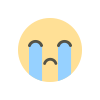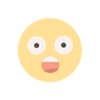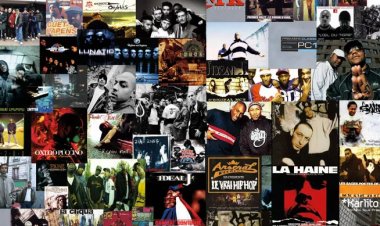James Chance, itinéraire d’un pionnier du punk-funk acariâtre
Smoking blanc et cravate noire… Il aura marqué l’histoire de la musique avec son look très clean et élégant qui contrastait avec le feu qui sortait de son saxo et la zizanie qu’il mettait entre les genres. James Chance aura été une icône underground...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Smoking blanc et cravate noire… Il aura marqué l’histoire de la musique avec son look très clean et élégant qui contrastait avec le feu qui sortait de son saxo et la zizanie qu’il mettait entre les genres. James Chance aura été une icône underground des années 1970-1980 dont les apparitions à l’époque dans une gazette comme Rock & Folk suggéraient qu’il aspirait à un autre monde que les rockers lambda. D’ailleurs, il était plutôt un jazzman sauvage qui voulait secouer son public et toucher au funk ou au disco avec un radicalisme punk.
À la fois flamboyant et décalé, ce franc-tireur underground a frôlé le succès – notamment avec Contort Yourself, son morceau de post-funk abrasif – mais surtout ouvert la voie à des artistes plus connu·es que lui – on pourrait citer par exemple James Murphy et LCD Soundystem ou le producteur et cerveau de Shellac, Steve Albini. Chance, de son vrai nom James Siegfried, est mort le 19 juin à 71 ans dans un hôpital de New York, ce que son frère David a confirmé. Comme pour d’autres pionnier·ères influent·es mais méconnu·es par les nouvelles générations, sa disparition est l’occasion de faire redécouvrir la dimension stupéfiantment explosive de sa musique.
Punk jazz
Né en 1953 à Milwaukee dans le Wisconsin, James Siegfried apprend, enfant, à jouer au piano grâce aux nonnes de son école catholique avant de se mettre au jazz. C’est l’avant-garde qui provoque ses plus grands émois, que ça soit Albert Ayler, considéré comme un des précurseurs du free jazz, ou les Stooges d’Iggy Pop, les dynamiteurs du rock’n’roll. À 18 ans, il oublie le piano et se met au sax alto, crée le James Siegfried Quintet, tourné vers le free, et joue en parallèle dans un groupe de rock bruitiste nommé Death. Aucune des deux projets ne décolle – le chanteur de Death met même fin à ses jours – et Siegfried part à New York, persuadé – à raison – d’y trouver des oreilles plus à l’écoute de ses envies. Là-bas, il met un pied au CBGB et se frotte au punk américain – les Ramones ou les Heartbreakers – et emménage dans le Lower East Side, quartier de Manhattan délabré et fauché où se croisent les junkies, les plus pauvres et les artistes bohèmes – qui peuvent aussi appartenir aux deux précédentes catégories. Siegfried tente alors de trouver sa place dans la scène jazz mais son esprit frondeur ne s’accommode pas du conservatisme qu’il y rencontre.
Au contraire, il se sent proche du duo Suicide et croise Lydia Lunch, une adolescente qui a fui l’inceste et le domicile familial. Quand Lunch emménage chez lui, Siegfried l’encourage à transformer en chansons les poèmes qu’elle écrit. Teenage Jesus and The Jerks naît alors, groupe qui va bientôt incarner la révolution post-punk. Répondant désormais au pseudo de Chance, Siegfried n’y reste pas longtemps et crée sa formation à lui, The Contortions, moins minimale mais pas moins novatrice que Teenage Jesus and the Jerks. Les deux groupes participent au même festival de rock underground new-yorkais en mai 1978 organisé à l’Artists Space à Tribeca. Chance perfectionne alors sa formule totalement instable du punk-funk, comme du James Brown – une de ses influences les plus durables – speedé et expérimental, avec solos de sax imprévisibles et stridents, riffs de guitare coupants comme le verre.
La blank generation
Durant les 1ers concerts des Contortions, énervé par la passivité du public arty et hautain, il s’adonne aussi à un plaisir pervers, celui de s’attaquer à l’assistance. Cela peut aller de la simple provocation verbale – comme lorsqu’il entame une version mutante de Jailhouse Rock, popularisé par Presley – “ce morceau est pour ceux qui vivent dans le passé, soit 99 % de vous, idiots !” – à l’agression physique pure et simple. Dans le livre Please Kill Me, Adele Bertei, clavier des Contortions, explique ainsi : “James ressemblait à une peinture de Jackson Pollock. C’était une personnalité tellement explosive. Et il avait un côté profondément masochiste. Par exemple, il sautait dans la foule pour y embrasser une fille. Le copain de la fille le repoussait et du coup ils commençaient à se mettre sur la gueule (…) C’était toujours James qui était dans le pire état…” Le concert des Contortions à l’Artists Space est ainsi interrompu parce que Chance se bat avec le rock critic du Village Voice, Robert Christgau pour des raisons à jamais nébuleuses – une version prétend que Chance aurait frappé la femme de Christgau enceinte ! Dans le public, Brian Eno, déjà parti de Roxy Music, hallucine et va produire lui-même la compilation No New York avec, en plus des Contortions, Teenage Jesus and the Jerks, le D.N.A. d’Arto Lindsay et Mars. La scène No wave tient son manifeste.
En 1979, James Chance surfe sur la hype et se dédouble. Avec Buy, il capture l’essence de The Contortions tout en se réinventant aussi sec avec Off White crédité à James White and The Blacks, clin d’œil transparent à James Brown. Dans son répertoire live se glissent King Heroin ou I Got You (I Feel Good) du “Godfather of Funk” mais aussi Don’t Stop Till You Get Enough de Michael Jackson, trois titres interprétés lors d’un concert aux Bains Douches parisiennes en 1980. Comme on le voit dans le film Downtown 81 (2001) qui prend Jean-Michel Basquiat comme protagoniste rêveur, Chance adopte un autre parti pris scénique. Il abandonne son agressivité frontale pour jouer le rôle de chef d’orchestre, pas loin de celui que Prince adoptera quelques années plus tard avec ses différentes formations. Désormais, il s’entoure de choristes et d’une vraie section de cuivres pour mener une revue soul. Joseph Bowie, avant de créer Defunkt, fait partie un temps de ses accompagnateurs.
Figure culte
Les années 1980 le voient continuer de tracer son sillon punk-funk, revenant parfois à ses amours jazzy comme lorsqu’il reprend à sa manière abrasive deux standards de Duke Ellington, Caravan et It Don’t Mean a Thing sur Flaming Delfonics en 1983. Sa carrière connaît alors d’énormes ellipses durant lesquelles Chance disparaît avant de revenir pour souffler sa folie jazzy. Avec le temps, Chance gagne le statut culte et voit sa musique régulièrement revisitée, surtout quand le punk-funk revient à la mode avec le label DFA au début des années 2000. La France le célèbre régulièrement et Frank Darcel de Marquis de Sade devient un allié de choix – il enregistre avec lui en 2006 The Fix Is In pour le label hexagonal Le Maquis. Chance se produit sur scène quelques fois avec des musiciens français, d’autres fois avec des accompagnateurs italiens. Il vit sur le culte dont il jouit et maltraite les journalistes qui viennent réveiller sa légende.
Gêné par des problèmes de santé depuis des années, légèrement irascible, il aurait donné son dernier concert en 2019 à Utrecht, aux Pays-Bas, quelques jours après un rendez-vous manqué avec les Inrocks.