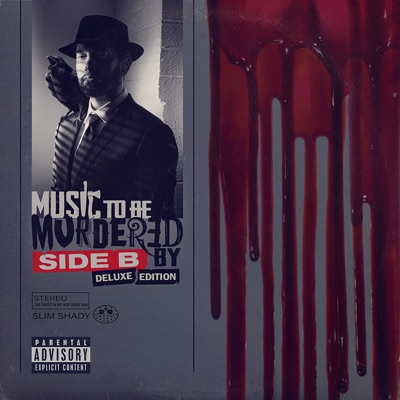Jane Birkin, icône et cætera
C’était une matinée d’été, entre deux trains. Celui qui l’avait ramenée de sa maison bretonne, où elle s’était reposée avec sa petite-fille Jo et puis, dans une poignée d’heures, l’autre, direction le Sud provençal, pour rejoindre la tribu...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

C’était une matinée d’été, entre deux trains. Celui qui l’avait ramenée de sa maison bretonne, où elle s’était reposée avec sa petite-fille Jo et puis, dans une poignée d’heures, l’autre, direction le Sud provençal, pour rejoindre la tribu de Charlotte. Chez Jane Birkin, un petit appartement près du Jardin du Luxembourg, les murs étaient recouverts de papiers peints (fleuris le plus souvent, on n’est pas née en Angleterre pour rien) ou de photos, soigneusement et joliment encadrées, de ses filles, ses petits-enfants, ses parents, son frères, Serge… Bref, toute sa famille tant aimée. Car Jane Birkin était une matriarche, toujours dotée de l’accent délicieux de la Lolita go home, et de ce regard clair, bienveillant. Lorsque je l’ai rencontrée, ce jour de juillet 2019, elle portait un pantalon treillis, un tee-shirt à la Jane, rose, et puis des baskets, évidemment. Un panier pas loin. Bref, le swag birkinien en action, et en activité depuis le 14 décembre 1946, jour de sa naissance à Londres.
Son enfance, elle y tenait beaucoup. “Certains disent que leur enfance a été misérable ou nulle, comme disait Jacques (Doillon, ndlr), qui a tout fait pour s’en sortir avec les films, pour s’échapper de ces années où il y avait peu à dire. Mais moi, c’était merveilleux, j’avais un frère d’un an plus âgé, une sœur plus petite de quatre ans, on ne pouvait pas rêver mieux. Ma famille, c’était, et cela reste, toute ma vie, et mes parents, tellement sublimes !” Lui s’appelle David Birkin, commandant de Royal Navy, qui prêta main forte à la Résistance française durant la Seconde Guerre Mondiale. Elle, c’est l’actrice Judy Campbell, entre autres muse du dramaturge Noël Coward. Elle s’illustre au cinéma, puis sur des programmes télévisuels. “J’ai revu leur mariage, filmé car ma mère était très connue à l’époque, ils étaient si beaux. L’enfance m’a semblé être la période la plus heureuse de ma vie…” Jusqu’à ce qu’elle se retrouve en pension, sur l’île de Wight, regrettant son doux foyer, dans la chambre 99. Comme elle le dévoilera plus tard à Agnès Varda, on l’appelle “Ninety-nine”, sans que personne ne puisse imaginer un seul instant qu’en 1969, année érotique comme chacun sait, Jane Birkin fera de ces chiffres tout en rondeurs un duo ultra sexy.
Ses parents ont des idées progressistes : dès l’enfance, Jane manifeste avec son père contre la peine de mort. Les enfants Birkin évoluent dans une atmosphère artistiquement favorable, joyeuse, curieuse. Dès la sortie de l’internat, Jane plonge dans le Swinging London, fait des débuts de comédienne – notamment dans Le Knack… ou comment l’avoir – et rencontre le compositeur “terriblement séduisant” John Barry. Elle a 17 ans, il en a 30, David Birkin ronchonne mais les deux amoureux se marient, et accueillent Kate en 1967. Entre temps, Jane a été remarquée dans Blow-Up, d’Antonioni, qu’elle dira avoir accepté uniquement parce que Barry pensait qu’elle n’oserait pas le faire. La jolie petite Anglaise a plus de répondant qu’on pourrait le penser en regardant ses longs cheveux lisses, ses yeux bleus et sa moue enfantine. “En sortant de l’internat, j’étais tellement en demande d’amour… John Barry avait une carrière, moi je n’avais que lui.”
1968, c’est le divorce, et le début du French Dream de Jane, panier en osier calé sur un bras et bébé Kate dans l’autre. C’est aussi, sur Slogan, la rencontre avec Serge Gainsbourg. “Il a une allure très bizarre mais je l’aime, il est si différent de tous ceux que je connais, assez dégénéré, mais pur en même temps”, écrit-elle dans son journal – qu’on peut lire depuis sa publication en deux volets, Munkey Diaries (2018) et Post-scriptum (2019). La suite, on la connaît. De l’allure folle du génie dandy qu’est Gainsbourg (et à laquelle a fortement contribué Jane), et de la beauté évanescente de Birkin, qui arbore les robes transparentes en toute innocence, naît le couple le plus culte de la pop française. Plus que muse, elle est inspiratrice, parce qu’inspirée.
Ce jour d’été de notre entretien, autour de son dernier disque enregistré avec Étienne Daho, elle se souvenait de ce qu’elle avait alors décidé en son for intérieur en tombant amoureuse de Gainsbourg : “Aux côtés de Serge, je voulais continuer à avoir autant de demandes dans le cinéma, gagner ma vie à moi, ne pas être en demande, ne pas être aussi terriblement dépendante que je l’avais été de John. Une dépendance, c’est charmant sur un chien, c’est tout.” En 1969, sort un 1er album signé de leurs deux noms. S’y distingue des reprises (des Sucettes, entre autres), 18-39, éternelle carte de visite Jane B., qu’elle chantera jusqu’à ses tout derniers concerts :
Yeux bleus
Cheveux châtains
Jane B.
Tu dors au bord du chemin
Une fleur, deux sons
À la main
Y figure aussi le single du scandale, un Je t’aime moi non plus que Jane s’est superbement appropriée en dépit de sa fabrication originelle made in Bardot, une octave au-dessus, et qui vaudra à sa nouvelle et célèbre interprète d’être éreintée par les médias britanniques. Shocking! Qu’importe, Jane tourne dans l’ultra glamour La Piscine, accepte les murs recouverts de tissu noir de la maison rue de Verneuil. Si elle incarne la liberté débridée des années 60 et 70, Jane Birkin est alors une grande sentimentale en soif d’émancipation. Ce que expliquent, à leur manière, les albums Di Doo Dah (1973) et Lolita Go Home (1975)… avant un Ex-Fan des sixties (1978) mi-figue mi-raisin, sexy et dépressif, magistral.
Le week-end, Jane et Serge partent en Normandie où elle a retapé un ancien presbytère. Mais la nuit parisienne est leur seconde maison. Au programme, danse et cocktails en boîtes de nuit, petit déjeuner avec les enfants, sommeil diurne, entrevues et séances photo. Parce que la promotion est un exercice amusant, et que cela fait plaisir à Serge qui prend sa revanche sur ses origines sociales, tandis que Jane étant issue d’une famille de célébrités, elle s’y adapte parfaitement. Et puis la fête encore, le studio d’enregistrement et le plateau de cinéma. Si Jane s’éloigne du cinéma quelques saisons après la naissance de Charlotte, on la revoit rapidement chez Roger Vadim, Michel Deville, Claude Zidi, Michel Audiard… sans oublier les films de Gainsbourg et de Jacques Doillon, grâce à qui elle rompt avec les rôles parfois trop légers, et avec qui elle part vivre après une décennie d’amour fou avec Serge.
Croire aux cieux, croire aux dieux
Même quand tout nous semble odieux
Que notre cœur est mis à sang et à feu
Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve
Comme une petite souris dans un coin d’alcôve
Apercevoir le bout de sa queue rose
Ses yeux fiévreux
Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve : c’est l’une des plus belles chansons de Gainsbourg, chanté par Birkin peu après leur rupture cataclysmique, et la naissance de sa troisième fille, Lou Doillon. Gainsbourg, elle adorait. Gainsbarre, beaucoup moins. Mais la légataire de son œuvre, c’est elle, qui la portera en format intimiste ou symphonique, en Arabesque aussi – avec le violoniste algérien Djamel Benyelles. Baby Alone in Babylone est un sommet de chanson pop française, où se croisent le morceau éponyme, à la mélodie empruntée à Brahms, ou Les Dessous Chics. Jane est solaire, inlassablement énergique, mais une mélancolie l’a toujours taraudée, Serge le sait et le cultive, tant du point de vue des textes que des mélodies, de L’Aquoiboniste jusqu’à des déchirantes Amours des feintes.
Les années 1980 sont, en revanche, celle de la reconnaissance dramatique. Chez Doillon, mais aussi chez Chéreau, dans La Fausse Suivante, en 1985. La même année, La Pirate de Doillon lui rapporte le César de la meilleure actrice. Bertrand Tavernier, Jacques Rivette, Jean-Pierre Mocky, James Ivory, Alain Resnais ou Jean-Luc Godard l’appellent. Plus tard, elle montera sur les planches en France comme au Royaume-Uni, interprétant du Sophocle, de l’Euripide ou du Shakespeare. Serge refait sa vie avec Bambou et Lulu mais ne reste jamais très loin, ses filles l’entourent, elle les voit grandir, et, lorsque l’amour se fane avec Jacques, elle connaîtra d’autres amours, notamment avec l’écrivain Olivier Rolin, rencontré lors d’un voyage humanitaire à Sarajevo, en 1995. Le verbe facile mais pas grande gueule, cash mais pudique, Jane Birkin n’a jamais cessé de s’engager.
En 1991, double deuil, double déchirure. Son père David, meurt, Serge aussi. Il lui faut du temps pour retrouver les studios. La peine est abyssale, et pourtant il faut continuer de vivre, élever ses filles, sauver les amours qui restent. En 1996, elle ose un prudent Versions Jane, reprenant les titres écrits pour d’autres par Serge Gainsbourg, réorchestrés par Jean-Claude Vannier, Doudou N’Diaye Rose ou Catherine Michel. En 1998, pour son 1er album de chansons non signés par Gainsbourg, À la légère, elle collabore avec Miossec, Gérard Manset, Alain Souchon, Étienne Daho ou encore Françoise Hardy, “toujours là pour moi”, me disait-elle. “C’était un plaisir de les voir à la rescousse”, rajoutait-elle, reconnaissante. Ensuite, le bien-nommé Rendez-vous (2004) de duos avec Feist ou Paolo Conte, Fictions (2006) et Enfants d’hiver, qui, en 2008, ravive volontairement la nostalgie de son enfance. Un morceau rend hommage à Aung San Suu Ky, Prix Nobel de la paix en 1991. Quant au répertoire gainsbourien, il ne quittera jamais ses préoccupations. Birkin/Gainsbourg, le symphonique, avec le compositeur et chef d’orchestre japonais Nobuyuki Nakajima, les tournées Gainsbourg, poète majeur (2014) et Gainsbourg Symphonique, en 2016. “C’est une vie rêvée, de partir sur la route, surtout pour moi qui n’arrive pas à être seule”, me glissait-elle, en souriant malicieusement. Même si elle ne l’était pas souvent, d’autant qu’une tripotée de toutous se sont relayés à ses pieds durant de longues années, tous plus baveux et affectueux les uns que les autres.
On parlait d’elle comme d’une muse, mais Jane Birkin était une créatrice. De ses cordes vocales, certes façonnées par Gainsbourg, elle a initié un véritable instrument à elle et elle seule, tout en vulnérabilité et mémorabilité immédiate. Et puis elle a écrit. Des journaux intimes, donc, formidables, mais aussi le texte Oh ! Pardon tu dormais, mis en scène en 1999, et Boxes, en 2017, où jouent Géraldine Chaplin et Michel Piccoli : “Il y avait des monologues dont j’étais pas mal fière… j’ai trouvé que j’avais une chance folle de pouvoir m’exprimer.” Avec son dernier album en date, Oh ! Pardon tu dormais, Jane B. signe des paroles à tomber, et un écrin sonore à la John Barry, sous influence d’une séduisante pop anglo-saxonne imaginée et orchestrée par Étienne Daho : “J’ai bénéficié de la brillante curiosité d’Étienne qui voulait me mettre en lumière.”
Ma fille s’est foutue en l’air
Et par terre, on l’a retrouvée
A-t-elle ouvert la fenêtre
En fait pour chasser la fumée ?
Cigarettes évoque très directement à Kate Barry, morte après s’être défenestrée en 2013. Le choc est immense, la douleur sans fin. Lors de notre rencontre chez elle, alors que nous sommes attablées au milieu des valises à moitié défaites et des bibelots, la petite Jo étant partie manger une glace, j’aborde, prudemment, les paroles de la chanson. Jane répond très naturellement : “Certains parents ne causent plus du tout du disparu, découpent leur image sur des photos de groupe, pour des raisons qui leur appartiennent. Sans doute pour que ça ne fasse pas plus de peine, ou gêner les autres. Chacun a sa façon de continuer avec ça, moi je veux continuer à en causer, tout le temps, pour qu’elle soit encore là.” C’est alors qu’elle partage un souvenir des pieds d’enfant de Kate, remontés à la surface au détour d’un rue lyonnaise. Toutes deux sommes alors très émues. Je ne préfère ne pas commenter, Jane s’arrête. Un ange passe, littéralement. Et nous reprenons notre conversation.
Après une dernière apparition publique lors de la cérémonie des César, pour lequel le documentaire que lui avait consacré Charlotte, Jane par Charlotte (2021), était nommé, puis des concerts repoussés et annulés, Jane Birkin a été retrouvée “sans vie” un dimanche 16 juillet. Comment ça, sans vie ? Il est impossible de l’imaginer inanimée, elle qui pétillait sans cesse… tout en témoignant d’une attraction pour l’apparat et le folklore morbide. Forte d’une existence jalonnée du départ des proches, et héritière d’un patrimoine gothique typiquement britannique, Jane aimait les lieux de recueillement post-mortem : “Je repense au cimetière juif de Vienne, on voit les écureuils sauter d’une tombe à l’autre. C’est romanesque à souhait ! Mais quand ce sont les vôtres qui sont enterrés, on ne peut pas s’empêcher de se demander ce qui se passe sous terre…” Nous, on la préfèrerait dans un paradis assez haut, aussi haut que montait son timbre au bord de l’essoufflement. Un paradis pas trop loin, joyeux et convivial, peuplé de grandes tablées et d’arbres sous lesquels rêvasser, la main accrochée à ceux et à celles qu’on aime.