Kevin Shields, l’entrevue fleuve : “Je suis une politique du zéro compromis”
Comment est née ton attirance pour les guitares ? Kevin Shields — Elles m’excitaient. J’y voyais une source de magie. J’ai grandi dans les seventies, mais je bouffais plein de trucs des sixties, surtout à la télé. Comme les Monkees, je les...
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Comment est née ton attirance pour les guitares ?
Kevin Shields — Elles m’excitaient. J’y voyais une source de magie. J’ai grandi dans les seventies, mais je bouffais plein de trucs des sixties, surtout à la télé. Comme les Monkees, je les trouvais frais. Je regardais tout en boucle et tout me semblait contemporain. Et le glam-rock explosait. C’était fun et excitant. Très touchant. Je ressentais une énorme connexion émotionnelle. Mais je détestais apprendre. Je détestais la formalité des leçons de musique. Je pensais suivre une école d’art mais j’étais incapable de gérer la formalité. Je ne voulais pas apprendre la guitare. Je voulais jouer comme Johnny Ramone ou les Buzzcocks. Je voulais cette même énergie.
Tu étais donc glam-rock ?
En 1973, un gros changement s’est produit, je suis parti des Etats-Unis pour l’Irlande où il y avait Top of the Pops, et la BBC. Une explosion de couleurs, toute cette excitation qui sortait de la télévision avec de la musique. Rien de ça n’avait lieu aux Etats-Unis. C’était comme changer de planète. Une réalité différente. Bowie et Bolan avaient tout commencé mais je l’avais manqué. Bowie était un peu distant… Pas comme Slade et Suzi Quatro qui t’explosaient au visage. Bowie était plus comme les Beatles. Ses morceaux étaient si boooons qu’ils transcendaient le glam-rock. Je n’identifie d’ailleurs pas Bowie au glam-rock, comme je ne vois pas The Cure comme faisant partie du mouvement gothique, ou du post-punk… Pour moi, ce sont les Cure, point barre. Pareil pour Bowie.
Vous êtes souvent présentés comme les parrains du shoegaze (mouvement musical britannique ayant émergé à la fin des années 1980 et ainsi baptisé en référence à l’attitude des groupes qui regardaient leurs pédales d’effet et donc leurs pieds, sur scène). Que penses-tu de cette terminologie ?
Je m’en fous ! Mais je ne m’en fous pas qu’on ne nous définisse que comme un groupe de shoegaze ! (rires) Je trouve ça insultant. La façon dont l’histoire est récrite. Les gens t’incluent dans un groupe juste en percevant une similarité, alors que les autres groupes [Ride, Lush, Slowdive, Chapterhouse] sont arrivés après nous. On n’était pas ensemble au même moment. Nous, on était juste nous-mêmes. De septembre à novembre 1989, on bossait les morceaux de Loveless et il n’y avait pas vraiment de shoegaze. C’est en 1990 que des groupes ont sorti des albums. Nous, on avait fini les voix et les overdubs de guitares. En 1989, on avait déjà tout fait. Le concept de Loveless était formé, les arrangements, les guitares. On existait et ils sont venus après nous. L’autre jour, j’ai vu sur YouTube un bloggeur dire que Swervedriver était un groupe shoegaze. C’est une injustice pour eux. Ils sont beaucoup plus rock. C’est les mettre dans une case qui les limite. Les gens récrivent tout. Quand ils causent des racines du shoegaze et des Cocteau Twins… C’est le son du milieu des eighties.

Quelque chose d’autre s’est produit entre-temps, qui est le hip-hop, ou encore Dinosaur Jr. Le langage affecte la façon dont les gens perçoivent la réalité. On leur décrit des guitares ou des voix, et donc leurs cerveaux se mettent à entendre immédiatement ce qu’ils pensent devoir entendre. Ils superposent. Le terme “shoegaze” s’est superposé à ce que nous faisons et a diminué l’expérience. Le cerveau des gens n’est plus ouvert à l’écoute. Il est fermé et dit “J’entends de la réverb’”. Ça me pousse à vouloir contrôler le récit. Je peux paraître aigri, mais ce n’est pas le cas. C’est juste chiant. Si on avait existé sans ce concept et sans tous ces groupes, on serait dans une meilleure situation.
C’est un facteur limitant. Mais, d’un autre côté, depuis les années 2000, il y a tant de groupes qui ont fait des trucs intéressants en se réclamant du shoegaze ou en expliquant avoir été influencé par nous… Si quelqu’un te copie ou explique que tu l’influences, c’est toujours un compliment. Si j’avais imaginé à 17 ans qu’un jour des gens passeraient leur temps à être influencé par un truc que j’ai fait, je ne l’aurais pas cru. Dès lors, je ne peux ressentir que de la tendresse à l’égard de quiconque se prend pour un groupe de shoegaze. Mais je sais que beaucoup de groupes qui se disent shoegaze ne nous aiment même pas. Ils aiment Slowdive ou Ride. Ils nous trouvent trop abrasifs, trop compliqués. Les émotions ne sont pas assez simples. Les gens veulent de la simplicité.
A lire aussi : Au fait, c’est quoi le shoegaze ?
Quelle place auriez-vous méritée ?
Ça reste du conditionnement, comme un grand voile jeté sur notre musique. Comme pour le punk. Beaucoup de groupes ne voulaient plus être qualifiés de punk. Ils voulaient être plus que ça, car beaucoup de punks étaient des groupes de seconde catégorie qui avaient pris le train en marche, et donc les historiques ne voulaient plus y être associés. Moi, petit, je trouvais ça mesquin de rejeter l’appellation punk. Mais je le comprends maintenant. Quand tu es associé à plein de choses médiocres, tu commences à être perçu à travers leur prisme. Les gens n’entendent plus ce que tu fais mais ce qu’ils pensent entendre.
En 1990, quel était votre rapport au cinéma ? Les films étaient-ils importants pour vous ?
On vivait dans des squats donc la TV n’était pas vraiment au cœur de nos vies. Et puis, on avait peu de chaînes de télé. Sauf qu’en Angleterre, la nuit, la télé diffusait des programmes vraiment étranges. Un mélange de programmes scientifiques sur BBC Two, de soap opera américains, des trucs cheap. Pendant deux ans environ, on rentrait du studio vers 3-4 heures, et on matait ces émissions, jusqu’au petit matin. C’était bizarre. Je ne me souviens pas de regarder un film ou autre chose. Mais j’adore les films. Quand nous étions encore en Irlande, il y avait un autre phénomène étrange : les video nasties, des vidéos mauvaises et violentes. Pour une raison obscure, elles étaient interdites en Angleterre, mais pas en Irlande. Donc, on les louait. Le nom de notre groupe vient de là. C’est Dave [Conway, ancien membre du groupe] qui l’a trouvé.
Il y avait aussi ce type de films qu’on appelait les trauma movies. Hyper kitsch. Ensuite, à Londres, on a discuté du fait de faire un film avec les gens qui nous entouraient, un truc scandaleux. On était à fond dedans. Il y avait tout un mouvement de production de films DIY qui te donnait l’impression que tu pouvais tout faire. Un truc punk, tu vois. C’était une influence pour nous, mais sans connexion émotionnelle. Je n’ai aucune tendresse pour ces films. C’était juste nouveau à l’époque, une esthétique cheap et une production accessible.
J’aimerais bien réaliser un film, un jour. C’est un fantasme, je suppose. On verra bien si ça se produit. Nous voulions réaliser un film de fiction sur le monde dans lequel nous vivions, sur les squats. Ça aurait été une belle capture de l’époque. On ne l’a jamais fait… Quand j’avais 16 ans, je voulais faire des films. J’étais hyper visuel. Mais je me suis trop investi dans la musique. Ça me prendrait toute ma vie d’accomplir une fraction de ce que je voudrais faire. Pendant des années, j’aurais pu créer des visuels pour les lives, j’avais des idées fortes, mais à la place, j’ai engagé des gens pour le faire. Je trouve ça aussi cool. Je ne veux pas tout faire, tout le temps. J’ai fait la plupart des pochettes que nous avons. Je n’ai pas pris les photos, mais ce sont mes idées.
As-tu aimé bosser sur la BO de Lost in Translation de Sofia Coppola pour laquelle tu as composé quatre morceaux ?
Elle est venue au studio à Londres. Elle n’aimait pas nos 1ères idées. Au départ, je composais à partir d’images de Tokyo. Mais ça sonnait bizarre. Elle trouvait ça trop étrange. Ce n’était pas si simple ! On a donc tout barré et on a décidé d’être plus libres. Une grande expérimentation et beaucoup de fun. J’avais une super team. J’adorerais faire toute une BO un jour.
Tu as aussi collaboré avec Patti Smith sur un concert hommage au photographe Robert Mapplethorpe. Tu connaissais bien son travail ?
Je connaissais son travail, son nom, et Patti. Mais c’est tout. Je ne connaissais pas son histoire, sa vie. Elle m’a contacté par email. Je préfère les emails. Même si rapidement, on s’est parlé par téléphone. On a parlé pendant des heures dans mon studio. C’est difficile de décrire ce qu’elle crée. Une atmosphère, un environnement qui rendent possible ce que nous avons fait. On n’a rien répété. Elle a juste parlé et m’a donné son livre, The Coral Sea. Il m’a fallu très peu de temps pour être à fond dans ce monde. Tout mon esprit y était plongé en quelques jours.
Si Brian Eno est un maître du studio, Patti Smith est la maîtresse de l’impro. Parce qu’elle a commencé par là. C’était remarquable, même si j’ai complètement foiré et que je n’ai pas aussi bien improvisé qu’elle. Elle a tout fait fonctionner. Elle réagissait à ce que je faisais. Quand je me plantais, elle réagissait et me poussait dans une autre direction. C’est une chose d’improviser en jazz, où tu peux jouer des notes et c’est viable. Quand tu improvises mélodiquement, c’est plus difficile. Quand tu vas dans la mauvaise direction, ça ne marche pas, tu dois arrêter. Tu ne peux pas faire semblant. Mais elle l’a fait fonctionner. Elle avait bien fait comprendre avant l’improvisation que nous avions déjà réussi, car nous avions une connection.
Tu t’es inspiré de ses photographies ?
Je les ai beaucoup consultées bien entendu. Je suis assez familier de son travail maintenant. Mais à l’époque, j’étais plus intéressé par la perspective, par l’histoire de Patti. Quand je traînais avec Patti, je ne lisais rien sur elle. J’étais plus intéressé par le fait de la découvrir en tant que personne, pas comme un sujet de lecture.
As-tu envie d’un album solo ?
Simplement, parce que j’ai trop de morceaux… J’écris beaucoup de musique que je ne sors pas, comme beaucoup de musiciens. Pas parce qu’elle est mauvaise, juste parce que c’est une autre direction que je ne veux pas poursuivre. Mais je trouve ça dommage que personne ne les entende. J’aimerais les regrouper. Ce sont des mélodies qui ne vont pas avec My Bloody ou que je ne parviens à placer dans un album, ça ne veut pas dire qu’elles ne devraient pas exister du tout.
Tu appréhendes les réactions du public ?
Je n’ai jamais fait un disque qui n’ait pas déçu la moitié des gens qui avaient aimé le précédent. Quand tu fais quelque chose pour une raison précise, tu ne peux pas t’inquiéter de décevoir les gens. C’est hors sujet. La plupart des gens qui ont écouté Loveless la 1ère fois l’ont détesté. Ils trouvaient que c’était trop ceci ou trop cela. “Oh, vous auriez dû faire du jazz ou de l’électronique…”, “Oh vous aviez fait Soon, vous auriez dû poursuivre dans la dance”. Les gens qui nous aimaient en 1986 ont trouvé Isn’t Anything horrible. Ils se demandaient où étaient les chansons, les mélodies.
En vérité, je sais comment produire une musique qui aurait plus de succès que n’importe lequel de nos disques, de façon intelligente et cynique. Elle serait intentionnellement médiocre et conventionnelle, mais emballée de façon à cocher toutes les cases. Il y a une simplicité dans la médiocrité qui attire les gens. Je sais qu’en faisant ce que je veux faire, je vais décevoir des gens. Notre public ne cesse de changer. Beaucoup de nos 1ers fans sont partis, littéralement, ils sont morts.
Quand nous avons sorti les versions analogiques de Loveless, nous avons eu accès à des statistiques sur les acheteurs, et 75 % d’entre eux avaient moins de 35 ans. Les gens de mon âge représentaient 5 %. Quand nous jouons live, ce ne sont que des gens de 25 ans qui viennent nous causer à la fin du concert.
Ça te rend heureux ?
Ça m’a fait prendre conscience que si j’ai encore une vie, c’est parce que nous avons été découverts par de jeunes générations. Si on n’avait compté que sur les vieux, on serait déjà à la rue.
Te sens-tu différent de quand tu avais 25 ans ?
Complètement. Nos cellules se régénèrent entièrement tous les sept ans, donc je me sens quatre fois plus différent. Toutefois, je pense que mon intuition et ma vision sont intemporelles. Je n’ai pas changé là-dessus. La musique que je faisais en 1987 était un reflet de l’époque. Mais mon intuition est si prédominante, que ce que je fais grâce à elle me cause toujours, elle a la même valeur, elle ne change pas tellement.

My Bloody Valentine a eu une vie assez foisonnante et chaotique, avec notamment un trou de vingt-deux ans entre vos deuxième et troisième albums, Loveless et m b v. Quelle période reste ta préférée ?
La période la plus insouciante, c’était Isn’t Anything. Cet été-là, nous étions six semaines en studio. Tout le monde était gentil avec nous. On expérimentait la privation de sommeil, donc c’était fun, mais aussi mental ! La période Loveless a été plus éprouvante, à cause de circonstances épouvantables, les pires. Nous avons signé avec le label Creation pour rien alors que de gros labels nous voulaient, mais nous voulions tout contrôler. Creation s’est révélé ne pas avoir d’argent c Je me sentais comme un parent qui veut protéger son enfant. Je voulais que rien ne puisse affecter cette musique. J’étais très strict. Je virais les gens, nous changions de studio tout le temps afin de préserver une bonne atmosphère.
J’avais besoin de temps pour l’album. Si j’avais dû tout faire en six mois, j’en aurais été très affecté, j’aurais fait un album intéressant mais j’aurais eu du mal à le soutenir, en raison des compromis. Je suis une politique du zéro compromis. Je n’ai pas enregistré le chaos, la bêtise qui nous entourait. J’ai juste retenu les moments détendus, positifs. C’est de là que vient ma réputation de fou et d’excentrique. Je refuse d’enregistrer dans le stress ou parce qu’il faut finir. Je m’en tiens à mes règles. Nos enregistrements ont été confisqués par le studio. C’était horrible parce que nous n’avions pas de copies. Il y avait trop de problèmes logistiques et financiers. Parfois, on passait cinq jours à remettre un magnétophone en état dans un studio pourri.
Vous preniez des drogues ?
Je fume de l’herbe. Je prenais de l’ecstasy à l’époque, mais plutôt en club. La journée, on était en studio, sans drogue. Je ne peux pas être défoncé quand je mixe ou j’enregistre. J’ai fait la musique de Lost in Translation en étant défoncé tout le temps, mais je n’avais rien de technique à faire.
Admires-tu toujours certaines personnes ?
J’ai écouté le dernier Paul McCartney et j’ai adoré son insouciance. Il ne cherche pas la sophistication, et ça le rend bien plus cool que plein d’autres choses qu’il a faites avant. Je suis hyperfan de Neil Young. C’est l’exemple parfait de quelqu’un qui fait son truc. Il a le son de guitare le plus cool du monde, un peu cassé. Quand Brian Wilson a fait sa tournée Pet Sounds en 2003-2004, je suis allé à 80 % des concerts.
J’achetais mes places, même si je connaissais le tourneur. J’ai même eu la chance de le rencontrer en loges, avec Bobby Gillespie [Primal Scream, The Jesus and Mary Chain] et les Super Furry Animals. Il nous a dit en mode patriarche : “Alors les garçons, vous aimez la musique ? » Nous, on hochait de la tête, “oui, oui, on adore”. Mais je ne lui ai pas parlé. Comme lorsque j’ai rencontré David Bowie : je ne lui ai pas dit qui j’étais, ni que j’aimais sa musique. J’ai dit : “Salut, je m’appelle Kevin.” C’est tout.
De la timidité ?
Je ne sais pas, je suis nul à ça. J’ai rencontré Nick Cave dans un festival, nous jouions après lui, il a pris la peine de rester nous regarder. Je suis un immense fan de son groupe The Birthday Party. Après le concert, on se rencontre et il me dit qu’il a vraiment aimé. Je n’ai rien pu répondre et je l’ai mis mal à l’aise – j’étais muet. Il a dû partir. La fois suivante, il m’a regardé comme si j’étais fou à lier.
Si tu réfléchissais, maintenant tu lui dirais quoi ?
“Tu représentes une énorme partie de moi-même.”
Peut-être que toute la conversation a lieu dans la musique ?
Je pense oui. Mais j’aurais aimé lui causer.
Loveless et plus généralement votre musique m’ont toujours fait penser à une réflexion sur Eros et Thanatos, l’amour, le désir, et la mort.
Pas la mort du point de vue de la personne qui est quittée alors, mais de la personne qui meurt. Tout est question d’équilibre. Il y a une relation très forte entre des extrêmes dans ce disque. Isn’t Anything était très sensuel et sexuel. Ça portait sur les abus, la maladie mentale. C’est un instantané de l’époque. Nous étions entourés de gens fous, très sombres. Les eighties étaient dévolues au fun et nous voulions nous en dégager.
La musique te sert-elle à exprimer cette obscurité ?
La musique exprime, point barre. C’est une physicalité qui affecte émotionnellement, sans besoin de mots. Plus elle est pure, plus elle le restera. Même si elle se fait traîner par terre, elle reviendra par-derrière. J’adore ça.
Te vois-tu comme une personne folle ou obscure ?
J’ai un côté sombre. Je suis capable d’être fou. Mais tout le monde l’est, les gens l’ignorent tout simplement. J’aime l’équilibre, je n’ai pas peur de l’obscurité. Je ne me sens pas submergé par elle.
Tu es sujet aux acouphènes, quel est ton rapport au silence ?
Le silence n’existe pas pour moi. Je connais des états entre le réveil et le sommeil, une sorte d’état narcotique où je peux l’expérimenter. Parfois, je conserve des images mentales, même si mes yeux sont fermés. D’autres fois, tout est éteint. Le cerveau, le son, les visions. Là, j’ai le silence mais c’est un endroit où tu n’as pas envie de rester, donc tu essayes d’en revenir vite.
Est-ce pour la physicalité que vous jouez si fort en live ? A La Route du Rock en 2009, j’ai dû me plaquer au sol puis quitter le concert car le volume était insoutenable.
Ce n’est pas si fort ! La musique a un volume naturel. Certains gouvernements tentent de le domestiquer. Or ça, ce n’est pas naturel. Nous venons de l’ampleur. Les enfants qui jouent, c’est fort. Les voitures sont fortes. Tout est fort. Quand tu fais de la musique, tu la sens. Même avec une guitare acoustique, tu sens les vibrations dans ton corps. Jouer de la musique à des gens qui ne la ressentent pas comme toi, c’est stupide. Donc nous avons commencé par jouer à 120 décibels pendant une heure, Colm [O’Cíosóig, batteur] et moi, pour tenter l’expérience sur nous-mêmes. A la fin, nous étions dans un état second. Nous nous sommes dit que ça serait cool de partager cette expérience. Ce n’est pas agressif. Il s’agit de ressenti. Je ne cause pas de volume mais d’être entouré par le son, de sentir le son. Il s’agit d’agression mais au sens de force, de puissance naturelle. L’objectif nest pas de soumettre le public.
Parce qu’on ne chante pas fort, il y a une certaine concentration qui se met en place, et une certaine lutte entre les voix et les instruments. Sur scène, le public fait 50 % de l’expérience. Tu peux avoir la même musique, le même son et un concert totalement différent selon le public. Et tu le ressens extrêmement.

Une fois, au Portugal, on jouait dans ce festival qui avait une affiche totalement inappropriée où nous figurions aux côtés d’un groupe dénommé Offsprings. Le public ne nous connaissait pas. Ils ont ce truc là-bas d’agiter des mouchoirs blancs pendant les matchs de football. Ça veut dire “casse-toi”. Ils nous ont fait ça. Des milliers de personnes avec leurs mouchoirs blancs dans les airs. Une autre fois, on jouait avec Tool et là, ce furent des doigts d’honneur. Il faut se replier sur soi-même et se dire “OK, ils ne peuvent pas nous atteindre”. C’est assez amusant quand les gens ne nous aiment pas, car avec notre musique, ça se transforme vite en expérience horrible. On peut jouer jusqu’à ce qu’ils partent. Nous avons déjà eu 50 % d’un public qui était parti avant la fin.
Et quand ça se passe bien, c’est une extase ?
Un phénomène de physique quantique se produit. Celui qui observe affecte l’observé. Quand le public est avec toi, tu es meilleur. Ils pensent que tu es meilleur, donc tu l’es, comme par magie.
Es-tu accro au public ?
Non, à cause de tout ce qui entoure un concert. Quoique, avec ce confinement, cette pandémie, je me suis aperçu que ça faisait partie de ma façon de me voir moi-même. Quand tu penses à la musique, tu vois souvent le public. Personne en particulier, mais un public. Tu penses que ça sera cool de faire telle ou telle chose en live. L’idée a désormais disparu. Tout le monde pensait que ça reprendrait cette année. Ce n’est pas si bizarre pour un musicien de ne pas jouer pendant un an. Ça peut être un désastre financier, mais ça arrive souvent. En revanche deux ans… Ça fout en l’air des gens. Si ça persiste, ça va commencer à toucher des gens comme moi.
Un meilleur souvenir de concert ?
Impossible.
Alors, le 1er avec My Bloody et Bilinda ?
Oui, je m’en souviens très bien. Bilinda avait son fils. Elle a trois fils, mais là, c’était le plus âgé. Il n’avait que deux ans, Tobias. Un âge où tu ne comprends pas encore tout. Il ne comprenait pas qu’il ne pouvait pas aller sur scène. On jouait dans un squat. Quand elle l’a quitté, il a explosé en larmes. Elle ne voulait pas le traumatiser donc elle l’a emmené avec elle. C’est mon 1er souvenir : Bilinda tenant son fils, et moi me disant ok, voilà le commencement. Il ne voulait pas être séparé d’elle.
Comment faites-vous pour rester ensemble depuis si longtemps ?
C’est un mélange de personnalités. Chacun prend le lead, selon le contexte. Colm est en charge dans le bus, Debby gère la fête après un concert, se déguise et fait des trucs débiles. Bilinda dicte l’atmosphère du groupe et je m’occupe de la musique. Je fais un peu le sergent parfois, mais sinon, ils ne se préoccupent pas de moi. Le groupe est équilibré. Quand nous avons rompu, nous ne nous sommes pas écroulés. On a gardé contact. C’est pour ça que nous avons pu nous reformer assez facilement. C’est grâce à cet équilibre d’énergie que nous continuons.
Tu n’es sur aucun réseau social en ton nom propre. Pourquoi ?
Mon Dieu, non. Je sais que j’aurais de terribles problèmes. Je ne sais pas toi, mais moi, je fais partie de ces gens qui disent ce qu’ils pensent. Il y a quelques semaines, je donnais une entrevue et j’ai soudainement dit que 50 % de la population mondiale était stupide. Je pensais plutôt à ce qui se passait aux Etats-Unis avec Trump. Le fait que des gens pouvaient voter pour lui. Après coup, je me suis dit que je ne pensais pas réellement que la moitié de la population était stupide. Je pense que nous sommes qui nous sommes et que personne ne peut connaître, ni juger la vie d’autrui.
Sur Twitter, je dirais plein de grosses merdes comme ça. Ça fait partie de moi. C’est comme quand je dis que le gouvernement est une bande de fascistes et de psychopathes. Je ne le pense pas vraiment. Ils ne le sont pas, je sais. Ce n’est pas vrai au sens strict du terme. Twitter, au vu de sa façon de fonctionner, ne représente pas ce que tu penses véritablement du vrai monde. Twitter est hyper dangereux pour cette raison. Quand t’es fan de football, tu penses que l’équipe adverse est une bande de connards, mais si tu rencontres l’un des mecs en soirée, ou dans un train, tu vas peut-être être super impressionné.
Tu pourrais pourtant y commenter l’entrevue du Prince Harry et de Megan Markle par Oprah Winfrey.
Exactement. Dire que leur famille est un ramassis de racistes. Mais je n’en ai rien à foutre, et je ne les connais pas. Le langage est assez limité. Il y a ce phénomène appelé “non-dualité” [pensée philosophique fondée sur l’idée qu’une substance unique relie les différentes entités du monde, ndlr]. C’est une absence de conditionnement. C’est indescriptible avec des mots. Même le mot “non-dualité” signifie “pas deux” mais ça ne veut pas dire “un”. Au lieu de dire “un-ité” on a dit “non-dualité”. Si tu cherches à le décrire, tu rentres dans le récit et tu t’embarques loin de la réalité. J’ai conscience de ce phénomène, même si je ne vois pas le monde ainsi. Ma vie, c’est moi en tant que personne, aussi conditionné que les autres. Je suis assez normal. Je suis perdu dans mon histoire. Le langage pointe des choses, tente de les communiquer, mais il ne sera compris que des gens qui auront le même conditionnement. Si non, vous êtes perdus.
Tu te penses donc toujours conditionné ?
Bien entendu. Tout ce qui m’est arrivé a fait que je suis qui je suis. Etre humain, c’est être conditionné. Si tu n’étais pas conditionné, tu serais une porte ou un insecte, ou des étoiles, ou le ciel. Ce sont les informations que l’on te donne qui te font agir et donc qui te conditionnent. Par exemple, si tu vois un groupe de mecs descendre une rue et qu’ils te paraissent étrangers, mais que tu sais qu’il y a une université au coin de la rue, tu vas te dire “OK ce sont des étudiants étrangers”. Si tu ne sais pas qu’il y a une université, ton cerveau va se demander : “Qui sont ces étrangers ? Sont-ils dangereux ?”
Il n’y a pas de bonnes ou de vraies informations. Il y a juste de l’information et les gens en font ce qu’ils veulent. Personne ne peut échapper au conditionnement. Nous sommes qui nous sommes. Le reste n’est que concepts philosophiques, religions et idées. Nous avons besoin que les choses fassent sens. Sinon, ça nous rend anxieux. J’essaye de prendre l’anxiété avec du recul. Mais parfois, je peux vraiment m’énerver. Par exemple, je vis au milieu du nulle part mais certains chassent à côté de chez nous. On pourrait donc être tués par mégarde. Je suis obligé de crier depuis notre fenêtre pour signaler qu’il y a une maison, une présence humaine. Ces chasseurs me créent du stress.
Rééditions Ep’s 1988-1991, Isn’t Anything, Loveless, m b v (Domino/A + LSO/Sony Music). Sortie en CD et vinyle le 21 mai









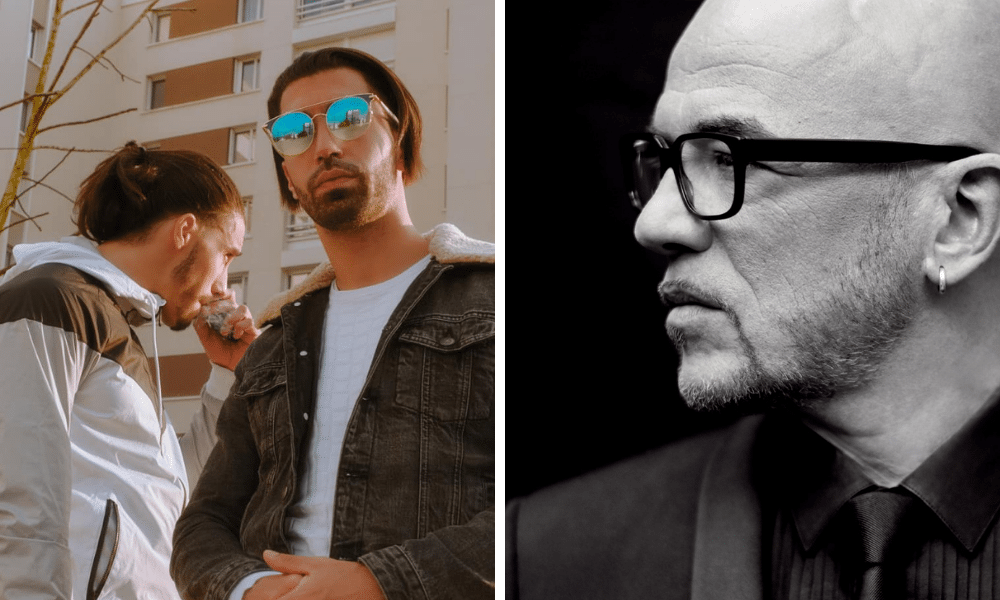



















![[Exclu] PLK “Freestyle Dans les mains“](https://img.youtube.com/vi/7mAYfNrWloU/maxresdefault.jpg)
