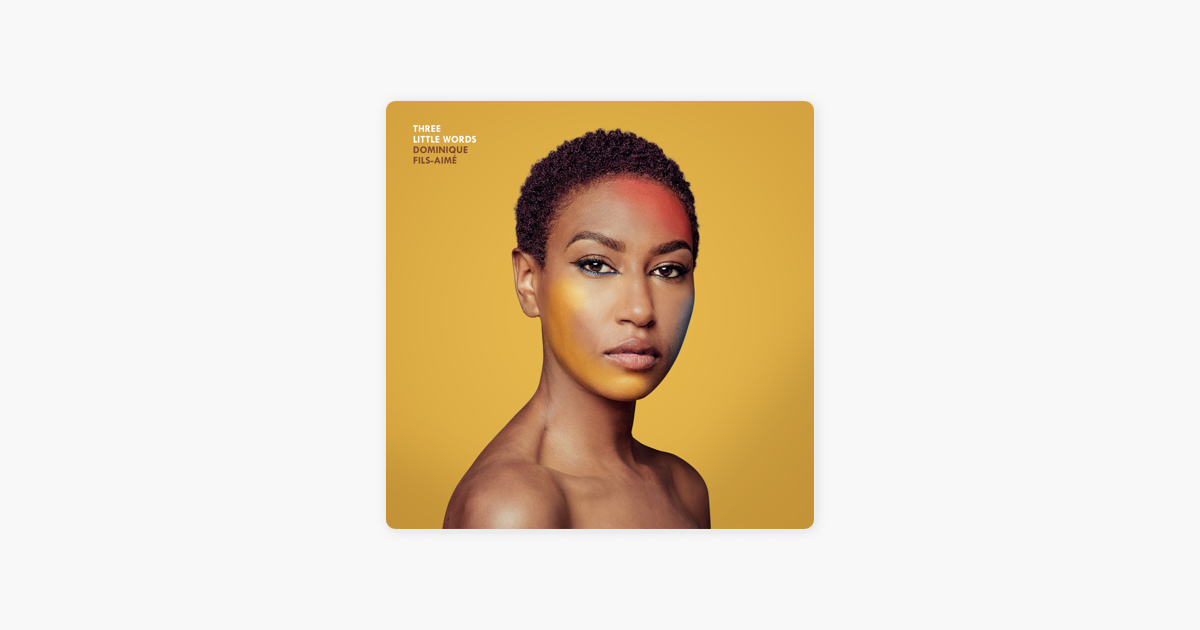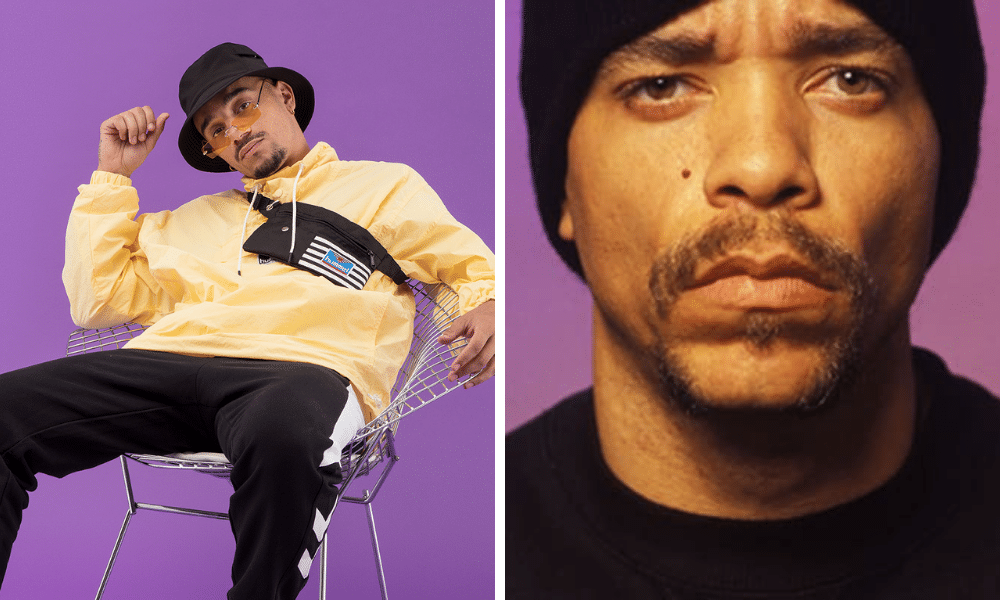Kim Gordon et Gus Van Sant : “Aux États-Unis, la situation est hors de contrôle”
C’est un border collie nommé Burroughs qui nous accueille devant le portail, à Los Feliz, dans la partie orientale – la moins clinquante et la plus charmante – des collines d’Hollywood. Son chien, fait-on remarquer à Gus Van Sant, a les mêmes...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

C’est un border collie nommé Burroughs qui nous accueille devant le portail, à Los Feliz, dans la partie orientale – la moins clinquante et la plus charmante – des collines d’Hollywood. Son chien, fait-on remarquer à Gus Van Sant, a les mêmes yeux, d’un bleu perçant, que ceux de Messi, la star d’Anatomie d’une chute – un film qu’il nous dit avoir aimé et que Kim Gordon, qui nous rejoint quelques minutes plus tard, nous dévoile avoir mis tout en haut de son top 10 l’an dernier. L’ex-chanteuse de Sonic Youth n’est pas venue les mains vides et offre à son vieil ami un vinyle de son dernier album, The Collective, dont elle vient d’assurer la promotion ces dernières semaines.
Le réalisateur d’Elephant vient lui aussi de terminer un round promotionnel, pour la deuxième saison de la série anthologique Feud, produite par Ryan Murphy et consacrée aux trahisons de Truman Capote. Tous·tes deux sont donc encore dans l’énergie du partage mais plus relax qu’auparavant. C’est ainsi le moment idéal pour entrevueer, ensemble, ces deux idoles des Inrocks, qui vivent désormais à Los Angeles, et même à quelques pâtés de maisons – Kim Gordon depuis qu’elle a quitté Thurston Moore et leur maison du Massachusetts circa 2015 ; Gus Van Sant depuis qu’il a progressivement abandonné son berceau de Portland il y a une dizaine d’années pour se rapprocher du soleil et de l’industrie.
À 71 ans (neuf mois les séparent), tous·tes deux ont puissamment façonné l’esthétique de leur art respectif et porté très haut le flambeau de l’intégrité artistique. Mais de façon presque opposée. Si l’une n’a eu de cesse de chercher la dissonance et la friction (portée par une immarcescible radicalité), l’autre incarne au contraire la labilité et la douceur absolues (servi par une capacité caméléonesque à se fondre dans le paysage tout en restant lui-même). Même leurs timidités s’expriment différemment : légère tension contre nonchalance, rires nerveux contre sourire en coin. En cette fin de matinée ensoleillée, le propriétaire des lieux — une belle petite maison mid-century, sans extravagance — nous installe sur sa terrasse, d’où l’on peut voir le Griffith Observatory si l’on tourne la tête à droite, le panneau Hollywood si l’on regarde à gauche. Et nous partons pour deux heures de conversation, sous la garde rapprochée de Burroughs.
Vous vous connaissez depuis quand ?
Gus Van Sant — On s’est croisés à une exposition pour la 1ère fois en 2000, je crois.
Kim Gordon — Cinq ans plus tard, tu m’as proposé de jouer un petit rôle dans Last Days [film inspiré des derniers jours de la vie de Kurt Cobain].
Gus Van Sant — Nous en parlions justement l’autre jour. Et quand je t’ai dit que j’avais choisi de ne pas trop évoquer les engueulades au sein de Nirvana, tu m’as répondu : “Ah oui, les dynamiques de groupe…” “Band Dynamics”, ça sonne bien non ? Je l’ai noté sur un calepin.
Kim Gordon — Moi c’est quand tu m’as parlé de Landscape Suicide, le long métrage de James Benning [1987], que ça m’a inspirée. Suicide du paysage… On devrait se consulter plus souvent pour se donner des idées de titres ! [rires]
En parlant de Last Days, le film, qui va bientôt fêter ses 20 ans, a récemment été adapté en opéra et a fait sa 1ère à Londres en 2022, avant d’être montré à L.A. en février 2024, où vous l’avez tous·tes les deux découvert. Qu’est-ce que ça vous a fait ?
Gus Van Sant — J’ai beaucoup aimé le travail d’adaptation fait par Oliver Leith et Matt Copson, je trouve qu’ils ont vraiment réussi transposer le film en opéra. Et c’est une excellente idée d’avoir casté une actrice française, Agathe Rousselle [découverte dans Titane de Julia Ducournau] pour le rôle principal.
Kim Gordon — Oui, c’est la meilleure idée du spectacle d’avoir pris une jeune femme pour jouer Blake [dit-elle en faisant la moue]. Ça décentre le propos d’une façon intéressante. Mais bon… Ils n’ont pas fait attention au fait que Kurt était gaucher.
Gus Van Sant — Attends, tu me mets le doute là… Je crois que dans mon film aussi, Michael Pitt était droitier. Il faudrait que je vérifie.
Kim Gordon — Ah ? Bon ce n’est pas très grave non plus. [rires] On sait que Blake n’est pas Kurt… Au fait, Michael joue dans un nouveau film, non ?
Gus Van Sant — Oui un film réalisé par Jack Huston qui devrait sortir cette année et que j’ai eu la chance de voir en avant-1ère à Venise. Ça s’appelle Day of the Fight et Michael y joue un boxeur récemment sorti de prison qui se prépare pour un combat très difficile, contre quelqu’un de plus fort que lui, et on le suit juste avant. C’est inspiré d’un court métrage du même nom de Kubrick. C’est vraiment bien. Dans une veine très Tennessee Williams, années 1950.
Il y a quelques jours, c’était le trentième anniversaire de la mort de Kurt Cobain, et je me demandais comment il serait aujourd’hui, s’il était encore vivant. Quel genre de musique ferait-il ? Et en ferait-il toujours, d’ailleurs ?
Gus Van Sant — J’y pense souvent… Moi je ne l’imagine pas continuer à faire de la musique.
Kim Gordon — Ou alors sous forme improvisée. Juste pour le plaisir, sans le cirque médiatique tout autour.
Gus Van Sant — Oui. Ou alors il ferait de la peinture. Ou alors il serait capable de travailler incognito dans une station-service paumée au milieu de nulle part… Kurt était quelqu’un qui essayait constamment d’échouer ! Quand je suis allé à Londres faire la promotion d’un de mes films – sans doute My Own Private Idaho [1991] – au début des années 1990, je me souviens que tout le monde ne me parlait que de grunge et de Nirvana. Parce que je venais de Portland, qui n’est pas très loin de Seattle, les journalistes anglais ne me parlaient que de ça. Ça avait l’air de les intéresser beaucoup plus que mon film. [rires]
Kim Gordon — Je me souviens quand Nirvana faisait notre 1ère partie en 1991, juste avant d’exploser avec Nevermind. Ils jouaient des chansons extrêmement dissonantes, dont certaines allaient finir sur In Utero, et Kurt n’arrêtait pas de nous dire : “Mais moi je veux faire des chansons comme vous les mecs !” Ça nous faisait marrer.
Vous pensez donc qu’il aurait tout fait pour rester radicalement indépendant ?
Kim Gordon — Kurt ne comprenait pas ce que signifiait la célébrité. Ça le dépassait. Il aimait gagner de l’argent, ça oui, mais ce n’était pas son but dans la vie. Et surtout il ne voulait pas se plier aux contraintes. C’était une époque où la musique alternative pouvait rapporter beaucoup d’argent et lorsqu’il a fallu se prêter à tout ce cirque, ça l’a dégoûté. Donc quand bien même il aurait survécu, je ne pense pas qu’il aurait continué à faire de la musique. En tout cas pas en enchaînant les albums, la promo, les tournées… Il n’était juste pas fait pour ça.
Et sa musique, vous pensez qu’elle incarne encore une forme de radicalité ou plus du tout ?
Kim Gordon — Je ne sais pas vraiment. Je vois beaucoup de gens porter des T-shirts Nirvana mais je ne sais pas ce que ça signifie pour eux. Est-ce que c’est juste un truc normcore ?
Gus Van Sant — Ça veut dire quoi “normcore” ?
Kim Gordon — C’est genre mainstream et fier de l’être. Comme… [elle réfléchit]
Gus Van Sant — Justin Bieber ?
Kim Gordon — On peut dire ça oui. Ou Taylor Swift. [rires]
Vous pensez quoi de Taylor Swift ?
Kim Gordon — Rien car je n’ai jamais écouté sa musique.
Gus Van Sant — Moi j’ai un peu essayé, mais je n’accroche pas.
Kim Gordon — Elle a du bon merch, je ne dirai pas le contraire. Une fois, j’ai pris un vol vers New York et la moitié de l’avion était rempli de gens avec des vêtements Taylor Swift. J’imagine qu’ils venaient de voir un concert. C’était assez impressionnant en tout cas.
Et le dernier Beyoncé ?
Kim Gordon — Je n’ai pas encore pris le temps d’écouter l’album mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner ; si ça va avoir un impact dans la culture.
Gus Van Sant — Moi j’ai commencé à l’écouter. Au début elle reprend Blackbird des Beatles de façon très pure, très simple, et ça m’a beaucoup plu. Du coup, je ne suis pas encore allé plus loin.
Pour beaucoup d’observateur·rices, on serait entré·es dans une phase de “monoculture” aux États-Unis. C’est-à-dire qu’après une ère où le mainstream n’existait plus vraiment parce que tout le monde vivait dans sa propre bulle sans prêter attention aux autres bulles, tout le monde écouterait aujourd’hui Taylor Swift ou Beyoncé… Mais à vous entendre, ce n’est manifestement pas le cas !
Kim Gordon — Mon avis, c’est qu’on n’est jamais sortis de la monoculture. Les monopoles n’ont jamais été aussi forts. Regardez Amazon, Spotify ou Live Nation… Alors même si chacun semble faire son truc dans son coin, c’est en fait guidé par des forces uniformisantes.
Gus Van Sant — Et ça fait longtemps que c’est le cas. Ça n’a jamais été facile d’exister hors système, mais aujourd’hui je crois que c’est encore pire.
Kim Gordon — Tout le monde veut devenir plus gros. Gagner plus d’argent. C’est l’obsession dans ce pays ! Moi j’ai une autre idée du succès…
Vous avez raison sur l’uniformisation induite par les plateformes de streaming (ça vaut aussi pour le cinéma), mais n’avez-vous pas l’impression que, sous cette monoculture, grouille tout un écosystème artistique foisonnant ? Un ami critique musical, qui écoute absolument tout, me disait qu’on vivait un âge d’or de la musique indépendante mais que peu de gens s’en rendaient compte parce que c’est devenu presque impossible de percer dans le mainstream…
Kim Gordon — L’essentiel de la musique contemporaine m’échappe, mais j’écoute beaucoup KCRW, la radio publique de Los Angeles [un mélange entre France Inter et Radio Nova], et je me surprends à y découvrir beaucoup de belles choses. Malheureusement je suis incapable de vous les citer parce que je ne note pas les noms, mais ça me rassure de voir que ça continue à bouger. Et sinon j’ai du respect pour Billie Eilish, qui est venue de nulle part avec un vrai truc original à défendre, avant d’exploser. Dans le cinéma, ça se passe comment d’après toi ?
Gus Van Sant — Dans le cinéma, “indie” est un terme apparu dans les années 1980 pour désigner des films fabriqués en dehors des clous, mais c’est très vite devenu un genre. Avec toute une économie qui s’est bâtie autour. Par exemple, je me souviens quand New Line est apparu. Au début, dans les années 1970, ils distribuaient des films de John Waters, des films étrangers, etc. Puis dans les années 1980, ils ont commencé à distribuer des petits films d’horreur, comme Freddy – Les griffes de la nuit, et à gagner pas mal d’argent. En 1991, c’est eux qui ont sorti My Own Private Idaho. Et puis au milieu des années 1990, ils ont été rachetés par Ted Turner (TCM, CNN…) qui a lui-même fini par être racheté par un plus gros poisson et finalement New Line n’est plus aujourd’hui qu’un label au sein de Warner Bros.
C’est en effet un destin emblématique de l’indie…
Kim Gordon — Il y a aussi la question du marketing. Fabriquer un disque ne coûte pas forcément cher, mais le distribuer ça reste compliqué. Et c’est là que les majors interviennent, parce qu’elles sont les seules à avoir les moyens de pousser ton disque dans les oreilles du public. Et c’est comme ça que beaucoup de groupes indé se retrouvent lâchés en rase campagne.
Gus Van Sant — Mais c’est exactement la même chose pour le cinéma ! Les sommes sont plus importantes dans l’absolu que pour la musique, mais le problème aujourd’hui des “petits films”, c’est qu’ils ne sont pas assez markétés pour avoir une vraie chance d’exister. Pour un cinéaste, il est plus judicieux de dépenser beaucoup d’argent dans la fabrication car, dans ce cas, le distributeur est obligé d’en dépenser autant pour le promouvoir.
J’ai moi-même fait des films de studio pour pas cher en pensant que ce serait vu comme un geste vertueux. Mais ce qui se passe c’est que ton film, même s’il est très réussi, se retrouve mis de côté, car il n’est pas logique de dépenser 30 millions pour promouvoir un film qui en a coûté 10. Ce serait irresponsable. Amy Pascal, qui était à la tête de Sony quand j’y ai fait Restless [2011], pour un budget de 14 millions de dollars, m’a dit à l’époque qu’elle ne savait pas quoi faire des films de moins de 50 millions… Je devrais juste dépenser tout cet argent, mais je culpabilise ! [rires]
Kim Gordon — C’est fou.
Gus Van Sant — Ceci dit, je remarque qu’il y a un retour des films à 10 millions. Notamment des films d’horreur, qui marchent bien. Avec la crise des salles post-Covid, ça semble plus judicieux. C’est soit des films à plus de 100, soit à moins de 10.
Cord Jefferson, qui a gagné l’Oscar du meilleur scénario adapté pour l’excellent American Fiction, a justement appelé les studios à faire vingt films à 10 millions (comme le sien), plutôt qu’un à 200…
Gus Van Sant — Et il a raison. Sauf que c’est beaucoup plus de travail pour un studio.
A24 semble précisément s’être créé sur cette faille, en produisant et distribuant les “petits” films que les studios ne veulent plus faire. Et ils sont en train de devenir gros, avec un calendrier de sortie hyper intense…
Gus Van Sant — Tout le monde veut travailler avec eux parce qu’en effet, ils parviennent à contourner le problème que je viens d’expliquer : produire cheap et distribuer large. Mais bon, ça ne change pas fondamentalement la donne et le vieux studio system reste en place.
Et comment naviguez-vous dans ce système ? Après la série autour de Truman Capote, allez-vous revenir au cinéma ? Ou continuer à faire des séries ?
Gus Van Sant — Je travaille sur plusieurs projets de films, mais je ne suis pas très avancé encore. Mon désir a été très fluctuant ces derniers temps et il commence juste à se stabiliser, je crois. Alors j’écris, et on verra.
Cette deuxième saison de Feud est essentiellement une œuvre sur l’inspiration, son caractère volatil, ses empêchements… Est-ce que ce sont des choses qui vous causent intimement ?
Gus Van Sant — Je ne fais jamais quelque chose si ça ne me cause pas intimement. Sinon on perd son temps et on le fait perdre aux autres. Un film ou une série demande tellement d’énergie…
Kim Gordon — Tu as grandi dans un milieu plutôt bourgeois, n’est-ce pas ?
Gus Van Sant — Oui, dans le Connecticut, dans un milieu très WASP, avec beaucoup de gens originaires du Sud, comme mes parents. Mon père était cadre pour une marque de vêtements de sport, McGregor. Et ma mère restait au foyer, attendant que mon père, qui prenait le train pour aller travailler à New York, rentre le soir.
Kim Gordon — J’imagine Mad Men quand tu décris ça.
Gus Van Sant — Oui, c’est exactement ça. Pendant les vacances d’été, mon père m’emmenait parfois à son travail, sur la Cinquième Avenue, en tant que stagiaire. Il nous arrivait d’aller déjeuner dans les restaurants chics du quartier et je pouvais alors observer la haute bourgeoisie new-yorkaise. Et c’est vrai que j’ai toujours fétichisé ça, cette espèce d’arène, avec ses grandes figures, ses controverses…
Kim Gordon — C’est fascinant. Tu devrais écrire un thriller psychologique.
Gus Van Sant — Je l’ai fait, figure-toi ! J’ai essayé de le faire produire par Jason Blum mais ça n’a pas marché. Peut-être que j’essaierai à nouveau un jour.
Est-ce que Ryan Murphy vous a laissé carte blanche ?
Gus Van Sant — Je ne dirais pas ça, parce que je devais respecter les scénarios, mais je ne me suis pas senti brimé non plus. Je connaissais un peu le scénariste, Jon Robin Baitz, et l’histoire de Truman Capote m’était familière. Quand Ryan Murphy m’a approché pour me demander si ça m’intéressait de réaliser plusieurs épisodes, j’ai dit oui mais à condition de tout faire – finalement j’en ai fait six sur huit, et c’était bien assez. L’expérience m’a beaucoup plu mais c’était harassant. Je le referai peut-être, si je trouve un sujet qui me passionne assez, mais pas tout de suite.
Bien que vous ne soyez pas auteur du scénario, la série vous ressemble profondément. Ce qui tend à confirmer le vieil adage de la politique des auteurs, théorisée par les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague lorsqu’ils étaient critiques aux Cahiers du cinéma, à savoir que l’auteurat réside avant tout dans les choix de mise en scène…
Gus Van Sant [sourire en coin] — Eh bien j’imagine qu’ils avaient raison…
Vous êtes accros au travail ?
Kim Gordon — Pour moi, c’est un mélange de paresse et de workaholism. J’alterne. Et je n’ai pas vraiment de hobby, à part voir des films. Mais j’aime bien m’ennuyer, ça me donne des idées. L’ennui ou les trucs traumatisants sont mes deux sources d’inspiration ! [rires]
Gus Van Sant — Je suis d’accord. Il faut s’ennuyer pour commencer à avoir des idées. Mais c’est presque un luxe aujourd’hui, avec les sollicitations constantes.
Kim Gordon — En tout cas, j’ai l’impression que notre époque n’aime pas la friction, le conflit, la dissonance. Quand j’étais jeune, c’est tout ce qu’on recherchait. Ce n’est plus vraiment le cas. C’est pour ça que je respecte la démarche de Beyoncé à défaut d’adorer sa musique : elle fait une sorte “d’intervention” sur la culture dominante blanche. Ça frictionne un peu.
Vous soulevez un paradoxe intéressant. Si la culture semble fuir la friction, c’est peut-être parce que la politique ne consiste plus qu’à ça. Aux États-Unis en particulier, on a l’impression qu’il y a deux pays qui ne se causent plus autrement qu’en entrant en conflit. Et effectivement, des gens comme Beyoncé, ou même Taylor Swift (qui a fait le chemin inverse de la country vers la pop), essaient de combler le fossé politique par la musique…
Kim Gordon — C’est vrai, mais elle n’y parviendra jamais complètement. Le cœur de la culture country est trop réactionnaire, elle ne le changera pas.
Vous la sentez comment, cette élection ?
Gus Van Sant — J’essaie de trouver des raisons de rester optimiste, mais la situation est hors de contrôle, complètement folle. Je n’ai jamais connu une telle division dans le pays. Et ça ne fait que s’aggraver.
Kim Gordon — Moi je ne suis pas très optimiste. Le parti démocrate me donne l’impression d’être un glacier qui fond lentement, et on ne peut rien y faire. J’aimerais que Biden se réveille et passe la main.
Mais à qui ?
Kim Gordon — Pas à Kamala Harris qui est encore plus impopulaire que lui, mais si c’était, par exemple, Gretchen Whitmer [la gouverneure du Michigan, qui figure parmi les nouvelles têtes du parti démocrate] qui était la candidate, je suis sûre que ce serait beaucoup plus excitant ! Biden a réalisé plein de bonnes choses sur le plan économique. Il a clairement soutenu les travailleurs et les syndicats. La rénovation massive des infrastructures sera bénéfique sur le long terme. Mais il a hérité de l’inflation due à la pandémie, et les citoyens ont parfois la vue courte, étant impatients d’avoir des progrès immédiats. Mais j’aimerais aussi que Biden arrête d’envoyer des armes à Israël. C’est non seulement immoral mais ça lui fait perdre beaucoup d’électeurs et lui fait risquer une défaite que personne ne peut se permettre. La planète ne se remettrait pas d’un second mandat Trump.
Kim, dimanche dernier, vous étiez invitée, à l’occasion de la 1ère édition du Los Angeles Festival of Movies, à discuter des films sur L.A. qui vous ont le plus marquée, en compagnie de l’écrivaine Rachel Kushner [Les Lance-Flammes, Le Mars Club]. De quoi avez-vous parlé ?
Kim Gordon — J’avais choisi six films : Model Shop [Jacques Demy, 1969], Le Privé [Robert Altman, 1973], Une femme sous influence [John Cassevetes, 1974], My Brother’s Wedding [Charles Burnett, 1983], American Gigolo [Paul Schrader, 1980] et Body Double [Brian De Palma, 1984].
Gus Van Sant — Je ne crois pas avoir vu Model Shop…
Kim Gordon — Ah non ? C’est magnifique, tu devrais. Jacques Demy est venu tourner ici à la fin des années 1960, sous contrat avec un studio mais en pur outsider. Ce qui me fascine, c’est qu’il a su capter la ville dans sa banalité. Il filme par exemple le coucher de soleil filtré par la pollution, le smog particulièrement épais à cette époque. C’est une lumière très particulière, très belle, mais qui m’angoissait quand j’ai grandi ici dans les années 1970. Il filme aussi le quartier de Venice Beach où le héros vit dans un petit appartement avec sa copine. Ils n’arrêtent pas de s’engueuler et il y a une tour de forage pétrolier juste devant chez lui. On l’oublie, mais ça a longtemps été glauque, Venice… Ça me rappelle un livre de photos de Wallace Berman où on voit la plage littéralement couverte de derricks.
Gus Van Sant — L.A. est une ville fondée sur le pétrole, oui, il y en a partout.
Le pétrole et le cinéma… Et la jeunesse, elle continue à vous inspirer ?
Kim Gordon — Ma fille, Coco, a 29 ans et c’est chouette de la voir grandir, de voir ce qui l’intéresse. Je lui montre des trucs dont, récemment, des films de Cassavetes. Elle me montre des trucs comme Selling Sunset sur Netflix… Sinon, j’ai fait dernièrement une entrevue sur TikTok, avec un duo de mecs qui se font appeler les Daft Hunks. C’était super. Et très court, c’était parfait ! Et puis comme ils avaient un ring light pour me filmer, la lumière était vachement flatteuse. [rires]
Gus Van Sant — Moi, j’ai un peu perdu le contact avec la jeunesse. J’ai toujours des amis jeunes mais je ne suis plus vraiment au courant de ce qui est cool [un de ses amis, la vingtaine, traine justement dans le salon, et Gus l’appelle à travers la baie vitrée]. Vin, viens voir. Qu’est-ce qui est cool en ce moment ?
Vin [hésitant] — Je ne sais pas trop… Vous, vous êtes cool ! Vous êtes indie et cool !
The Collective de Kim Gordon (Matador/Wagram).
Feud – Les trahisons de Truman Capote de Ryan Murphy. Sur Canal+ et sur MyCanal.