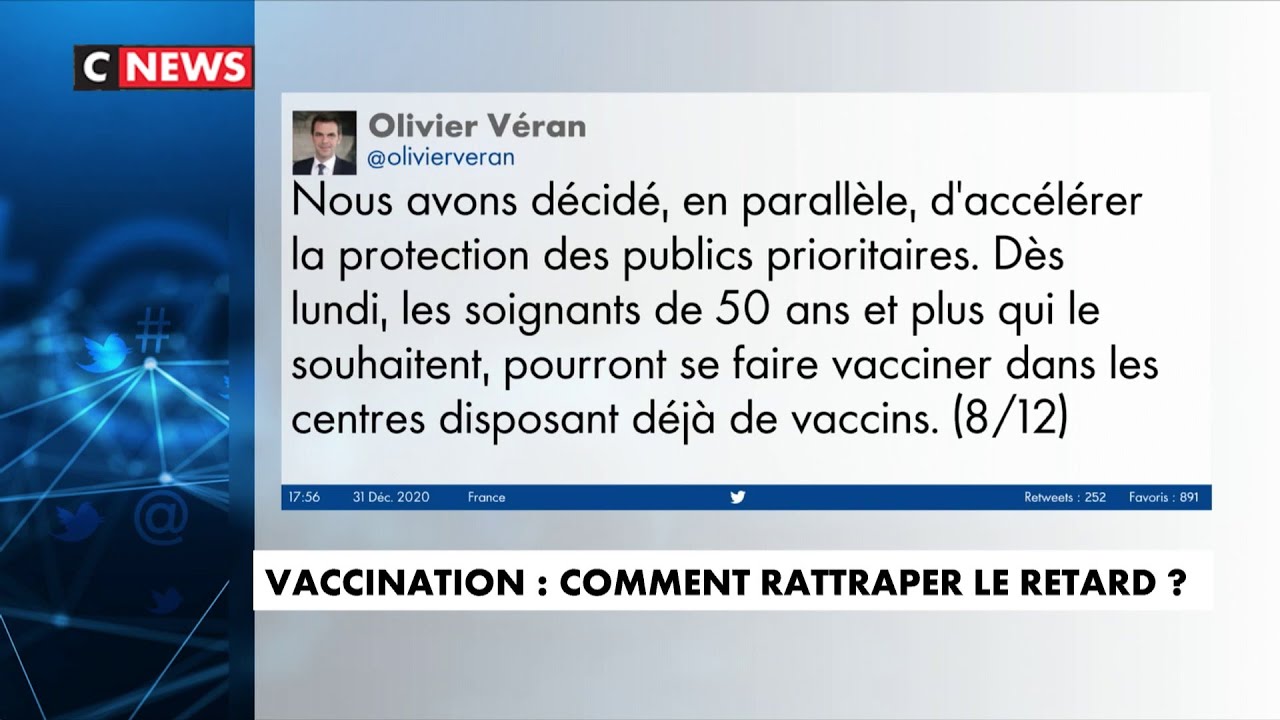“La mort du cinéma et de mon père aussi” ou la naissance d’un cinéaste
Asaf (Roni Kuban), aspirant réalisateur, convainc son père malade (Marek Rozenbaum) de jouer dans son 1er film : le récit d’un homme persuadé que Tel Aviv va être bombardée par l’Iran, allégorie tragi-comique d’une certaine paranoïa israélienne....

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Asaf (Roni Kuban), aspirant réalisateur, convainc son père malade (Marek Rozenbaum) de jouer dans son 1er film : le récit d’un homme persuadé que Tel Aviv va être bombardée par l’Iran, allégorie tragi-comique d’une certaine paranoïa israélienne.
Or dans la réalité, la menace est tristement plus prosaïque : le père de Dani Rosenberg est en phase terminale d’un cancer et a décliné le rôle qu’il lui offrait. L’œuvre se transforme alors en périlleuse mise en abyme où le cinéaste tente de retarder l’inéluctable.
La mort suspendueTout commence par une scène authentique dont l’âpreté est digne d’un Pialat. Rosenberg fait face à son père, épuisé, qui lui assène d’arrêter son film : “Tout ce que tu proposes est puéril (…) déconnecté de la réalité.” Comme pour répondre ironiquement à cette attaque, le réalisateur décide de faire de ce refus la matière 1ère de son long-métrage. La scène est d’ailleurs jouée plus tard par deux acteurs, mais cette fois-là, le fils a le droit à son temps de réponse.
C’est un dispositif complexe qu’installe le cinéaste, opérant un montage viscéral entre plusieurs matériaux hétérogènes : des scènes de fiction fantasmées – moments père-fils qu’il ne vivra jamais –, des anciens courts-métrages VHS dans lequel apparaît son paternel, des vidéos prises à la volée à l’hôpital ou encore des bouts de son propre film de mariage. Dans ce magma d’images chaotiques, qui mêle souvenirs passés et rêvés, le sens se trouve niché dans la collure : le fils se refuse obstinément à voir son père disparaître des plans qu’il avait imaginés pour lui, autrement dit, à disparaître tout court.
Au nom du pèreEn découle une œuvre hybride en lutte constante avec son sujet : la fuite en avant dans la fiction est sans cesse rattrapée par le réel. Quelques scènes à l’humour caustique parviennent tout de même à éclaircir le tout, à l’image d’un dialogue imaginaire où père et fils s’entendent sur la manière d’assassiner Netanyahu grâce à quelques pétards.
Rosenberg (qui apparaît sous les traits d’Asaf) a l’humilité de ne pas se donner le beau rôle : obsédé par son film-testament, il délaisse sa femme qui crie sa colère dans un monologue mémorable. Et comme pour prouver la bonne foi de son entreprise, il met entièrement à nu le dispositif filmique dans tous les aspects de sa fabrication.
Le cinéaste navigue à travers ses propres souvenirs au risque de perdre son spectateur. Son geste n’en reste pas moins extrêmement touchant dans ce qu’il traduit : l’impossibilité de figer le temps et de fixer une image nette de nos parents. Il n’arrive d’ailleurs pas à faire mourir ce père en héros et la maladie implacable finit l’œuvre à sa place. Dans cette lettre d’adieu hautement symbolique, le cinéma se meurt peut-être mais fait naître au passage un cinéaste prometteur.
La mort du cinéma et de mon père aussi de Dani Rosenberg, avec Marek Rozenbaum, Natan Rosenberg, Noa Koler, Roni Kuban (Israël, 2021, 1 h 40). En salle le 4 août.