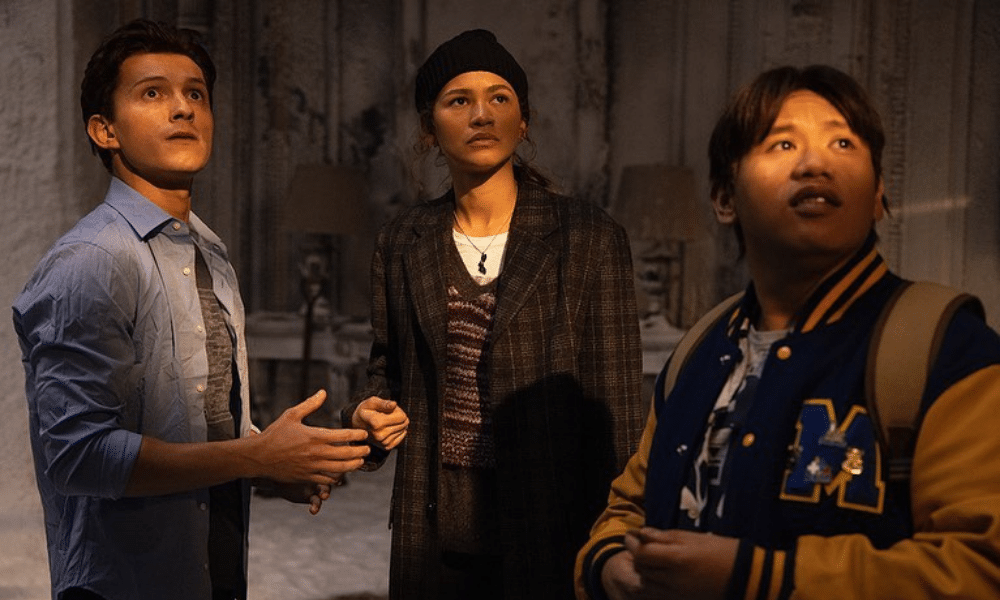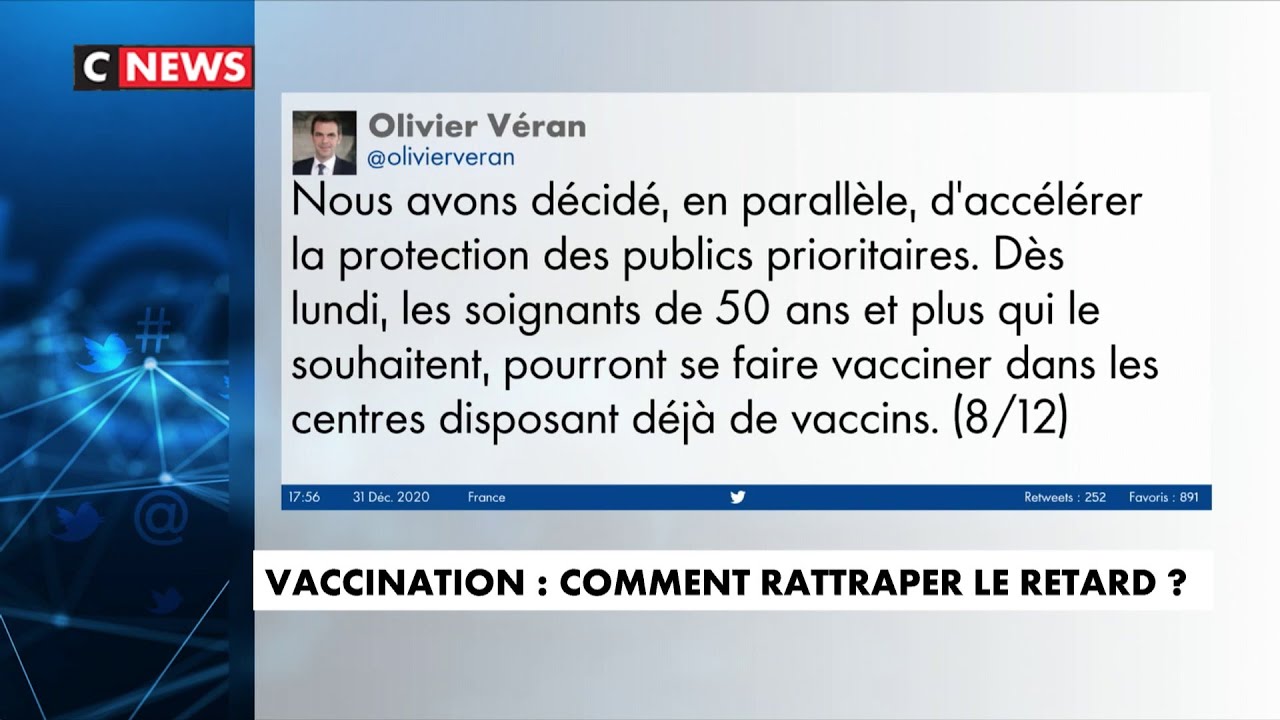“Le Grand Chariot” de Philippe Garrel : séparer la vie et l’œuvre ?
Quand certain·es d’entre nous ont découvert Le Grand Chariot de Philippe Garrel, le contexte différait largement. Bruno Deruisseau, au dernier festival de Berlin où le film a obtenu le Prix de la mise en scène, ou Murielle Joudet pour le numéro...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Quand certain·es d’entre nous ont découvert Le Grand Chariot de Philippe Garrel, le contexte différait largement. Bruno Deruisseau, au dernier festival de Berlin où le film a obtenu le Prix de la mise en scène, ou Murielle Joudet pour le numéro des Inrocks sorti fin août ont exprimé leur estime pour le film. Depuis, une enquête dans Mediapart publiée le 30 août dernier, a fait état des récits de plusieurs comédiennes qui ont tourné avec Philippe Garrel ou l’ont rencontré dans le but d’une collaboration. Elles relatent la façon dont elles ont dû faire face à des propositions sexuelles avec le sentiment que celles-ci conditionnaient une collaboration.
La date de publication de cette enquête, deux semaines avant la sortie du Grand Chariot, n’est évidemment pas fortuite. C’est la possibilité même que le film puisse être reçu isolément de ce contexte qui est visée – probablement pour faire un sort à cette dissociation homme/artiste qui reste un des arguments les plus usuels de celles et ceux qui, comme Alberto Barbera, le directeur artistique de la Mostra, considèrent que les accusations portées à l’encontre de Woody Allen, Roman Polanski ou Luc Besson ne doivent pas entrer en considération quant à la sélection de leur œuvre.
Fiction et réalité
De fait, quand on découvre Le Grand Chariot dans une des dernières projections de presse avant sa sortie, une dizaine de jours après la publication de l’enquête de Mediapart, il est tout à fait impossible de se dégager de ce contexte. Le film lui-même ne le permet pas. Il fait le récit de l’activité professionnelle d’une troupe de marionnettistes, portée par un patriarche vieillissant, et soutenue par ses trois enfants. Tous·tes trois sont interprété·es par les enfants de Philippe Garrel : Louis, Esther, Lena. C’est dire si la couche de fiction est grêle, si le film se nourrit de l’expérience biographique de son auteur et si le petit artisanat de la marionnette est une métaphore très peu sibylline pour le cinéaste de causer de son art, entre passion inentamée et avenir économique fragile.
Le film, comme nous en avaient prévenu nos collègues qui l’avaient vu beaucoup plus tôt, est très accompli. C’est sûrement le plus inspiré de Garrel depuis une dizaine années. Le retour à la couleur (l’image de Renato Berta, aux tonalités chaudes et sourdes est vraiment magnifique), la tenue d’un récit à la fois intimiste et très ample, couvrant une demi-douzaine de destins individuels en les articulant avec une belle fluidité concourent à faire du Grand Chariot une belle réussite, à rebours de deux ou trois films précédents de Garrel où quelque chose de la manière de son auteur semblait se calcifier. Mais en même temps qu’il nous fait éprouver son achèvement formel et sa beauté, le film agite en nous beaucoup d’autres sentiments, en résonance avec l’actualité à laquelle il se heurte : du trouble, de l’étonnement, de l’embarras, de la gêne.
Nocivité et rédemption
La nocivité masculine dans le film est tout entière concentrée sur un personnage : celui de Pieter (interprété par Damien Mongin). Pieter peint les décors des spectacles en attendant de pouvoir se consacrer à sa propre peinture. Dans le temps du film, il abandonne sa compagne, son fils qui vient de naître, son travail de peintre-décorateur, puis sa nouvelle compagne. La seule chose qu’il n’abandonne pas, c’est sa peinture. Mais il refuse tellement de la partager (avec des galeristes, des collectionneur·euses…) qu’elle ne lui permet pas de vivre. Pieter est une figure très sombrement romantique de l’artiste, destructeur, inattentif à l’autre, d’une telle exigence artistique qu’elle l’empêche de tout.
Certes le film se désolidarise de son personnage, lui oppose des figures beaucoup plus aimables d’artistes, celle de l’acteur polymorphe doué pour s’adapter et très aimant (Louis Garrel), ou celle de l’artisane marionnettiste intègre et responsable (Esther Garrel). Mais malgré tout, il l’absout dans une fin certes ouverte, mais où luit la promesse d’un pardon et où la jeune femme blessée, puis reconstruite, revient au chevet (en l’occurrence en visite dans un institut psychiatrique) de l’homme repentant qui l’a fait souffrir. L’aménité du film, et celle du personnage féminin, surprennent tant le personnage masculin semblait pris dans une spirale ravageuse. Mais le film préfère laisser une porte ouverte à la possible rédemption de l’homme nocif.
La douceur est dedans. La violence est dehors
Si le personnage de Pieter concentre la négativité, c’est pour mieux épargner la petite cellule familiale. À l’intérieur du clan, beaucoup d’amour et de respect circulent. De la solidarité. De la tendresse et du soin pour les ancien·nes (la figure de la grand-mère, interprétée par la grande Francine Bergé). Le sexisme, la violence, la domination viennent du dehors, du lointain même, comme cette allusion à un homme d’État accusé de violences sexistes qui conduit la fille cadette à aller manifester – torse nu, façon Femen, ce qui provoque l’amusement et l’empathie de la grand-mère. La douceur est dedans. La violence est dehors. Et le film qui orchestre symboliquement la disparition de son auteur (spoiler : le double fictionnel de Garrel, interprété par Aurélien Recoing disparaît au cours du récit) observe avec beaucoup de tendresse ces générations qui lui succèdent où le souci de la bienveillance à autrui prévaut.
Il y a tout de même dans le film l’esquisse d’un baiser non consenti. Mais son initiative vient à nouveau d’une personne extérieure au clan familial des marionnettistes. L’ancienne compagne de Pieter, après l’avoir quitté, trouve refuge chez ses anciens employeurs. Le fils de la famille (Louis Garrel) la recueille et lui propose le gîte. À deux reprises, possiblement dans un état de grande confusion, elle essaie d’embrasser le jeune homme. Lequel la recadre avec un impeccable discernement, en lui enjoignant de se reposer. Difficile en voyant la scène de ne pas être envahi par son contrechamp dans l’actualité, les accusations de baisers forcés et la façon dont le film en inverse les genres et en déplace la procédure.
Les coutures du spectacle
On se souvient qu’à la sortie de La Nuit américaine (Truffaut, 1973), Jean-Luc Godard avait mis en cause violemment le film en s’étonnant que dans cette description d’un tournage seul la figure du metteur en scène interprétée par Truffaut restait extérieure à la circulation chaotique du désir qui agitait partout ailleurs la petite troupe – alors même que selon Godard, dans la réalité des tournages de Truffaut, c’était le metteur en scène, insatiable séducteur, qui en profitait pleinement. En découvrant Le Grand Chariot, et indépendamment des qualités et des séductions du film, c’est précisément ce point aveugle de la création artistique qui nous perturbe. Quelque chose en dehors de l’œuvre gronde férocement et refuse de s’y faire entendre.
Une des plus belles idées de mise en scène est de filmer les spectacles de marionnettes depuis le derrière de la scène, révélant les coutures du spectacle, les gesticulations des marionnettistes agitant les pantins du bout de leurs bras. Mais ce que dit l’entrechoc violent de la découverte du Grand Chariot et des témoignages des actrices dans Mediapart, c’est que ce mouvement de dévoilement des coulisses du spectacle et de la fabrique de l’art n’est que partiel et qu’à un certain point, son opération s’interrompt.