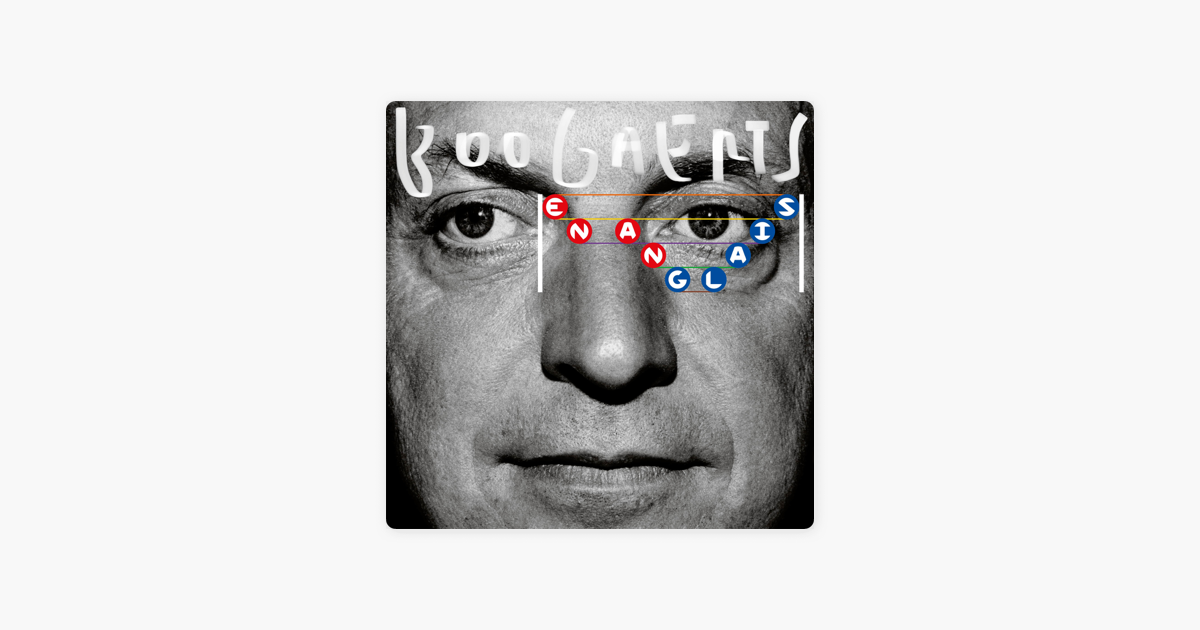Le label Awesome Tapes From Africa fête ses 10 ans : “J’étais ce mec avec une collection de cassettes cool”
Dans l’effervescence du Brooklyn des années 2000, Brian Shimkovitz, étudiant en ethnomusicologie à l’université de Bloomington, Indiana, montait un blog : Awesome Tapes From Africa. Une époque où, pour l’industrie musicale, Internet était un...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Dans l’effervescence du Brooklyn des années 2000, Brian Shimkovitz, étudiant en ethnomusicologie à l’université de Bloomington, Indiana, montait un blog : Awesome Tapes From Africa. Une époque où, pour l’industrie musicale, Internet était un far west pas encore bien régulé ; un monde sans plateforme de streaming, sans YouTube, un monde de pirates, en d’autres termes, mais propice à la découverte. Fasciné par les musiques venues des milieux interlopes des zones urbaines d’Afrique de l’Ouest, Shimkovitz met alors en ligne des dizaines de cassettes glanées à mesure de ses pérégrinations sur le continent africain.
Lassé de l’approche académique de sa formation de chercheur, qui a tendance à figer une musique vivante dans un marbre froid et étriqué, il lance quelques années plus tard un label et part à la recherche des artistes qu’il rêve de voir jouir de la renommée qu’ils et elles méritent. Du claviériste et accordéoniste éthiopien Hailu Mergia, au phénomène Ata Kak, Awesome Tapes From Africa, le label, remet sur le devant de la scène des artistes qui ne pensaient pas remonter sur scène un jour (ou monter sur scène tout court). Aujourd’hui, c’est la scène Amapiano, venue des townships d’Afrique du Sud, que Shimkovitz s’emploie à promouvoir, avec pas moins de trois albums consacrés à ce genre électronique qui embrase les chaudes soirées de Johannesburg à Paris. Une façon de marteler que son attention a toujours été portée sur la musique contemporaine. Rencontre.
On fêtait cette année les dix ans du label. Symboliquement, c’est un anniversaire qui représente quelque chose pour toi ?
Brian Shimkovitz – J’apprécie l’attention portée, mais je ne suis pas du genre à faire dans l’auto-célébration des choses. Je n’ai rien prévu de spécial pour fêter les 10 ans d’existence du label. En revanche, je pense que c’est une étape qui offre l’opportunité de se poser deux minutes afin de mesurer le chemin parcouru, de réécouter tous les artistes passés par cette écurie toutes ces années et, surtout, de réfléchir à ce que sera cette maison de disques dans le futur.
À quoi ressemblera Awesome Tapes From Africa dans le futur, dans ce cas ?
Cela pourra te sembler un peu basique comme réflexion, mais j’ai l’impression d’être le même type que j’étais il y a dix ans : je pense que regarder devant a toujours été mon objectif principal. Il y a des tonnes de musiques là, dehors, dans tous les genres possibles, traditionnelle, moderne, futuriste, ancestrale, toutes dispersées à travers la cinquantaine de pays qui constituent l’Afrique d’aujourd’hui. Il y a énormément d’artistes qui mériteraient plus de reconnaissance et énormément de gens qui ont envie d’écouter ces artistes. Le but est donc de continuer à travailler avec ces artistes, de les mettre en avant et de partager la musique avec un maximum de gens, en prenant acte que le monde est en perpétuel changement. Je m’estime heureux d’avoir pu faire tourner ce label pendant dix ans ; s’il est encore là aujourd’hui, c’est que nous n’avons pas perdu d’argent, que nous n’avons pas échoué dans ce projet et que les artistes sont payés pour leur musique, c’est qui est le plus important. Pendant la période pandémique, il y a eu une augmentation des ventes de disques, compensant pour certains artistes la perte d’argent due à l’arrêt des tournées.
Avant d’être un label, Awesome Tapes From Africa était un blog répertoriant de nombreuses cassettes que tu ramenais de tes voyages.
Quand j’ai lancé le blog en 2006, je sentais que la musique que l’on trouvait dans les boutiques et dont on parlait dans les revues n’était pas celle que j’avais découverte en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, malgré les rééditions, les nouvelles sorties, le fait que certains artistes tournent de plus en plus, j’ai toujours l’impression que nous, les pays de l’hémisphère nord au sens large, regardons encore les scènes musicales en Afrique par le trou de la serrure. À titre personnel, j’ai la sensation qu’il y a encore beaucoup à faire. Ces dernières années, outre la pandémie, j’ai moins fait le DJ et je ne recommencerai pas avant un moment, notamment à cause de l’inégale répartition des doses de vaccin en Afrique. Je me suis donc concentré sur la musique et sur les prochaines sorties du label. Je me suis notamment beaucoup intéressé à l’Amapiano (musique électronique venue des townships d’Afrique du Sud, NDLR). J’ai contacté quelques artistes, essayé de tisser des liens, aujourd’hui certains d’entre eux quittent pour la 1ère fois leur pays pour jouer à l’étranger. C’est grisant.
Il faut savoir qu’à l’origine, en tant qu’étudiant en ethnomusicologie, je me suis focalisé sur le hip-hop au Ghana. Ce qui m’a toujours guidé, c’est de guetter n’importe quelle trace d’émergence de musique orientée électronique qui pouvait surgir en Afrique. Certains disent qu’Awesome Tapes From Africa est un label de rééditions, si tu regardes de plus près, tu verras que ce n’est pas que cela. Avant même de lancer le blog, j’étais en quête de cet underground sub-culturel venu des grands ensembles urbains.
En quelques mots, pour ceux qui n’auraient pas suivi au fond de la salle, peux-tu revenir sur le moment où tu décides de faire de ton blog un label ?
J’ai étudié l’ethnomusicologie à l’université de Bloomington, Indiana. Pendant un stage chez Secretly Canadian (label, entre autres, d’Alex Cameron et Angel Olsen, NDLR), où je posais des stickers sur les disques, des trucs dans le genre, on m’a proposé de l’aide pour distribuer la musique que je répertoriais si jamais je voulais monter mon propre label. À partir de là, j’ai commencé à chercher des gens qui voulaient bosser avec moi. La raison pour laquelle j’ai voulu monter ce label est simple : après avoir tenu ce blog pendant des années, je me suis rendu compte qu’il y avait une audience significative, suffisamment significative en tout cas, pour me dire que les artistes qui étaient répertoriés sur le blog pouvait recevoir l’argent qu’ils méritent pour leur musique. Je dois dire que si Secretly ne m’avait pas aidé, cette histoire aurait été plus compliquée à s’écrire.
Tu étais établi à Brooklyn à l’époque, évoluant dans un contexte propice à la découverte musicale et à l’ouverture, un contexte dans lequel beaucoup de labels indépendants se montaient également.
Quand j’ai déménagé à Williamsburg en 2005, tous les gens que je rencontrais jouaient de la musique dans un groupe expérimental ou bossaient dans des labels indé et des lieux DIY. Beaucoup de ces gens m’ont encouragé et soutenu quand j’ai lancé le blog, parce qu’ils se sentaient inspirés par cette musique venue de si loin. Si autant de gens à Brooklyn pouvaient s’intéresser à ces musiques, alors pourquoi pas aux quatre coins du monde ? À l’époque, les artistes les plus importants de la scène indépendante étaient Animal Collective, M.I.A, des trucs comme ça. Des choses très valables, en d’autres termes. Culturellement, le nord semblait prêt à écouter des choses nouvelles, qui sortaient des sentiers battus de ce que l’industrie pouvait appeler “world music”.
Un terme qui était déjà remis en question depuis un moment à l’époque et qui, aujourd’hui plus que jamais, n’a pas plus aucun sens.
Évidemment. Parce que si un groupe français vient jouer dans un festival au fin fond des États-Unis, on ne va pas dire que c’est de la “world music”. Si Phoenix débarque demain, on ne dira pas que c’est un groupe “world”. Est-ce qu’on devrait dire que, du point de vue américain, Beethoven c’est de la “world music” ?
Penses-tu, avec ton blog, puis le label ensuite, avoir contribué à faire changer les regards sur les musiques venues du continent africain ?
Pour être honnête, je suis à la fois inconscient et conscient d’avoir contribué à mettre en lumière l’idée selon laquelle les gens pouvaient avoir une vision très restreinte que ce qu’on appelait alors “la musique africaine”. Inconscient, parce que j’ai toujours suivi mon propre intérêt musical, tourné vers la musique contemporaine, du hip-hop à la musique électronique, en passant par des choses plus classiques. Toutes ces cassettes dénichées en Afrique de l’Ouest figuraient au même titre que d’autres références discographiques dans ma discothèque personnelle. Je traitais ces musiques exactement de la même façon que les autres : je ne les mettais pas dans une case, comme si elles avaient quelque particularisme que ce soit, comme s’il fallait être un spécialiste pour en causer.
Conscient d’un autre côté, parce que j’étais en révolte, en quelque sorte, contre certains réflexes académiques qui avaient tendance à tout complexifier avec un jargon abscons dont les gens n’avaient que faire. Après avoir vécu un temps au Ghana pour mes recherches et fréquenté tous ces artistes, j’ai commencé à me dire que si je continuais ainsi à travailler, je n’agirais jamais vraiment pour eux, pour les gens. Je ne voulais pas me contenter de collecter des informations qui ne causeraient qu’à une poignée de chercheurs. Monter ce blog a été une façon pour moi de partager cette musique avec le plus de monde possible, dans un langage normal et accessible qui puisse causer à n’importe qui capable de lire l’anglais. Je n’étais pas non plus en guerre contre l’industrie, j’étais juste ce mec avec une collection de cassettes cool qui partageait de la musique sur Internet. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, il n’y avait ni plateformes de streaming ni YouTube.
En 2012, tu publiais une lettre ouverte dans les colonnes du magazine The Wire, dans laquelle tu évoquais le rôle de la cassette en tant qu’avancée technologique sur la distribution de la musique sur le continent africain. Comment les choses ont-elles évolué ces dix dernières années avec le développement des offres streaming sur le continent ?
Les cassettes sont partout en Afrique depuis les années 1970. De mon point de vue, basé sur mes récents voyages ces cinq dernières années, si tu cherches de vieux enregistrements, c’est toujours dans les petites boutiques de seconde main que tu vas les trouver. Ou encore, par hasard, dans un débarras à l’arrière d’une vieille boutique de revendeur de stéréos. Le prochain gros truc, et on en est déjà là, c’est la musique balancée en ligne. Cela va avoir, pour les nouvelles générations, le même impact que le marché de la cassette a pu avoir ces cinquante dernières années.
Malheureusement, le streaming sur le continent africain connaît des problèmes majeurs de débit et de suivi de flux. J’adore Bandcamp, parce que c’est une plateforme qui permet aux artistes de faire rentrer du cash. Mais, là encore, beaucoup de pays en Afrique ne permettent pas d’utiliser PayPal, ce qui a pour conséquence de placer certains musiciens hors des radars.
En parlant de distribution numérique, est-ce que trouver les auteur·rices et ayants droit de la musique que tu veux sortir est toujours un challenge pour toi aujourd’hui ?
Oui et cela a toujours été le cas. Déjà, parce que ce n’est jamais un champ clairement délimité et que l’on a souvent affaire à des disques sortis il y a des années, à une époque où une poignée de main faisait office de contrat. Ensuite, parce que dans ces pays, les sociétés qui organisent la redistribution des droits ne sont pas toujours très fiables, soit parce qu’elles ne sont pas bien gérées, soit parce qu’elles sont corrompues et ne représentent pas au mieux les artistes qu’elles sont censées servir. La meilleure technique que j’ai trouvée jusqu’ici c’est, dans la mesure du possible, d’aller sur la trace de l’artiste, travailler avec lui et faire en sorte qu’il touche ce qui lui revient de droit. Pour les jeunes artistes contemporains, on fonce en montant directement un deal avec eux. Les voir profiter directement des revenus générés par leur musique est un sentiment immensément satisfaisant.
On mesure l’impact du label en Amérique et en Europe, mais est-ce que tu mesures l’impact que le label peut avoir sur le continent africain ?
Tout l’enjeu du label est de créer des échanges d’informations et de générer des flux entre ces différentes aires géographiques, dans le but de vendre des disques et ainsi de faire du cash pour des artistes qui, dans un autre contexte, n’auraient pas l’opportunité de gérer cela eux-mêmes. Dans le même temps, je me tiens au fait de qui et où sont les auditeurs du continent africain. Par exemple, ces cinq dernières années, le blog est devenu plus fréquenté par les utilisateurs du continent. Je le vois aux données du trafic et aux commentaires. Au début, le trafic venait surtout de l’hémisphère nord, en gros, même si la diaspora à Londres, New York ou ailleurs y était sensible. Je me tiens au fait, pas dans le but de vendre plus de disques, mais pour m’assurer que la musique est bel et bien disponible partout.
Comment la pandémie a-t-elle affecté ta façon de travailler pour le label ?
Si la question est : est-ce que j’ai dû changer d’approche mentale quand j’ai sorti ces trois albums d’Amapiano d’affilée ? D’une certaine manière, oui. Mais seulement parce que j’ai senti que je pouvais, durant cette période, consacré plus de temps à savoir où étaient mes priorités. Je te donne cet exemple : l’album de Jess Sah Bi et Peter One que nous avons sorti en 2018 – de la country-folk de 1985, venue de Côte d’Ivoire. J’avais envie de les contacter depuis des années, mais il m’a fallu un temps fou pour retrouver leur trace. C’est un travail à plein temps, pas toujours compatible avec mon activité de DJ, à jouer chaque week-end quelque part loin de chez moi. Quand le virus a débarqué, que le monde s’est arrêté, je me suis dit que c’était une opportunité de me consacrer 100 % à certaines choses, sans me demander si ce que j’allais sortir allait être un succès ou non. C’est agréable d’être arrivé à ce point avec le label où je n’ai pas besoin de me poser ce genre de question. C’est idiot, mais dans la frénésie des choses, tu te rends parfois compte à la fin de la semaine que tu n’as pas assez de temps pour te poser et, juste, écouter de la musique. J’ai pu refaire cela avec le Covid-19.
Le paradoxe, c’est que tu n’étais plus sur le terrain pour aller à la découverte de ces artistes.
Oui, mais j’ai des milliers de cassettes dans mon placard, j’ai donc eu tout le loisir de prendre mon temps, réfléchir, écouté, être inspiré par tant de choses. Pour l’Amapiano, c’est différent, j’écoutais cela sur YouTube et sur les DSP. De toutes les révolutions des géants de la tech, l’invention de YouTube est peut-être la plus importante. Tu peux voir ce qui a le vent en poupe, ce qui a cartonné l’année précédente, ce qui va éclater dans les jours et semaines qui viennent. J’y ai vu tellement d’artistes prometteurs, qui n’avaient derrière eux aucun support promotionnel, à part une poignée de fans ! Des mecs comme DJ Black Low, par exemple.
Peux-tu revenir sur l’aventure Ata Kak, cet artiste venu du Ghana que nous avons eu la chance de croiser sur scène à Paris, Berlin, partout, après la réédition de la cassette Obaa Sima, en 2015 ?
Ata Kak est un musicien ghanéen. Je suis tombé sur une de ses cassettes en sillonnant les rues de Cap Coast, dans son pays au début des années 2000. Une cassette si étonnante qu’elle est devenue pour moi l’une des motivations pour monter le blog. Je l’ai cherché pendant des années, allant même jusqu’à traquer son fils à Toronto, au Canada. Quand j’ai enfin mis la main sur lui, je lui ai appris que partout dans le monde, les gens avaient aimé sa cassette. En plus d’être une inspiration pour mon blog, cette cassette est devenue le secret dance music le plus éventé, culte et populaire dont on parlait dans les milieux initiés. Un véritable phénomène. Il ne s’agissait pourtant que de sept titres. Après la réédition, Ata Kak est parti en tournée dans le monde entier, et c’était tellement cool ! Sa cassette est devenue en quelque sorte le porte-étendard du label.
Quels sont les enjeux aujourd’hui pour une meilleure diffusion de la musique venue du continent africain ?
Je pense que les gens en dehors du continent manquent encore de compréhension et de repères pour ingurgiter toute la diversité musicale du continent. Il y a des barrières linguistiques et culturelles, un certain racisme aussi. L’enjeu, c’est de rendre toute cette musique disponible, de passer l’information.
Propos recueillis par François Moreau