“Memories”, l’anthologie culte de l’animation japonaise pour la 1ère fois en salles
Auréolé du succès phénoménal d’Akira (1987), qui, au Japon, l’a érigé en demi-dieu, Katsuhiro Ōtomo, mangaka de renom devenu cinéaste acclamé, pilotait en 1995 un “omnibus” (une anthologie composée de plusieurs courts-métrages) qui ferait date...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Auréolé du succès phénoménal d’Akira (1987), qui, au Japon, l’a érigé en demi-dieu, Katsuhiro Ōtomo, mangaka de renom devenu cinéaste acclamé, pilotait en 1995 un “omnibus” (une anthologie composée de plusieurs courts-métrages) qui ferait date dans l’histoire de l’animation japonaise. Variations plus ou moins contournées sur le thème des souvenirs, Memories réunit talents montants et espoirs sûrs de l’animation nippone d’alors, dans un film de science-fiction tour à tour vertigineux, emprunt d’un humour noir corrosif, et bizarrement élégiaque.
Dans le 1er segment, réalisé par Kōji Morimoto et scénarisé par l’illustre Satoshi Kon – qui n’était pas encore l’immense cinéaste qu’il deviendrait deux ans plus tard avec Perfect Blue – , une équipe de cosmonautes chargée de nettoyer l’espace des débris flottants qui y dérivent reçoit un mystérieux message de détresse en provenance d’une station spatiale, a priori inhabitée. Deux membres de l’équipage s’aventurent dans l’immense carcasse à la recherche de la source du signal, et découvrent qu’elle abrite un étrange mausolée où sont compilés les souvenirs d’Eva Friedel, une soprano du siècle dernier qui a transformé sa station en un fastueux manoir à l’italienne, richement ornementé et entièrement voué à son propre mythe. Alors qu’ils avancent dans les couloirs dédaléens de cette station rococo, qui semblent animée d’une conscience propre, les deux cosmonautes perdent peu à peu pieds avec la réalité : passé et présent soudainement s’entrelacent, et des fantômes ressurgissent de temps oubliés.
Drôlerie macabre et angoisses millénaristes
Convoquant tour à tour Solaris, Shining et même Boulevard du Crépuscule (pour la mélancolie abyssale d’une star fanée, “vivant” dans les vestiges de sa gloire passée), Magnetic Rose est un joyau de l’animation japonaise, une excursion spatiale hallucinatoire qui préfigure les thématiques dickiennes que ne cessera de revisiter Satoshi Kon, de Perfect Blue à Paprika : effritement progressif de la réalité, infestation de la virtualité dans le réel, et confusion aliénante entre présent et souvenirs.
Stink Bomb, le deuxième segment, suit les tribulations de Nobuo, jeune scientifique d’un laboratoire pharmaceutique, qui, malgré le vaccin contre la grippe qu’il se fait inoculer, a toujours la goutte au nez. Un collègue lui conseille alors de prendre une pilule contre le rhume, que l’infortuné Nobuo confond avec des gélules expérimentales. Assommé par la double dose, il s’effondre sur place, et découvre, à son réveil, que tous les employés du laboratoire sont morts. En réagissant avec les molécules du vaccin, la gélule a transformé Nobuo en arme bactériologique. Précédé d’un nuage chimique à l’odeur pestilentielle, il va traverser la campagne japonaise, semant involontairement le chaos partout où il passe.
Tensai Okamura, qui signe la réalisation du court (sur un scénario de Ōtomo) jongle avec le soupçon d’acidité qui convient, entre drôlerie macabre et angoisses millénaristes. Encore une fois superbement ouvragé, Stink Bomb détisse, sous la forme d’une comédie noire à la terminaison particulièrement cruelle, les craintes (depuis vérifiées) de la société japonaise à l’orée du 21ème siècle, entre pressentiment d’une crise sanitaire globale, et angoisse latente d’une nouvelle catastrophe nucléaire. Une pandémie mondiale et un accident de Fukushima plus tard, la drôlerie se mâtine d’une intuition curieusement divinatoire.
C’est Ōtomo himself qui conclut son anthologie avec un tour de force formel : réalisé en un seul plan-séquence (bien que le terme puisse sembler impropre à de l’animation), Cannon Fodder suit la journée de travail d’un père ouvrier et de son fils apprenti dans une ville fortifiée qui ne vit que d’une seule activité, la guerre. Ingénieurs privilégiés, ouvriers besogneux, fabricants de munitions déclassés ou aspirants canonniers, tous les citoyens sont dévoués à l’entretien et l’utilisation des immenses canons qui constellent la ville, et tirent quotidiennement des missiles sur un ennemi invisible.
Fable quasi-beckettienne sur l’absurdité de la guerre, le segment d’Ōtomo peut rappeler les contes paraboliques d’un certain Hayao Miyazaki, chroniqueur inlassable de l’industrie humaine comme corruptrice de la nature virginale, douée de conscience et de rancœur. Mais si le père de Totoro, magicien animiste scrutant le monde à travers des yeux d’enfants, est le grand cinéaste de la nature et de la beauté sommeillant en toute chose, Katsuhiro Ōtomo est celui de la modernité dévoyée, portraitiste inquiet de futurs dystopiques, qui portent en eux les indices d’angoisses contemporaines. Chef d’œuvre de l’animation composé d’histoires en apparence dissemblables, mais finalement travaillé par des sujets voisins (la diffraction de la réalité, la prescience de catastrophes à venir et l’infinitude de la guerre), Memories en est la parfaite illustration.
























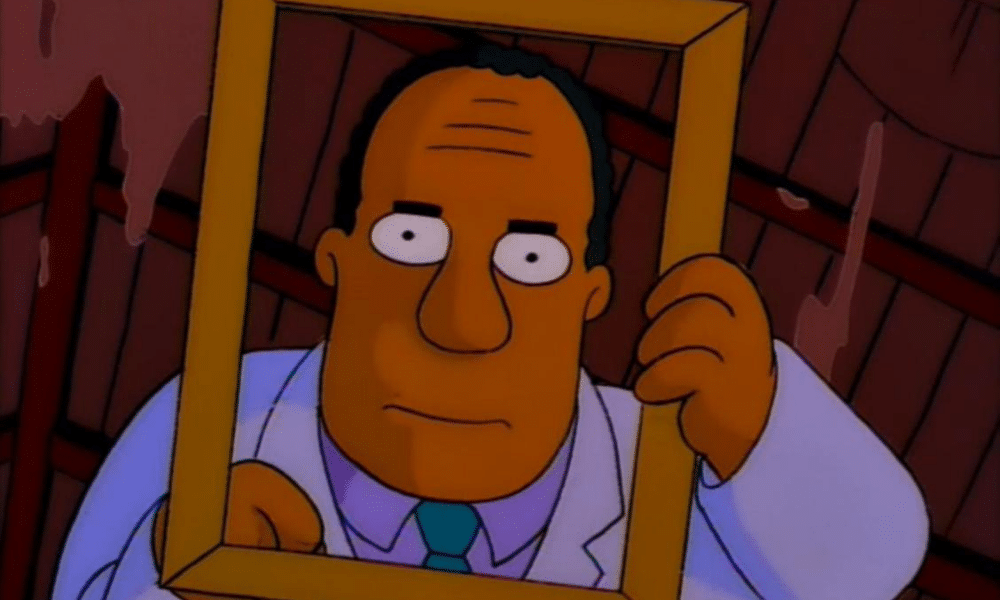



![[Exclu] PLK “Freestyle Dans les mains“](https://img.youtube.com/vi/7mAYfNrWloU/maxresdefault.jpg)
