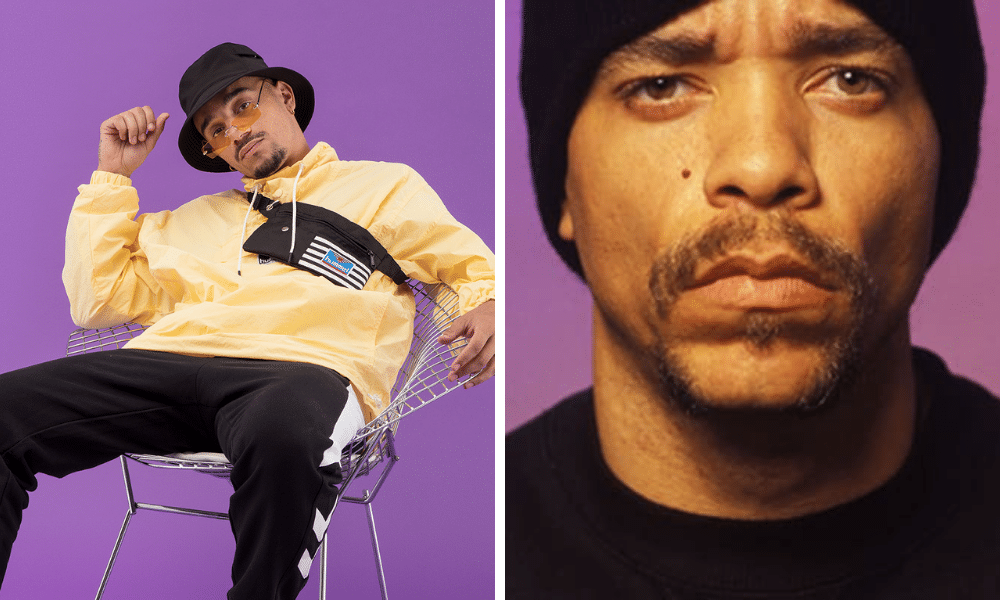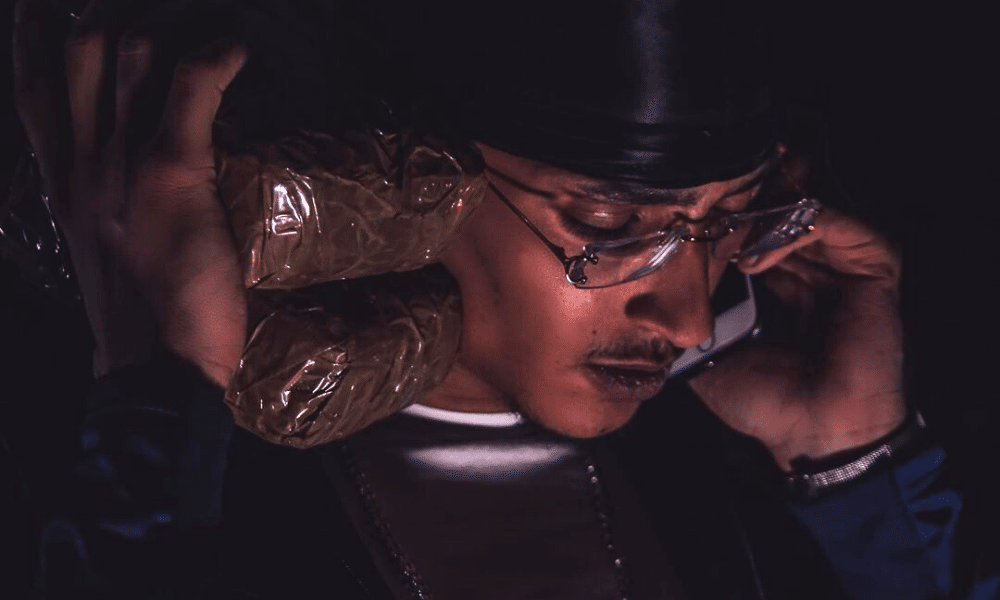Nirvana en 1991 (2/2) : “Nous sommes juste des punk rockeurs”
Il paraît que vous avez récrit la bio de Nevermind envoyée aux journalistes… Kurt Cobain — La biographie écrite par la maison de disques sentait un peu trop le renfermé à notre goût, un peu collet monté. Nous l’avons récrite nous-mêmes avec...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Il paraît que vous avez récrit la bio de Nevermind envoyée aux journalistes…
Kurt Cobain — La biographie écrite par la maison de disques sentait un peu trop le renfermé à notre goût, un peu collet monté. Nous l’avons récrite nous-mêmes avec pas mal de gros mensonges. Je suis supposé avoir été en art school et avoir quitté le lycée un mois avant les examens pour bourlinguer quelque temps avant de devenir punk rockeur à plein temps (sourire)…
Je suis aussi supposé être allé au Texas et à New York à 18 ans, alors qu’en fait, à cet âge-là, je n’avais d’autre envie que de rester à la maison, et essayer de monter un groupe. Nous avons inventé une bio où l’on se moquait des clichés du rock. L’un des plus fréquents étant que les musiciens aillent en art school.
La bonne blague a été de laisser croire que Krist [Krist Novoselic, le bassiste] faisait des tableaux de coquillages et que je trouvais ça génial. Je préfère la musique à l’art, elle me touche bien plus.
De quel milieu social viens-tu ?
Je viens d’une famille de prolos blancs, employés dans l’industrie du bois. On n’était pas vraiment pauvres, mais tout de même en bas de l’échelle sociale de la ville. J’ai eu une enfance merveilleuse, sans cris ni coups.
C’était comme dans Sesame Street [1, rue Sésame]. Ces marionnettes ont fortement influencé l’esprit des gamins de ma génération, au début des années 1970.
“J’avais plein de copains avec qui je m’entendais à merveille et la cellule familiale était très soudée”
C’était un programme extraordinaire pour les gosses, très innocent et très éducatif : à travers ces marionnettes aux personnalités attachantes, on apprenait à lire, à compter.
En plus, j’avais plein de copains avec qui je m’entendais à merveille et la cellule familiale était très soudée. C’était un véritable don de Dieu, comme s’il y avait un rayon de soleil chaque matin.
Le rêve américain…
Absolument. Et puis soudain, je suis devenu un adolescent caractériel et j’ai pris conscience que je n’étais entouré que de gens conditionnés pour travailler dans l’exploitation forestière, dans le commerce du bois.
Personne n’aimait l’art, personne n’aimait la musique. Je sentais que je ne pouvais me reposer sur personne… Au collège puis au lycée, je suis devenu un ermite. Je restais chez moi, j’écoutais des disques et je jouais de la guitare.
Ecoutais-tu ce qui passait à la radio ou des groupes américains plus durs, comme le MC5 ?
D’abord, j’ai écouté les Beatles et les Monkees, rien d’autre, jusqu’à 10 ans. Je n’aimais pas du tout ce que passait la seule radio qu’on pouvait capter, les Carpenters ou des trucs comme ça.
Ensuite, j’ai suivi mon père dans une ville de forestiers encore plus petite. Il y avait là des gars plus âgés que moi qui fumaient des pétards et écoutaient Aerosmith, Black Sabbath ou Led Zeppelin.
Lorsque mon père était absent, ils avaient l’habitude de venir me voir dans le camp de caravanes où on habitait. Ils ne se prétendaient mes amis que pour baiser leurs copines dans le lit de mon père, picoler et fumer…
Mais c’est eux qui m’ont fait découvrir dès l’âge de 10 ans une musique aussi bonne que celle de Black Sabbath, que j’ai écoutée religieusement jusqu’à environ 15 ans.
De 15 à 18 ans, durant mes années de lycée, je n’ai pas arrêté de bouger entre le patelin de mon père, Montesano, et Aberdeen. Et j’étais copain avec Buzz [Osborne], le guitariste des très mésestimés Melvins, qui me faisait des cassettes de punk rock. Etant plus vieux que moi, il pouvait aller à Seattle en voiture et fouiller chez les disquaires. J’étais complètement tributaire de lui pour découvrir de nouveaux groupes.
J’habitais dans ce patelin perdu d’où ma mère ne m’aurait jamais permis de partir… On était à trois heures de voiture de Seattle. Ce n’est que durant ma dernière année de lycée que j’ai été autorisé à y aller, avec les Melvins, pour écouter des concerts comme ceux de Black Flag. C’était vers 1984, 1985.
Tu n’as donc pas été au contact de groupes comme les Ramones ?
Non, j’avais 10 ans à l’époque. Les Ramones sont venus jouer dans un petit bar d’Aberdeen, ils ont vendu deux billets. A partir de 1985, je n’écoutais plus que du punk rock. J’ai abandonné les Beatles et les hardos. Et dans ma nouvelle peau de punk rocker, j’étais bien embarrassé de les avoir aimés.
J’ai quitté l’école et la maison de ma mère, je glandais chez l’un et chez l’autre, j’écoutais du punk rock et je me bourrais la gueule. Et j’allais voir autant de concerts que possible.
Pendant ton adolescence, voulais-tu déjà consacrer ta vie à la musique ?
J’ai toujours aimé la musique plus que tout. J’ai commencé à toucher une guitare à 15 ans, sans en jouer vraiment… Je voulais faire du punk rock sans avoir la moindre idée de ce à quoi ça ressemblait.
Je prétendais écrire une chanson punk rock sur ma guitare électrique sans savoir en jouer, simplement en la mettant à fond et en hurlant. J’espérais que c’était du punk-rock.
Mais lorsque je suis allé emprunter le Sandinista! du Clash à la bibliothèque, je dois avouer que je n’ai pas été enthousiasmé par ce disque censé être du punk rock. Les mois suivants, je me suis remis à écouter du heavy metal, Iron Maiden ou Motörhead…
Ce n’est d’ailleurs qu’après avoir monté le groupe que j’ai pris conscience que j’adorais la musique, même les vieux trucs. Et je me suis remis aux Beatles, mais aussi à Aerosmith et à toutes ces merdes heavy metal.
Avec The Clash, as-tu pris conscience que la rébellion du punk rock pouvait être véhiculée par autre chose que le bruit et la puissance ?
Ce qui a vraiment changé mon idée du punk rock, c’est le 1er concert de Black Flag auquel j’ai assisté. C’était incroyable. Je suis resté paralysé et, en même temps, attiré de tout mon être. C’était tout bonnement la chose la plus extraordinaire que j’avais jamais vue.
Il y avait tellement de passion, de haine, d’énergie que j’ai compris que je ne pourrais jamais faire un autre genre de musique que celle-là. C’était en 1984. Après, je suis devenu un vrai punk rockeur.
“On a décrété alors qu’on aimait des musiques très variées : les Beatles, Patsy Cline, R.E.M., enfin tout ce qui était bon”
J’oublie parfois ce que j’ai fait ces dix dernières années, mais ça, ça m’a marqué. A cette époque, j’habitais avec le bassiste des Melvins et j’ai enregistré une demo avec lui. Et puis j’ai rencontré Krist, il y a sept ans de ça.
Il a écouté cette demo et m’a proposé de monter un groupe. Et c’est comme ça que quelques chansons se sont retrouvées, une fois réenregistrées, sur le 1er album de notre groupe, qui était devenu Nirvana.
Après avoir fondé Nirvana, Krist et moi sommes allés vivre à Olympia. Là, grâce à Black Flag ou aux Butthole Surfers, il y avait une scène musicale depuis quelques années. On pouvait y jouer. On a décrété alors qu’on aimait des musiques très variées : les Beatles, Patsy Cline, R.E.M., enfin tout ce qui était bon.
C’était très positif de reconnaître enfin qu’il y a des bons groupes dans tous les genres. C’était juste avant l’enregistrement de notre 1er album. Et les Melvins, qui ont toujours été un de mes groupes favoris, m’ont aidé à progresser et à avoir des endroits où répéter.
Daniel Johnston aussi a été une influence.
Je connais ses disques depuis trois ou quatre ans, mais je ne sais rien de lui. J’ai entendu dire qu’il était fou et très heureux, sans qu’il sache quel état prenait le dessus ! Depuis cinq ans, je connais Calvin [Johnson], de Beat Happening, le fondateur du label K, dédié à la musique du genre de celle de Daniel Johnston.
Je connais bien tout ce que font ces groupes, et ce sont mes plus grandes influences depuis trois ans : Half Japanese, les Vaselines, les Pastels, Beat Happening.
Tous ces groupes ont une approche amateur, adolescente de la musique. Est-ce aussi ton cas ?
Absolument. Le rock est quelque chose de très adolescent. L’important est de se sentir à son aise, dans son monde. Peu importe que les gens apprécient ou pas ce que tu fais, du moment que tu le fais pour toi-même.
C’est pour ça que je respecte ces groupes : ils sont imperméables aux éléments extérieurs, et donc plus artistiques que la plupart des autres groupes, en particulier ceux qui font du rock à guitares. Les vrais punk rockeurs, ce sont eux.
Vous avez pourtant sorti votre 1er disque sur un label, Sub Pop, qui n’évolue pas dans cette sphère.
On ne savait même pas que Sub Pop existait quand on enregistrait nos demos. Elles sont arrivées par des chemins détournés chez Sub Pop, qui nous a aussitôt demandé de faire un album.
Mais on ne recherchait pas spécialement de label. Nous avons enregistré le disque avec ceux qui nous ont fait la 1ère proposition. Et notre album est sorti juste après celui de Mudhoney.
“Nous n’avions pas d’autre choix que d’aller sur une major”
Aviez-vous un contrat en bonne et due forme ?
Il n’y avait pas de contrat pour Bleach. A cette époque, ce n’était pas une préoccupation – ça l’est devenu lorsque nous avons eu du succès en Europe et que Sub Pop a commencé à s’intéresser au business. Nous sommes ensuite devenus – à l’échelle du rock indépendant – si importants qu’aucun label n’avait les moyens de racheter le contrat de Sub Pop, qui exigeait beaucoup d’argent.
Nous n’avions donc pas d’autre choix que d’aller sur une major. Mais Geffen est un label incroyable, ils savent ce qu’ils font. Et certains de leurs label managers connaissent très bien la scène underground.
La principale différence entre Bleach et Nevermind tient à la qualité du son du second album. Est-ce ce qui vous a rendus acceptables pour une major ?
Absolument. L’album était quasiment écrit avant qu’on ne change de label, puisque nous avions tenté de l’enregistrer un an après Bleach. Mais comme nous voulions changer de maison de disques, cette session a été mise aux oubliettes. Bleach avait été fini en moins de six jours, car on ne pouvait pas s’offrir de session plus longue.
Alors que là, on pouvait avoir le temps qu’on voulait et dépenser 1 million de dollars. Nous avons pris trois semaines, ce qui est ridicule compte tenu des budgets des majors. Nevermind a été fait en vingt-quatre pistes, par rapport aux huit pistes de Bleach, et avec le temps que nous jugions nécessaire.
Comment expliquez-vous votre succès, en particulier aux Etats-Unis ?
Franchement, je n’en sais rien. Geffen n’avait pas prévu de promotion intensive, ils n’ont pas investi d’argent sur nous. Ils se sont contentés de sortir Smells like Teen Spirit en 45t. Il se trouve que pas mal de programmateurs de radios commerciales l’ont mis sur leurs playlists.
La surprise, c’était d’entendre ce single sur une dizaine de grandes radios avant même que l’album ne soit sorti et le clip tourné. Ensuite, MTV s’est mis à passer le clip en boucle et ça a explosé. C’est la seule explication au succès.
Ce succès vous est-il proché par vos fans de base ?
Nous n’avons pas eu de réaction négative de la part du public. Probablement parce qu’il est comme nous : il aime la musique et se fout pas mal des clichés éculés du genre “un punk rockeur ne doit pas être sur une major”, ou “si Nirvana écrit une pop song, je ne les écouterai plus”. Cette attitude obtuse, ce manque de largesse d’esprit ne se retrouve pas dans notre public, qui est intelligent.
Bien sûr, quelques jeunes types nous ont traités de vendus, mais c’est compréhensible : quand on a 16 ou 17 ans et qu’on écoute du punk rock, on a un idéal très fort, qui devient même une identité. Mais cette réaction est marginale, puisqu’il n’y a pas eu de changements radicaux entre nos deux albums et que nous avons tourné sans arrêt. On est toujours agressifs, on joue fort. Et il faut dire qu’il y a une énorme différence entre les Etats-Unis et l’Angleterre.
Je ne suis pas convaincu que les groupes anglais sur des labels indépendants le soient pour de bonnes raisons : ils font trop confiance aux tabloïds, le NME ou le Melody Maker, qui sont des organes où les journalistes pensent plus à leur carrière ou à leur attitude qu’à la musique. En Amérique, le pays est si grand que même au top niveau des indépendants, il est impossible de communiquer sur une grande échelle.
“Ce succès renforce ma confiance dans les gens : je me dis qu’ils ne demandent qu’à aimer de la bonne musique”
On a besoin d’une major pour cela. D’après nos amis, il y a une vraie Nirvanamania en Amérique. J’espère que ça se sera un peu calmé à notre retour, qu’on ne deviendra pas malades, dégoûtés d’entendre nos chansons à la radio tous les jours ! (sourire) Il faut que je me prépare à affronter cette Nirvanamania.
C’est d’ailleurs la seule chose que je puisse faire… (sourire) Nous n’avions aucune prétention à devenir connus – l’idée qu’on puisse être dans le top 10 était la plus ridicule qui soit. D’un autre côté, ce succès renforce ma confiance dans les gens. Je me dis qu’ils ne demandent qu’à aimer de la bonne musique, quand elle arrive jusqu’à eux. Si les médias en diffusaient plus, les gens auraient meilleur goût.
Te sens-tu à l’aise dans ta nouvelle peau de rock star ?
Je me sens bien sûr coupable, parce que pendant des années j’ai été conditionné par les idéaux du punk rock selon lesquels il ne faut pas accorder de crédit aux groupes qui vendent beaucoup, à ceux qui sont sur une major.
Les gens de l’underground ont une attitude quasi raciste lorsqu’ils découvrent un groupe inconnu : ils se sentent investis d’une mission, le faire “exploser” sur une toute petite échelle d’initiés.
On peut se sentir fier de connaître Daniel Johnston alors que personne ne sait qui il est, mais c’est très triste. J’oscille donc sans arrêt entre les deux attitudes…
Es-tu concerné par le cliché du punk rockeur toujours soûl et déconnant en tournée ?
Je ne me bourre pas la gueule tous les jours, mais l’alcool aide quand on attend de toi que, tous les soirs, tu te vides les tripes. En tournée, on ne voit rien.
Je n’ai pas vu une seule des villes où nous avons joué. Les à-côtés d’une tournée, c’est absolument chiant : se trouver des heures durant dans un van, où ça remue tellement que tu ne peux même pas bouquiner ni dormir…
Pour décompresser, il n’y a rien d’autre à faire que de boire un coup toutes les heures, essayer de s’amuser. S’il y a trop de frustration, tu deviens stupide, agressif, tu casses des choses.
Tu mentionnes la lecture. Appartiens-tu à cette nouvelle génération de groupes hardcore intellos qui s’inspirent de bouquins ?
Je lisais beaucoup plus que maintenant. Certains livres m’ont marqué, mais je me base sur mes propres expériences, sur des histoires qui me sont arrivées ou que j’invente. Je me considère plutôt comme un écrivain – à ma manière et à mon échelle – au service de la musique.
Pour un groupe de votre genre, il est inhabituel d’écrire des chansons d’amour romantiques…
J’ai écrit des chansons dédiées à l’amour, mais sans cette espèce d’énergie confuse et négative. Cet élément apparaît dans quelques autres. Polly, par exemple, est une chanson d’amour très personnelle sur le viol.
C’est arrivé à une de mes amies : elle a été enlevée et violée par un type pendant des jours. Je lui devais cette chanson. J’ai mis du temps, je devais évacuer le traumatisme.
La musique existait avant le texte et elle était tellement mélodique et accessible que j’ai pensé qu’il lui fallait des mots âpres pour atténuer sa beauté. On a été accusés de promouvoir le viol, alors que c’est tout le contraire.
Un peu comme Steve Albini, qui a été attaqué à propos du nom de son groupe, Rapeman – il n’a jamais fait l’apologie du viol ! Il l’avait choisi pour sa connotation choquante. J’ai tout de suite trouvé que c’était un mot dominateur qui te faisait réfléchir sur le viol.
T’intéresses-tu au comportement violent typiquement américain, celui des serial killers, des psychopathes ?
Il y a quelques années, cette sorte de violence, celle des serial killers, m’intriguait, elle m’intéressait. Mais mon propos va plus à l’encontre de la violence du macho américain moyen, qui a un comportement de violeur : le stéréotype des pubs pour Budweiser, la façon dont ces types causent des femmes. Je m’attaque plus à ce machisme ordinaire qu’aux serial killers classiques qu’on met sur un piédestal à cause de leur étrangeté.
Territorial Pissings est une attaque frontale contre la violence ordinaire des machos, contre ces mecs qui picolent ensemble, se battent et pissent comme des animaux pour marquer leur territoire. J’étais constamment entouré de mecs comme ça – impossible de leur échapper, ils étaient toujours là.
C’est pour ça que j’ai mis longtemps à trouver des amis. Cela a rendu mon adolescence confuse. Je savais que je n’avais pas du tout ces tendances machistes, alors qu’on attendait de moi que je me comporte ainsi… C’est pour ça que je m’enfermais dans ma chambre la plupart du temps.
Avec le succès, n’as-tu pas peur de devenir une marionnette, un pur cliché rock’n’roll ?
Je crois sincèrement qu’aucun de nous trois ne peut être considéré comme un trou du cul – on ne se comporte pas comme les gus de Guns N’Roses. Je ne fais pas de croisade anti-Guns N’Roses, je me fiche pas mal de leur musique et d’eux-mêmes. Ils sont juste un exemple parfait de machisme et de cliché rock’n’roll.
Te sens-tu à l’aise dans ta génération ?
Oui, j’ai beaucoup d’empathie pour elle car je sais qu’elle a grandi dans le même genre d’environnement que moi. Je crois que les gens de ma génération n’ont pas été exposés à autant de violence que les enfants d’aujourd’hui.
Sans vouloir passer pour un philosophe de comptoir, il me semble qu’on vit à une époque où l’on se sent à la fois honteux et coupable à l’égard de la génération de nos parents, car ils étaient hippies et défendaient de grandes idées avant de virer yuppies hypocrites au début des années 1980.
“Les temps sont en train de changer”
Aujourd’hui seulement, on échappe à ce sentiment de honte vis-à-vis d’eux et on essaie de trouver notre propre identité. Ma génération a développé un comportement en réaction à l’hypocrisie de nos parents. Les temps sont en train de changer.
Tu t’es pourtant plaint de ta génération et de toi-même, qui ne vous intéressez pas assez aux grands problèmes du monde.
L’environnement est très différent de celui de la fin des années 1970, quand les groupes punk rock très engagés exprimaient leurs positions politiques dans leurs entrevues. C’est devenu tabou depuis quelques années.
Je ne me sens pas le droit de causer politique car, n’écrivant pas beaucoup sur le sujet, on m’attaquera, on me taxera d’opportunisme. Pourtant, j’ai des idées politiques très arrêtées et très claires dont je discute avec mes amis.
Je crois quand même que les groupes peuvent à nouveau exprimer ce qu’ils ont dans le cerveau sans passer pour des raseurs. D’un autre côté, les propos des groupes n’ont jamais eu beaucoup d’impact. Nous avons besoin de gens qui soient de vrais porte-parole, de leaders comme Abbie Hoffman [activiste anarchiste américain des années 1960, cofondateur du Youth International Party].
Dans les sixties, les groupes étaient politisés car il y avait des leaders politiques forts qui faisaient avancer les idées. On attendait des groupes un fond musical pour ces revendications. C’est plus difficile aujourd’hui.
C’est pourquoi j’ai beaucoup d’estime pour des groupes comme Fugazi, leur action est très respectable. Mais Nirvana n’est pas aussi impliqué, nous sommes juste des punk rockeurs.