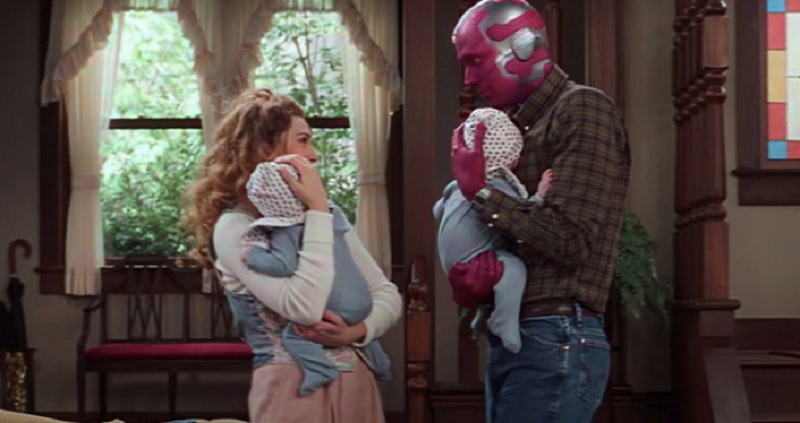Noémie Lvovsky : “Sur un plateau de cinéma, tout est plus intense que dans la vie quotidienne”
La Grande Magie est le huitième film réalisé par Noémie Lvovsky. Ce film est très beau, tout comme ce cinéma français artisanal qui réalise de merveilleux contes pour les grands et tente de les aider à supporter les drames de la vie, à se réparer....

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

La Grande Magie est le huitième film réalisé par Noémie Lvovsky. Ce film est très beau, tout comme ce cinéma français artisanal qui réalise de merveilleux contes pour les grands et tente de les aider à supporter les drames de la vie, à se réparer.
La réalisatrice-actrice nous explique ici comment elle a transformé une pièce d’Eduardo De Filippo en comédie musicale, son amour pour le théâtre et les acteur·trices. Elle nous explique aussi les petits secrets de Sergi López, les pouvoirs de l’imaginaire, pourquoi on peut préférer l’illusion à la réalité, être sur un plateau de cinéma plutôt que vivre dans la vraie vie, et l’importance du temps et de la mort dans son cinéma.
Pourquoi adapter cette pièce d’Eduardo De Filippo, acteur et auteur napolitain très connu en Italie, mais beaucoup moins en France ?
Noémie Lvovsky – Je ne le connaissais pas du tout alors que je vais assez souvent au théâtre et que j’aime beaucoup lire des pièces. Et il y a dix ou quinze ans, j’ai découvert La Grande Magie dans une mise en scène de Dan Jemmett, à la Comédie-Française. Et j’ai eu un vrai, vrai, vrai coup de foudre. Pas un coup de foudre qu’on peut avoir pour un texte génial d’un auteur génial qu’on ignorait. Un coup de foudre qui tape très profond chez moi, à des endroits très intimes, qui a un rapport avec le temps, la disparition… Au point que j’ai eu l’impression que De Filippo l’avait écrite uniquement pour moi (sourire).
Cette pièce touche à mes questions, mes angoisses, mes doutes, mes espoirs les plus profonds. Je suis allée voir le spectacle cinq ou six fois. Je me suis dit que j’avais très envie d’en faire l’adaptation, pour la 1ère fois dans ma carrière de cinéaste. Et puis je ne sais plus pourquoi, mais je me suis mise à écrire Camille redouble, etc. Après Demain et tous les autres jours, j’ai eu comme une crise de désir. D’abord parce que le tournage a été catastrophique. Je me disais que je n’aurais plus jamais le courage ni la force de refaire un film. Et c’est en repensant à la pièce de De Filippo, en l’imaginant en film musical, que mon désir de tourner a ressuscité, au centuple.
C’est une adaptation très libre ?
Oui. Déjà, il n’y a pas de chansons dans la pièce. Le personnage de Marta est très différent. Dans la pièce, elle est enlevée par un homme qui l’emmène à Venise. Ça me paraissait aberrant, elle était un objet et je voulais lui donner une autonomie. Je voulais lui donner de la chair, et ça passait par l’idée qu’elle voulait disparaître, parce qu’elle était malheureuse dans son mariage et non parce qu’un autre homme l’enlevait. Il y a d’autres modifications par rapport à la pièce, mais celle-ci est la plus importante. J’ai d’abord écrit le scénario avec Maud Ameline, puis je l’ai réécrit avec Florence Seyvos, avec qui j’ai écrit tous mes films depuis le deuxième.
J’aime beaucoup le film, et je trouve la fin magnifique (attention, spoiler alert). Parce que le personnage principal (joué par Denis Podalydès), qui était plutôt antipathique depuis le début, prend une autre dimension et devient grandiose quand il décide de préférer la fiction à la réalité.
Oui, parce qu’il choisit. Il décide de devenir fou, pour ne pas risquer de souffrir à nouveau d’amour, ou d’autre chose. Pour ne plus prendre le risque d’avoir le cœur brisé, il décide que mieux vaut l’illusion, la folie et la solitude. C’est une liberté. La folie n’est pas forcément triste. Pour lui, cette fin est terrible mais pas triste, parce qu’il préfère la vie dans la folie au chagrin mortel.
(Fin de la spoiler alert)
Mais l’histoire de la pièce, du film, cause aussi du temps et de l’amour, et du rapport entre eux, une question qui m’obsède. C’est la question des couches de temps dont on est fait·e, qui ne se superposent pas et s’entremêlent : le temps des horloges, le temps de notre corps, le temps de notre imagination, de nos désirs, le temps de nos rêves de nos cauchemars, celui de nos rêves éveillés, et puis le temps qui s’arrête. Qui ne s’arrête pas seulement pour la personne qui meurt, mais qui s’arrête aussi pour la personne qui aime celui ou celle qui est mort·e et qui lui survit.
Quand on perd un être cher, le temps s’arrête aussi pour nous, et pourtant on survit, et pourtant le temps continue. Le temps s’arrête à plusieurs moments, par la mort ou par un chagrin d’amour, une perte, une disparition. À part pour les deux saltimbanques que nous jouons, Sergi López et moi (qui sont liés par le temps, le travail, les disputes, les réconciliations, par l’amour de leur métier et de leur petite troupe, et par la précarité aussi), l’amour, pour les autres couples du film dont celui que forment Denis Podalydès et Judith Chemla, est lié au chagrin, à la perte, à la disparition. Et à la mort.
Le besoin de fiction et l’illusion aident à supporter la perte, le chagrin, la disparition… C’est comme les contes qu’on explique aux enfants pour les aider. Quand j’ai découvert la pièce de Filippo, je me suis dit qu’il me prenait par la main. J’espère avoir pris par la main l’équipe, les acteurs et les actrices, et j’espère que le film prendra par la main les spectatrices et les spectateurs pour leur faire ce qu’on fait avec les enfants, pour les aider à supporter la disparition, le chagrin, la mort : expliquer une histoire en les emmenant dans un monde de fiction, mais qui n’est pas sans vérité.
Pourquoi avoir choisi Feu! Chatterton pour la musique ?
Dès le départ, je ne voulais pas d’une musique des années 1920, donc de l’époque à laquelle se déroule le film. De la même façon que je ne voulais pas une reconstitution minutieuse. De toute façon, je n’en avais pas les moyens financiers (rire) ! J’avais envie d’une musique moderne. Je connaissais un peu le travail de Feu! Chatterton, mais pas si bien que cela non plus – je ne le savais jamais vus en concert, par exemple. Et puis par un concours de circonstances, nous nous sommes rencontrés, Arthur Teboul, le chanteur, et moi, parce que j’enseignais aux Beaux-Arts et que son frère cadet était l’un de mes étudiants.
On s’est rencontrés dans un café, par hasard, où nous avions chacun rendez-vous. Je le voyais de loin, je ne l’avais pas reconnu, je le trouvais beau, avec de la présence, et à la fin de son rendez-vous, il passe devant moi et me dit : “Bonjour, je crois que vous êtes la prof de mon petit frère.” Et on a sympathisé. Quelque temps après, j’ai appelé Feu ! Chatterton et je leur ai demandé s’ils voulaient bien lire le scénario. Tout de suite, ils se sont emparés du projet avec beaucoup d’enthousiasme et ils ont été très disponibles et généreux.
On a pu travailler très en amont du tournage, ce qui est incroyablement précieux. Je suis souvent déçue par la musique dans les films, généralement parlant, parce que je le trouve souvent plaquée. Cela vient du fait que l’on s’occupe souvent de la musique en dernier, dans le système de production d’un film. La musique, c’est souvent : “On verra après.” Je voulais que la musique de La Grande Magie épouse le film, même dans sa partie non chantée. On a commencé à travailler sur le film un an et demi avant le tournage, avec Feu! Chatterton. Et j’espère qu’on a réussi à ce que la musique soit organique avec le film.
Pour réaliser une comédie musicale, il faut toujours avoir la bande-son avant, non ?
Oui, mais c’est souvent une maquette. Là, nous avions tous les enregistrements finaux. Parce qu’on voulait du son direct : tous les acteurs chantent pendant les plans. Et puis je me disais : “De toute façon, en dehors de Judith Chemla, qui est aussi chanteuse lyrique, et François Morel, qui vient du music-hall, personne n’est vraiment chanteur ni chanteuse.” On s’est dit, avec l’ingénieur du son Jean-Pierre Duret : “Tant qu’à faire, autant avoir la chair, la vie du son direct, avec le souffle, les bruits de pas, le frottement de vêtements, l’essoufflement.” Et je suis vraiment contente de ça. Sur le tournage, on avait la musique dans une oreillette, et on chantait. Rien n’a été enregistré ou réenregistré en studio après.
Cela n’a rien à voir avec la façon de tourner de Jacques Demy, par exemple, ce qui fait que le résultat est totalement différent et qu’on ne pense jamais à un film de Demy, qui peut parfois être une figure, une référence pesante pour les réalisateur·ices français qui veulent faire une comédie musicale. D’abord parce que Jacques Demy faisait doubler tous·tes les acteur·ices ou presque par des chanteurs·euses, en studio. Mais ce que j’aime chez Demy, c’est qu’il intègre le studio d’enregistrement dans son cinéma. Il ne veut pas d’un son réaliste. Moi, j’avais envie d’un son réaliste, de nos maladresses. Je n’ai pas du tout choisi les acteur·trices en fonction de leur talent de chanteur·euse ou de danseur·euse.
“Ça me rend très heureuse de jouer, vraiment”
Vous avez réuni une sacrée troupe d’acteur·trices !
Je me suis rendu compte après coup que j’avais choisi beaucoup de comédien·nes qui viennent du théâtre. Que ce soit du théâtre classique (Denis Podalydès, Dominique Valadié, Christine Murillo, Micha Lescot, Laurent Stocker, Catherine Hiegel, Laurent Poitrenaux…), du music-hall (Morel, donc), ou du théâtre de rue (comme Sergi López).
D’ailleurs, quand on tournait la scène du spectacle, je sentais qu’il se jouait un truc super important pour Sergi. Et je ne comprenais pas quoi. Par exemple, il s’entraînait à faire des tours de magie, ce qui demande un travail presque plus grand, patient, que d’apprendre à danser ou à chanter, parce qu’il faut des années pour parvenir à réussir le moindre petit truc. Et je le voyais s’entraîner sans cesse et je lui disais : “Ce n’est pas grave si tu ne le fais pas parfaitement.” Mais il savait aussi que je ne voulais pas d’effets spéciaux pour les tours de magie (il n’y a qu’un moment où nous avons fait appel à des effets spéciaux, la scène du dédoublement du corps de Rebecca Marder, mais c’était évidemment impossible autrement). J’essayais de rassurer Sergi López, mais lui voulait accomplir parfaitement son tour.
À la fin du tournage, je me suis dit : “Mais évidemment, il a joué pour ses camarades de rue, pour ses amis de jeunesse, pour leur faire honneur !” Et j’étais très émue. Je ne lui ai posé la question que récemment, après qu’il a découvert le film terminé. Il m’a répondu : “Et oui” (sourire).
Pardonnez-moi mais vous oubliez une actrice : vous (rires) ! On connaît beaucoup d’acteurs et d’actrices, et parmi les plus grand·es, qui sont devenu·es réalisateur·trices, mais le contraire est très rare. Vous êtes cinéaste à l’origine, vous l’êtes toujours, mais vous êtes devenue une actrice très courue, qui jouez dans beaucoup de films. Quel rapport entretenez-vous entre ces deux activités ? Ça vous rend heureuse de jouer ?
Ça me rend très heureuse de jouer, vraiment. Ensuite, je suis aussi heureuse de ne pas avoir une vie d’actrice en dehors des moments où je joue. Je crois que je n’en aurais pas été capable… Jouer, ce n’est pas la même énergie que réaliser. Réaliser, c’est une énergie de marathonien, sur des années. Alors que jouer, c’est une énergie de sprinter. Même si quand on joue, on prépare son personnage seul·e ou avec les acteur·trices, et avec le réalisateur quand, par chance, il y a des répétitions. On le prépare en essayant les costumes, de plein de façons, en laissant le rôle infuser…
Mais jouer, c’est un art de l’instant. C’est au moment de la prise que : “schlack” (sourire) ! En France, les réalisateurs·trices écrivent ou coécrivent souvent leurs films. Donc c’est un travail qui dure sur des années : l’écriture, la recherche de financement, le temps de la pré-préparation, du casting, de la préparation, du tournage (finalement très court !), puis le temps du montage, du montage son…
Est-ce que le fait d’être actrice, ça aide à déplacer ses angoisses de réalisatrice ?
Peut-être. En tout cas, ça permet d’être sur des plateaux. Je suis très lente à l’écriture : au mieux, j’arrive à réaliser un film tous les trois ans. Quant tout va bien… Quand je joue, c’est un bonheur, presque une jouissance. C’est entrer dans le monde d’une réalisatrice ou d’un réalisateur, le bonheur de jouer avec les autres, le plaisir d’être avec une équipe. C’est merveilleux.
Ça permet d’échapper à soi-même ?
Ah oui ! Échapper à soi-même, oui, c’est vrai. Sur les plateaux, tout est plus intense que la vie quotidienne. C’est formidable de faire aussi l’actrice, parce que vous vivez cette intensité plus souvent que tous les trois ans (sourire).
Vous avez pris des cours de théâtre quand vous étiez enfant ou adolescente ?
Oui. Mes parents ne m’emmenaient pas au théâtre mais je lisais beaucoup de pièces. À onze ans, je crois, je me suis dit que le plus beau métier du monde était de dire ses sentiments avec les mots des autres. Les autres étant Musset, Molière et Tchekhov, qui étaient mes maîtres absolus (rire) ! J’ai donc pris des cours de théâtre, le mercredi après-midi, fait des stages d’été.
J’étais passionnée, jusqu’à mes quinze ans, où l’on m’a dit : “On est embêtés, parce que tu as l’âge d’une jeune 1ère mais pas du tout le physique d’une jeune 1ère. Tu as un physique de Zerbinette (une domestique des Fourberies de Scapin, ndlr.). Mais tu n’as pas l’âge d’une Zerbinette.” Et là j’étais tellement blessée… J’ai eu une espèce de vertige : “Ouh là là là là, c’est quoi ce métier où l’on me dit ce que je suis et ce que je ne suis pas et ce que je devrais être ?! Je ne veux pas de cette dépendance du regard des autres.” J’ai tout arrêté net. Et plus de vingt ans plus tard, Yvan Attal s’est mis en tête de me faire jouer sa sœur dans son 1er film en tant que réalisateur, Ma femme est une actrice.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Morain
La Grande Magie de Noémie Lvovsky, en salles.