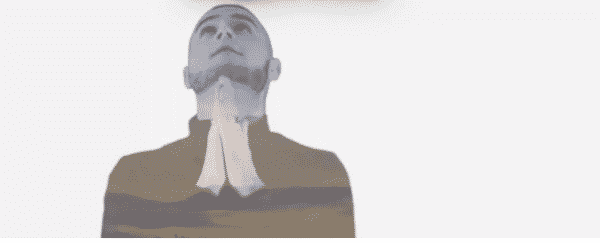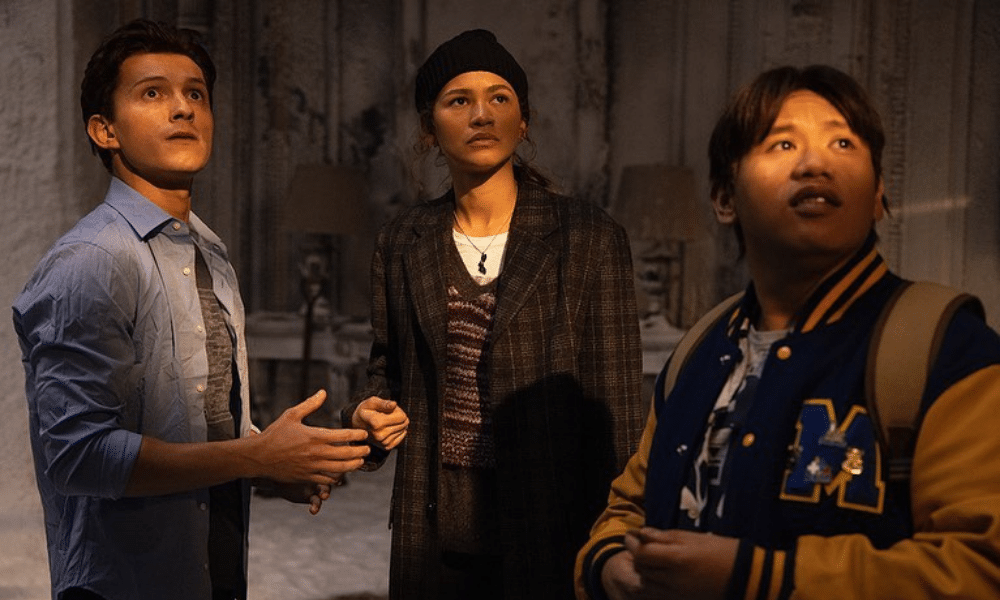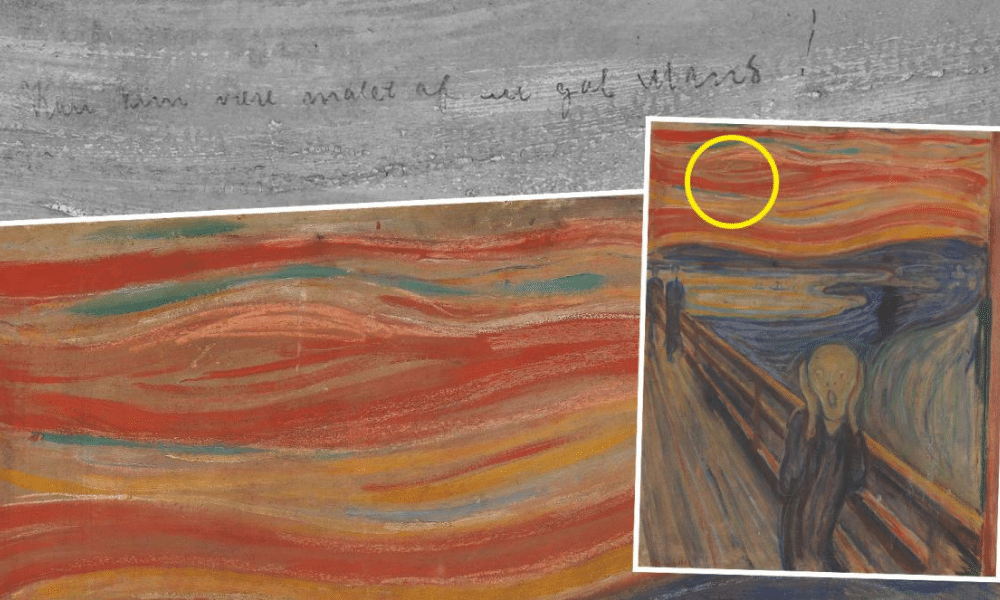November Ultra : “Raconter ses sentiments est considéré comme désuet, alors que ça fait du bien”
Nous sommes début 2021. Je fais partie du jury Avant-Seine du festival Rock en Seine, un tremplin de jeunes artistes. Parmi elles et eux, une jeune femme, November Ultra, et un morceau, Soft and Tender. Une balade folk à la guitare, dépouillée...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Nous sommes début 2021. Je fais partie du jury Avant-Seine du festival Rock en Seine, un tremplin de jeunes artistes. Parmi elles et eux, une jeune femme, November Ultra, et un morceau, Soft and Tender. Une balade folk à la guitare, dépouillée pour mieux toucher à la vérité du sentiment, qui nous entraîne dans cette chambre à coucher où November Ultra vit et compose ses morceaux, à Boulogne-Billancourt.
Ça, je ne le sais pas encore. Mais ce que je sais, immédiatement, c’est que ce morceau contient une écriture aussi singulière qu’universelle, une fragilité et surtout une voix, maîtrisée mais laissant filtrer une tendresse. C’est de la bedroom pop, comme on a coutume désormais de l’appeler, donc tout ce que je n’apprécie pas tellement – et pourtant, dans ce cas précis, ça marche. Peut-être car le moment est au câlin, à l’acceptation de ses faiblesses, au pansement de ses souffrances (non plus à coups d’alcool et de drogues mais dans une quête de spiritualité aussi effrayante que passionnante.) November Ultra et son esthétique (musicale et visuelle) si rose qu’elle en frôle le kitsch (mais qu’est-ce que le mauvais goût ? Où se situe le ridicule ?) dit plus que nulle autre quelque chose du moment que nous vivons, et de ce besoin de réconfort, lovés au creux d’une de ces cabanes que l’on construisait, enfants, à l’aide de couvertures et de draps.
November Ultra fait partie du tremplin final d’Avant Seine, et dans ce cadre, nous invite, une caméra et moi, dans son appartement, qui ressemble à une transposition physique de son album tant il contient de douceur. Sur son piano sont rangées les partitions des films de Jacques Demy, qu’elle affectionne en grande fan de comédies musicales. November Ultra a le don de mener une conversation à la fois personnelle et mélancolique, d’être très sûre d’elle-même sans jamais tomber dans l’arrogance, tout en ponctuant le tout de petites saillies humoristiques, suivies d’un rire qui claque.
Sur scène, il en est de même. À l’Hyperweekend, le festival organisé en février par Didier Varrod, directeur de la musique de Radio France, dans l’enceinte de la Maison de la radio et de la musique, November Ultra est seule et rythme ses morceaux mélancoliques, son 1er degré folk, avec un humour surprenant. De petites bouffées décomplexées qui assouplissent le rapport formel entre artiste et public, en créant une forme de complicité, tout en tournant en légère dérision le sérieux de ses morceaux qui s’attachent – eux – à expliquer l’éprise amoureuse.
Plus tard, c’est sur Zoom que nous la retrouvons. November Ultra enchaîne la promo pour la sortie de son 1er album, Bedroom Walls, avant un Trianon le 11 mai puis des passages dans les festivals estivaux. Un succès qui semble fulgurant. Paradoxal lorsqu’on sait qu’elle commença la musique il y a neuf ans, au sein du groupe Agua Roja ; évident lorsqu’on entend sa voix. November Ultra est déjà loin.
Comment as-tu commencé à travailler sur ton album ?
November Ultra – Tout a commencé en 2018 par le 1er morceau de l’album Over & Over & Over. Je pense qu’il est à l’image de la fabrication de l’album. Il y a quelque chose d’artisanal dans l’idée. Ça commence sur une note d’iPhone. On entend des gens qui font des travaux, une espèce de marteau. Toutes les petites voix qui s’y trouvent sont nées de mes doutes, de ces voix que j’entendais pendant que je créais et qui me faisaient douter de moi. Je les ai intégrées dans ce morceau, comme si je les embrassais, les accueillais. Elles faisaient soudain partie du tableau. Ensuite, il y a eu Soft and Tender. Et j’ai compris ma boussole : composer chez moi. Soit : faire quelque chose d’inconfortable, à savoir me faire face, dans une zone confortable. Le dernier morceau a été Bedroom Wall, qui a donné son titre à l’album. Il résumait l’importance de cette chambre à soi, que j’avais aussi hâte de quitter, quelque part.
Pourquoi avoir choisi de composer chez toi ? Est-ce le fruit du hasard ou un véritable choix de ta part ?
J’ai mis très longtemps à comprendre ma méthodologie. Quand on commence, on a tendance à faire comme les autres. À se dire qu’il faut être à 8 h du matin derrière son piano, qu’il faut bosser à mort. J’ai mis longtemps à comprendre que chez moi, tout tenait au spontané, à réussir à capturer un mouvement fugace. Il s’agissait donc de cadrer le spontané, de le retenir chaque jour. Je suis très imprégnée de l’environnement : la météo, la présence d’oiseaux. Je ne peux pas me dire : “Le mardi, je vais écrire de 10 h à 18 h.” Il faut que je puisse enregistrer n’importe quand. Il fallait que ce soit des lieux intimes. Donc, quand ce n’était pas chez moi, c’était dans la chambre des autres, ou dans une maison en Bretagne où je suis allée, avec Raphaël et Théo de Terrenoire, notamment. On avait mis le studio dans ma chambre.
Au moment de la réalisation, je savais que je ne voulais pas effacer les bruits annexes. J’aimais qu’on entende le lit crisser, que je ne sache pas bien jouer de la guitare… Cet album suit presque ma progression de musicienne. À la fin, je me sens très en paix. J’ai l’impression d’avoir compris des choses, alors même que j’ai commencé l’album en étant totalement perdue. J’ai su qu’il était fini car je ne pouvais plus écouter le 1er morceau. J’ai compris que je n’étais plus à l’endroit où j’avais été. J’allais commencer à enlever des choses, à tout changer. Donc il fallait le sortir, comme une photo instantanée qui a été prise.
Ta musique est intime. On a presque l’impression d’être dans ta chambre et de lire ton journal. Est-ce difficile de la partager ?
Ça fait partie du fait de créer de la musique. Je fais de la musique parce que j’aime chanter. J’adore chanter seule. Je n’ai pas besoin d’un public. Mais avec le temps j’ai compris que le partage était primordial. Le confinement a changé beaucoup de choses. D’un coup, il y a eu une attente. J’ai eu du mal avec le fait d’avoir attendu des années avant de chanter mes morceaux devant des gens. C’est une histoire d’alchimie. C’est presque comme s’il fallait que les deux éléments, le morceau et le public, se rencontrent très vite. Les réseaux sociaux ont été super salvateurs pour moi. Je n’ai pas dû attendre un an pour retrouver les gens. Une fois que tu as fait ton morceau, tu l’abandonnes. Tu le laisses au milieu d’un pont où quelqu’un·e va peut-être lui trouver une utilité, l’aimer. En concert, c’est méga fort, car on remet du sens dans chacun de nos morceaux, tous les soirs. Et les morceaux n’ont pas le même sens chaque soir. On ne ressent pas les mêmes émotions aux mêmes endroits. Je pourrais chanter devant le monde entier et ça n’aura jamais le même sens. Je pourrais aller au musée voir la même œuvre 600 fois et elle n’aura jamais le même sens pour moi. C’est la même chose. Je trouve ça fou. La notion de partage est réelle. Ce n’est pas un mythe. On ne chante pas en l’air !
Avec quoi as-tu composé et enregistré chez toi ?
J’ai un ordinateur, une carte son, un micro qui n’est pas trop mal, honnête, un filtre anti-pop (qui réduit les effets indésirables lors d’un enregistrement au micro, ndlr.), ma guitare et mon piano – que je ne peux pas brancher à l’ordi donc que j’ai enregistrés au micro. Le seul piano dont je joue bien, c’est le mien. Sur un autre piano, je peux devenir très gauche. De même pour la guitare. La mienne est un peu boursouflée. C’est une guitare classique espagnole. Mon piano, lui, est totalement désaccordé. C’est du matériel basique mais très important pour comprendre l’album, car tout mon noyau était là. Parfois, avoir moins amène de la précision. Mon instrument le plus important, c’est la voix, qui est le fil conducteur de l’album. Comment je peux créer des aspérités, des textures avec la voix ? Comment créer une carte postale émotionnelle ? Et puis je me suis ouverte à des artistes incroyables : Terrenoire (Septembre avec Raphaël, Incantation avec Théo), Nicolas Mantoux… que des artistes que j’aime beaucoup mais qui sont aussi des amis dans ma vie personnelle. Quand je vois les crédits de mon album, je me dis qu’il est incroyablement familier.
Tu chantes en anglais pour conserver une mise à distance du public français, qui ne va pas comprendre immédiatement les paroles ?
Une mise à distance de ma mère, à l’origine. Soit j’inventais une nouvelle langue pour écrire, mais je ne suis pas Tolkien, soit j’allais sur l’anglais. J’étais très timide et je n’avais pas envie que ma mère comprenne de quoi je parlais. J’ai donc chanté en anglais. Elle comprenait les mélodies mais pas les paroles. J’ai donc fermé la porte de ma chambre à ma mère avec cet album… La deuxième langue dans laquelle je chante, c’est l’espagnol, qui paradoxalement est la langue de ma mère… Il y a très peu de passages en français, qui sont donc d’autant plus mis en relief. J’ai grandi dans une maison où je parlais trois langues, avec la partie espagnole très exubérante et la partie française plus réservée, et l’anglais, qui est nouveau et excitant pour moi. J’ai aussi un master en linguistique. J’associe l’anglais aux livres et au dictionnaire. Il me permet d’exprimer ma pensée plus facilement, de façon plus limpide que mes langues maternelles.
Quelle est l’histoire de ton piano ?
J’ai fait le conservatoire. À un moment, une prof a encouragé ma mère à acheter un vrai piano pour remplacer mon synthé. Je suis fille d’ouvrier et ce n’est pas forcément facile d’acheter un vrai piano… Il allait leur falloir des années pour le rembourser. Donc une fois qu’il a été acheté, il y avait le sous-entendu, le non-dit de : maintenant qu’il est là, tu en joues. Il n’était plus question de renoncer. Le 1er jour, j’ai joué pendant 5 h. Je ne voulais pas le lâcher. Je n’ai pas été une pianiste incroyable. Moi, j’ai un truc fort avec la voix. Le piano, c’est moins viscéral, c’est plus un instrument doudou. J’ai un rapport très spécifique à mon piano. Je voulais un piano blanc. Ma mère m’avait dit : “Le blanc, ça se salit !” Je n’ai même pas eu le noir brillant, mais un piano d’occasion, en bois, cabossé. Il était déjà usé quand il est arrivé. Et c’est ce que j’ai aimé.
Dans le cadre d’un documentaire pour Deezer, je suis retournée dans mon conservatoire et ça m’a fait très bizarre. Ça a été dur, le conservatoire. Ils sont très rigides avec les enfants. J’ai fait beaucoup de concerts ces derniers mois, et pourtant, plus je descendais les escaliers du conservatoire, plus je devenais une petite fille très stressée… On m’a fait jouer sur un Steinway, celui sur lequel je passais mes examens. C’est un milieu qui n’est pas accessible à tout le monde. Il y a des connaissances, des spécificités. Un jour, la prof a dit à ma mère : “Vous avez quoi comme Bach chez vous ?” Et ma mère n’a pas osé répondre car elle se disait : “Un bac ?! Un bac de douche ?” On en rigole beaucoup aujourd’hui, mais j’ai compris depuis que ce moment-là était très dur.
Est-ce que ça a été d’autant plus compliqué pour toi de te projeter en tant que musicienne professionnelle ?
Ma mère me dit souvent qu’elle est fière de moi parce que j’ai réussi dans ce milieu sans connaître personne. Elle s’y attache beaucoup, au fait que les enfants d’ouvriers ne deviennent pas des artistes. Mais paradoxalement, c’est elle qui m’a emmenée toutes les semaines au conservatoire… Elle a passé son bac à 54 ans. Moi, j’ai accepté de faire des études car elle le voulait. Le déclic a été la maladie de mon père, qui a failli mourir. J’étais l’adulte référente. Quand il s’en est sorti, je me suis aperçue que j’étais plus forte que ce que je pensais, et que la vie est un soupir, comme on dit en espagnol : “La vida es un suspiro.” En un clin d’œil, tout peut s’arrêter.
Je me suis donc dit que je ne pouvais pas ne pas essayer de vivre cette vie dont je rêvais, quitte à me casser la gueule. J’étais déjà âgée pour l’industrie musicale. J’avais 33 ans au moment de sortir mon 1er album. L’âge du Christ ! Je ne me sens pas en retard, je suis dans mon temps à moi. Ma mère voulait que je sois avocate, que j’aie une belle vie avec de l’argent. Et c’est vrai, il n’y a que les gens qui ont de l’argent qui ne se rendent pas compte à quel point c’est important d’en avoir. Il faut un seuil minimum. Mais je n’aurais pas réussi ma vie autrement qu’en faisant quelque chose que je trouve incroyablement fort. À un moment, je me suis dit que je gagnais mieux ma vie que mes parents qui ont trimé toute la leur… Mon père a les poumons HS à cause de l’amiante… Je me suis sentie coupable de pouvoir potentiellement gagner plus d’argent avec un morceau passant à la radio que mon père en dix ans… C’est terrible. On a vu lors des deux 1ers confinements que les métiers qui font tourner le monde sont souvent les moins bien payés.
Quels métiers exerçaient tes parents ?
Mon père était chef de chantier. Son corps est cassé, comme malheureusement plein de gens dans le bâtiment. Et ma mère a été gardienne pendant des années. Elle avait très honte et n’a pas voulu que je le dise pendant des années, mais maintenant, elle est OK avec ça. Un jour, elle a fait une radio et on lui a demandé si elle avait eu un accident de voiture. Mais non, c’est juste le fait d’avoir ciré des escaliers à quatre pattes pendant dix ans. Ça prend sur ton corps. Faire de la musique reste un métier qui n’est pas sécurisant… Je ne me dis pas que je suis à l’abri. Mais je me sens très heureuse de faire ça. Ça fait niais, dit comme ça. Mais c’est vrai. Je me réveille le matin et la seule chose que je dois faire, c’est chanter.
Comment as-tu travaillé ta voix ?
J’ai travaillé ma voix en chantant, encore et encore. J’ai longtemps voulu “chanter comme”. En Espagne, les belles voix sont celles qui atteignent de hautes notes, comme Céline Dion, Mariah Carey. Je pensais que je devais chanter comme elles. Mais un jour, j’ai arrêté de vouloir les atteindre, ces hautes notes, et je me suis demandé à quel endroit je me sentais bien en chantant. J’ai trouvé ma propre tessiture. Chanter me procure une sensation très agréable. Petite, pour m’endormir, je chantais. Quand tu pratiques beaucoup quelque chose, ta voix se muscle. La voix est un instrument, certes, mais ce n’est pas parce que le la sur le clavier est toujours le même que ce sera le cas de celui dans ma voix… Il sera modifié par mes émotions, par l’environnement… Par exemple, je suis moins capable de chanter mon morceau Le Manège dans sa tessiture originelle car quand je l’ai enregistré, j’étais full happy, en plein court-circuit émotionnel. Si je veux retrouver cette tonalité, il faudrait que je travaille énormément ma technique, et j’aurais peur que ça use ma voix. J’en ai pris mon parti. C’est comme ça.
Pourquoi convoquer la valse dans le morceau Le Manège ?
On revenait de la plage et Lucas (Felower, ndlr.) a commencé à jouer une valse. Je me suis mise à danser avec Raphaël et tout de suite, j’ai chanté ce refrain. Raphaël m’a dit d’aller l’enregistrer. Et j’ai su que ça allait être une prise définitive, que je ne serais pas capable de la refaire plus tard… Moi je ne sais pas faire ça, refaire.
Il y a des carrières, des parcours qui t’inspirent ?
Bien sûr. Ce n’est pas tant de copier des carrières que de se sentir vivifiée par l’acte et le geste. Frank Ocean ou Rosalía par exemple, Bonnie Banane, Flavien Berger… Ce sont des artistes qui ont une telle liberté dans les gestes, tellement de panache, sans avoir froid aux yeux… Ça fait avancer le curseur du possible. La mixtape Nostalgia, Ultra de Frank Ocean, dans le fond et la forme, est magnifique. Il y a un truc là-dedans que je trouve très fort. On reste des artistes dans des cadres. Il y a des jeux que l’on joue. Mais la musique, à l’intérieur de ça, prime.
Les morceaux qui me font des trucs sont des prises de position très franches, très vraies. Sur le coup, c’est presque une gifle. T’es hébétée. Motomami (dernier album de Rosalía, ndlr.) m’a fait ça. Ce sont des choix forts. Et puis ensuite, c’est comme si, après la gifle, tu avais une nouvelle respiration qui te donnait une énergie… Ça me redonne un coup de jus. Bonnie Banane me fait cet effet. Contre-temps de Flavien Berger est un chef-d’œuvre. Ce ne sont pas des carrières exactes que je voudrais reproduire, mais j’espère réussir à avoir de tels moments de courage et de panache dans mes gestes musicaux.
Faire l’album m’a donné du courage en tant qu’artiste. J’ai été spécifique sur ma vision, je l’ai réalisé, je savais ce que je voulais. C’est comme un moulin : plus ça va, plus tu as confiance. Ce qui m’aide, c’est que je peux être tête brûlée. Une fois que je sais ce que je veux, que j’ai réfléchi, j’agis sans réfléchir. J’ai une volonté d’indépendance très forte. Quitte à ce que la voiture se prenne le mur, je veux que ce soit mon choix, que je sois derrière le volant. De même si elle reste sur la route. Je veux garder la certitude de mes choix. Certains demandent plus de temps que d’autres…
Ce sont aussi mes 33 ans qui me donnent la certitude des doutes. Une fois que tu as douté, que tu as questionné, tu obtiens une certitude que tu ne remettras plus en question. C’est souvent quand tu ne doutes pas, que tu ne te relis pas, que tu fais des erreurs. Le sens du détail se niche dans le doute. Je fais quand même une heure de concert seule sur scène et j’avais peur que les gens s’emmerdent. Et en fait, c’est assez. Je suis “assez” . J’adore ça, le fait d’être seule sur scène. La peur, c’est aussi quand tu ne fais pas quelque chose comme tout le monde le fait. Tu fais un choix. Tu as la solution de confort de suivre les autres, de suivre la solution qui marche. Moi je préfère tester, comme surmonter ma timidité et être seule sur scène.
Tu es pourtant drôle sur scène, il y a un côté stand-up dans ton concert !
J’adore connecter avec les gens quand je suis sur scène. Je suis assez bavarde finalement. Et tous mes concerts sont différents, je ne explique pas les mêmes choses et je ne suis pas toujours drôle. À l’Hyperweekend de France Inter, je n’étais pas très bien avant de monter sur scène. J’avais beaucoup travaillé et je me sentais stressée. Mais une fois sur scène, dans cette position de vulnérabilité, j’ai eu l’impression que les gens le sentaient et me prenaient dans leurs bras. L’Hyperweekend a été une bulle, un concert très spécial. Et puis j’aime mettre de l’humour, de la légèreté car je fais des morceaux deep… or la vie, c’est les deux.
C’est facile, pour toi, de faire un choix sur le plan musical ?
Quand tu n’as pas les compétences, il faut prendre le temps de l’apprentissage. Mon album ne m’a pas laissée aller plus vite que lui… Parfois, j’avais la moitié d’une chanson mais pas l’autre, car je ne l’avais pas encore vécue. Soit tu vis en frustration par rapport au temps, soit tu l’acceptes. Tu acceptes de ne pas avoir emmagasiné assez, de ne pas y être encore… Ça t’apporte la paix. Il faut savoir prendre le temps. J’aime qu’il y ait du silence dans mon set, qu’on prenne le temps de respirer. Ça fait neuf ans que je fais ce métier et je ne sors mon album que maintenant. Ça serait arrivé plus vite, ça aurait été différent, pas forcément mieux. Les gens autour peuvent peut-être me presser mais ma manageuse me comprend. Elle bouge les murs pour que je respire, que je termine. J’aime que tout puisse être bougé. J’aime la liberté qui fait que tout repose sur moi. Si ça merde, c’est moi. Le mauvais choix serait un choix qui irait à l’encontre de ce que je voulais faire à la base. C’est tout. Après, la vie est faite d’aléas… Mes pires mauvais choix sont ceux que j’ai faits en écoutant les autres…
Tu voues une passion aux comédies musicales. Tu te vois en reprendre sur scène ?
Ma vie, ma vie ! J’adore ! Ce sont des morceaux très durs à jouer… il faudrait que j’aie une partition et tout, on n’y est pas. Après, j’aimerais monter une soirée spéciale dédiée. Mais pas pour le moment. Pourquoi a-t-on autant de problèmes en France aavec les comédies musicales anglo-saxonnes ? Je me demande. Cette passion me vient de mon grand-père qui est espagnol. En France, on a Jacques Demy, qui a fait des films quand même très français. Depuis, malheureusement, il n’y a pas grand-chose… même si j’adore Notre-Dame de Paris, parue en 1998. Sinon, Les Chansons d’amour de Christophe Honoré, c’est une belle comédie musicale française. Il y a un côté désuet dans la comédie musicale, qui n’a pas beaucoup de second degré… C’est très 1er degré. On chante ses sentiments. Quand Soft and Tender est sorti, plein de gens étaient interloqués par mon 1er degré. Ça met mal à l’aise… On vit avec des carapaces… Donc expliquer ses sentiments est considéré comme désuet, voire niais. Alors que ça fait du bien.
Tu es très branchée réseaux sociaux, notamment Twitter où tu expliques ta vie, tes coups de cœur…
C’et aligné avec ma façon de faire de la musique. Si je n’ai pas envie, je ne me force pas. J’ai eu un blog musical pendant sept ans, donc c’est presque une seconde nature pour moi. C’est presque le contraire qui me semble étrange, le fait qu’on me dise que je poste beaucoup. Avec moi, il peut y avoir quinze stories en une journée, mais ce sont souvent des recommandations culturelles. Et je ne suis que des gens qui m’intéressent sur les réseaux, comme Pauline Darley qui est photographe. Elle a signé la pochette de mon maxi. Elle est d’une intelligence incroyable et elle a une passion pour les histoires, comme celle de Philippe de Bavière. C’est rare !
Propos recueillis par Carole Boinet.