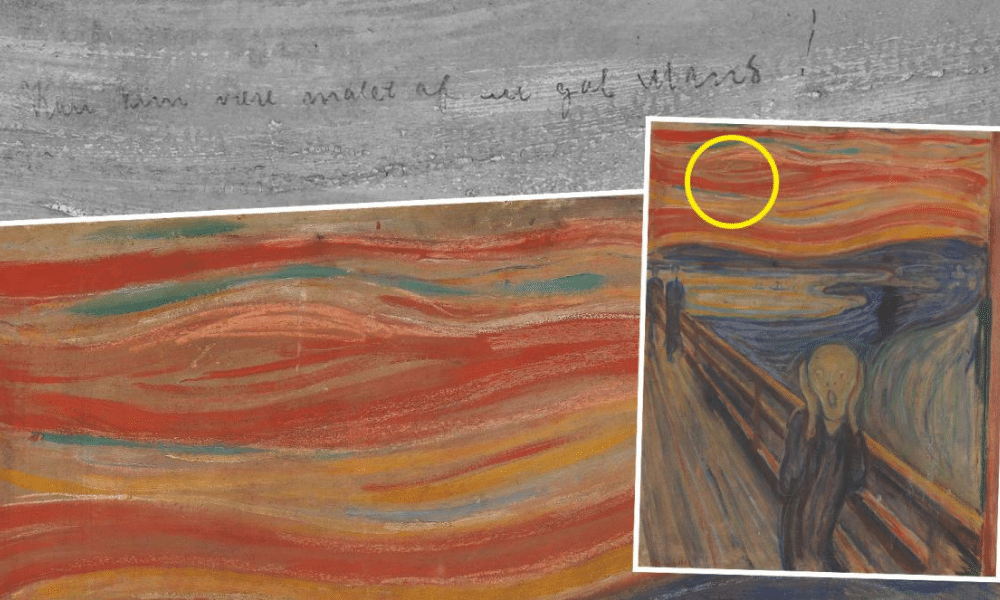Panda Bear et Sonic Boom : “On ne veut pas devenir un de ces groupes qui s’autoparodient au fil des albums”
L’un est le cofondateur d’Animal Collective, a collaboré avec les Daft Punk et Solange ; l’autre est parent de Spacemen 3, a été aperçu à la production des meilleurs disques de Beach House ou encore de MGMT. À deux, Panda Bear (alias Noah Lennox)...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

L’un est le cofondateur d’Animal Collective, a collaboré avec les Daft Punk et Solange ; l’autre est parent de Spacemen 3, a été aperçu à la production des meilleurs disques de Beach House ou encore de MGMT. À deux, Panda Bear (alias Noah Lennox) et Sonic Boom (Peter Kember, de son vrai nom), chacun échappé des formations qui les ont propulsés sous les projecteurs de scènes rock alternatif et psychédélique, explorent depuis plus de dix ans déjà les rivages d’une pop hallucinée et expérimentale. Forts de carrières qui mériteraient un article à part entière pour en énumérer les coups d’éclats respectifs, comme d’une collaboration qui a déjà prouvé sa constance qualitative, les deux artistes reviennent dans une entrevue fleuve sur la genèse de ce dernier LP.
Voilà dix ans que vous collaborez ensemble, particulièrement autour de la discographie de Panda Bear, dont Peter a produit deux albums avant celui-ci. Qu’est ce qui vous a motivé à remettre le couvert ?
Panda Bear — Je pense que cet album est à part dans ma discographie, enfin c’est une élaboration du travail qu’on a déjà fait ensemble. On s’est rapprochés depuis Tomboy [le 1er album de Panda Bear produit par Sonic Boom, 2011], et faire ce disque était un peu une étape inévitable de notre collaboration.
Sonic Boom — On n’avait pas spécialement prévu de sortir quelque chose, mais ça s’est comme imposé à nous. Je pense qu’on a à peu près la même approche de la musique qu’on a déjà produite ensemble : on aime collaborer et on essaye de renouveler notre formule pour ne pas se répéter. On ne veut pas devenir un de ces groupes qui s’autoparodient au fil des albums.
Il paraît que chaque titre s’articule autour de samples issus de morceaux des années 1960 à 1980. Comment est venue cette idée ?
SB — Le déclic, ça a été le déménagement au Portugal. C’était en 2020, avec la pandémie et les confinements, on a eu pas mal de temps. Assez naturellement, je me suis replongé dans des vieilles galettes que je n’avais plus trop l’habitude de sortir de leur étagère. En les réécoutant, j’ai porté une attention particulière au début des morceaux, je me suis mis à chercher les moments catchy qui te font rentrer dans une musique. Je les ai répertoriés avant de les isoler et de les passer en boucle. Ces passages ont une énergie particulière que je voulais capturer. Je pense que c’est cette démarche qui caractérise le disque : recontextualiser la substance captivante de morceaux pré-existants.
C’est drôle de se concentrer sur l’intro des morceaux, d’autant que c’est rarement un moment de climax… Ça vous obsède depuis longtemps ?
SB — Pas vraiment…. J’ai une sensibilité différente aux morceaux qui ouvrent un album, par rapport aux intros de morceaux. Mais dans les deux cas, je trouve que c’est là qu’on peut trouver le plus de folie, des effets psychédéliques ou des sons rembobinés… Quand c’est bien fait, c’est quelque chose que j’adore.
PB — C’est comme une accroche, quelque chose qui s’immisce dans ton cerveau et mobilise ton attention. Quand tu y es réceptif, ça peut apporter beaucoup à l’expérience de l’album.
SB — Tous les deux, on a une approche particulière à la composition. Le début d’un morceau est toujours à part du format couplet-refrain, et on a l’habitude de s’en emparer pour développer un espace de liberté qu’on n’aurait pas plus tard.
“On a une approche particulière à la composition. Le début d’un morceau est toujours à part du format couplet-refrain, et on a l’habitude de s’en emparer pour développer un espace de liberté qu’on n’aurait pas plus tard”
C’est plutôt parlant, quand on pense à des titres comme Mr Noah ou les morceaux de Person Pitch… En fait, chez vous, on sent une remise en cause de la totalité du format d’un morceau.
PB — Ouais, c’est une chose avec laquelle je bassine Peter depuis des années : l’idée de morceau sans couplet, où le refrain s’étale tout du long. Je ne pense pas avoir réussi à craquer le code, mais j’ai le sentiment de m’en être approché sur le morceau que j’ai enregistré avec Alan Braxe et DJ Falcon [l’immanquable tube Step By Step] cette année. Enfin, ce n’est pas tant qu’il n’y a que du refrain, mais plutôt qu’il se mélange constamment avec le couplet, les deux arrivent en même temps… Je suis assez fier de ça.
>> A lire aussi : Alan Braxe et DJ Falcon en pleine French Touch
Sur un aspect moins théorique, l’album sonne aussi différemment de vos précédents efforts communs. Dès la 1ère écoute, j’ai été marqué par la délicatesse des productions, la douceur de votre palette sonore…
SB — C’est quelque chose vers quoi on tendait consciemment : je voulais que l’album sonne exaltant… C’est toute cette idée d’énergie, qui vient des intros qu’on a samplées. Je me rappelle, à la fin des sessions de Panda Bear Meets the Grim Reaper (2015), Noah m’avait dit vouloir articuler son futur travail autour de quelque chose de minutieux, dans une démarche assez minimaliste. C’est cette attention qui définit Reset à mes yeux, et qui nous permet de ne pas nous répéter.
Vous avez tous les deux été occupés ces dernières années : Peter avec le revival de Sonic Boom et le faste All Things Being Equal (2020), Noah avec l’album d’Animal Collective (Time Skiffs, 2022) et la collaboration avec Alan Braxe et DJ Falcon… Où avez vous trouvé le temps d’enregistrer Reset ?
PB — Ça a été un projet au long cours. On s’y est vraiment mis à la fin de l’été 2020, il me semble, pour terminer…
SB — Environ un an plus tard ? Je me rappelle avoir terminé le mix en septembre dernier, fin 2021. Il y a eu énormément d’allers-retours sur cette période, notamment parce qu’on a mis du temps à réaliser que les morceaux sur lesquels on travaillait allaient finir par marcher en tant qu’album.
PB — Il a aussi fallu que j’insiste pour que Pete chante (rires). Après cinq ou six sessions, je me suis dit qu’on gagnerait en énergie avec une voix supplémentaire.
SB — J’étais un peu réticent, comme je venais de sortir All Things Being Equal qui m’avait pris pas mal d’énergie. Mais j’ai réussi à trouver quelque chose de particulier à insuffler à ce disque. Encore une fois, tout ça a pris son temps – on s’est posé la question après avoir enregistré une demi-dizaine de titres, ce qui est satisfaisant, comme je trouve que l’album donne une cohérence plus générale aux morceaux. Je me rappelle m’être dit, en écoutant le résultat final en studio, que ça ressemblait à une espèce de comédie musicale… (rires) Enfin, quelque chose de narratif, comme un dialogue. J’aime voir ça comme un acte manqué.
“On a mis du temps à réaliser que les morceaux sur lesquels on travaillait allaient finir par marcher en tant qu’album”
C’est difficile de différencier vos voix… Vous aviez déjà l’habitude de chanter ensemble ?
SB — J’ai passé du temps à faire fondre nos voix l’une dans l’autre ! (rires) Je voulais que le mélange sonne comme du vocodeur par moment, arriver à un truc un peu inhumain. On avait déjà un peu expérimenté ça ensemble sur All Things Being Equal.
PB — On n’avait jamais chanté ensemble avant ça, et il y a eu un rendu étrangement proche des Everly Brothers qu’on a bien aimé. Ou Simon & Garfunkel… Je veux dire, nos voix n’ont rien à voir, mais il y a quelque chose dans l’équilibre, le contraste, qui nous inspire.
C’est drôle, à la 1ère écoute du disque, j’avais l’impression d’entendre quelque chose qui serait né sur scène plus qu’en studio. D’ailleurs, j’imagine que vous avez du travailler à distance à l’époque… C’était particulier pour vous, ou c’est dans vos habitudes ?
PB — On n’était pas physiquement ensemble pendant les six 1ers mois de la production. Quand la situation sanitaire l’a permis, et accessoirement qu’on a décidé de faire l’album, on s’est retrouvé. Après, c’est Peter qui s’est chargé du mix.
SB — En fait, ça a aussi été une source d’inspiration : en termes de rythmique, on a cherché à trouver une palette sonore proche des jeux de mains d’enfants, quelque chose d’assez organique et estival, au moment où on était tous bloqués chez nous.
>> A lire aussi : Animal Collective au top des fulgurances pop avec “Time Skiffs”
Ce genre de texture fait partie de vos gimmicks communs, non ?
PB — Ça nous cause, oui, mais on ne s’y limite pas. Par exemple Tomboy ne sonne pas comme ça à mes yeux. Donc ce n’est pas récurrent, mais je trouve que ça avait du sens de le mobiliser pour Reset, ça a participé à donner une couleur à l’énergie qu’on voulait insuffler à notre musique.
SB — C’était aussi quelque chose qui revenait dans certains des samples qu’on utilise, dans des musiques des années 1960, où on trouve pas mal de guitares acoustiques soutenues par des handclaps… Des choses assez bubble gum, qui ont défini la note d’intention.
Qu’y a-t-il derrière ce choix de ne sampler que des vieux tubes pop-psyché ?
SB — En ce qui me concerne, c’est un peu le fil rouge de ma carrière, je trouve que le rock sonne toujours plus cool avec de la musique électronique dedans. Mais c’était assez rare dans les années 1960. Donc ce n’était pas particulièrement une question de contexte. D’ailleurs, il y a d’autres samples qu’on a utilisés qui venaient de musiques des années 1980…
“Je trouve que le rock sonne toujours plus cool avec de la musique électronique dedans”
Et vous vous êtes faits découvrir des morceaux ?
PB — Pas vraiment, comme tout est venu de Pete, il n’y a pas eu vraiment d’échange… Mais je ne connaissais pas tout ce qu’il m’a envoyé. J’en ai reconnu une bonne partie, mais j’ai aussi redécouvert certaines intros. C’était super agréable et ça facilitait beaucoup l’écriture : c’est plus facile de partir d’un souvenir pour le modifier, que de s’attaquer à quelque chose qu’on connaît déjà par cœur.
SB — Ta question rejoint un peu l’idée d’énergie des intros dont on parlait tout à l’heure… Tu vois, je pense que la boucle sur Edge of the Edge cause à tout le monde. Et pourtant, le morceau original [Denise de Randy & the Rainbows] est un succès sans lendemain du début des années 1960. Il y a un sentiment de familiarité assez immédiat.
PB — C’est une expérience assez étrange, ce sentiment de reconnaître quelque chose qu’on n’a jamais vraiment entendu, et c’est un outil très puissant en musique. C’est avec ça qu’on veut jouer, en cachant des choses dans nos morceaux.
Et comment s’est passée l’écriture ?
PB — Je m’en suis principalement chargé, je demandais son aide à Pete et il ajoutait ses idées aux mots que j’avais déjà écrits. Il y a quelques morceaux que j’ai écrit autour des mots-clés de Pete.
C’est drôle de causer de mots plus que de phrases, mais ça correspond bien à ta façon de chanter. Cette attention de la répétition, il y a quelque chose du mantra…
PB — Ouais, je n’ai jamais écrit de façon très narrative. Je trouve ça plombant, je préfère mettre en exergue des émotions ou des idées avec des formules assez courtes. Je me sens plus à l’aise dans ce flou, et ça laisse de l’espace au public pour mettre du sien dedans.
SB — Les paroles sont à l’image des chansons elles-mêmes, tout s’articule autour de la répétition et de ce sentiment d’illusion qu’on essaye de créer… Ça boucle bien le projet je trouve !
Propos recueillis par Briac Julliand