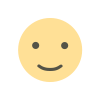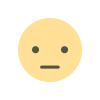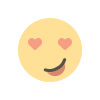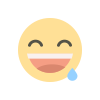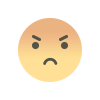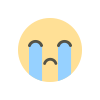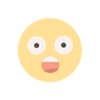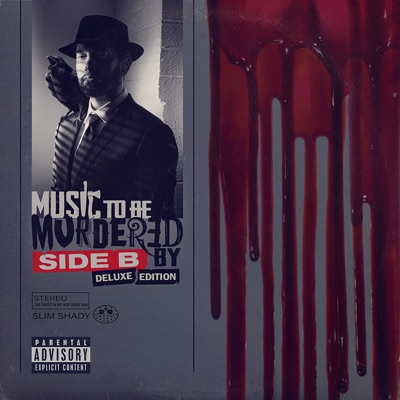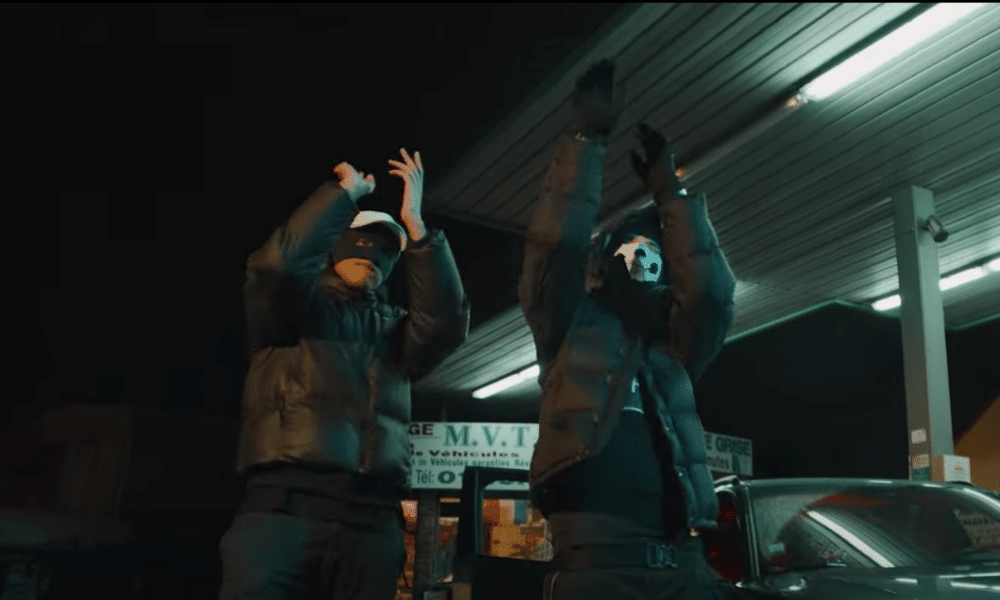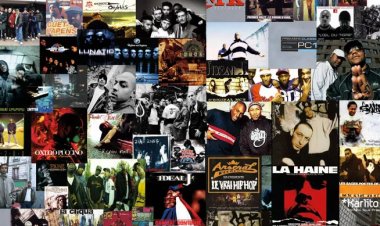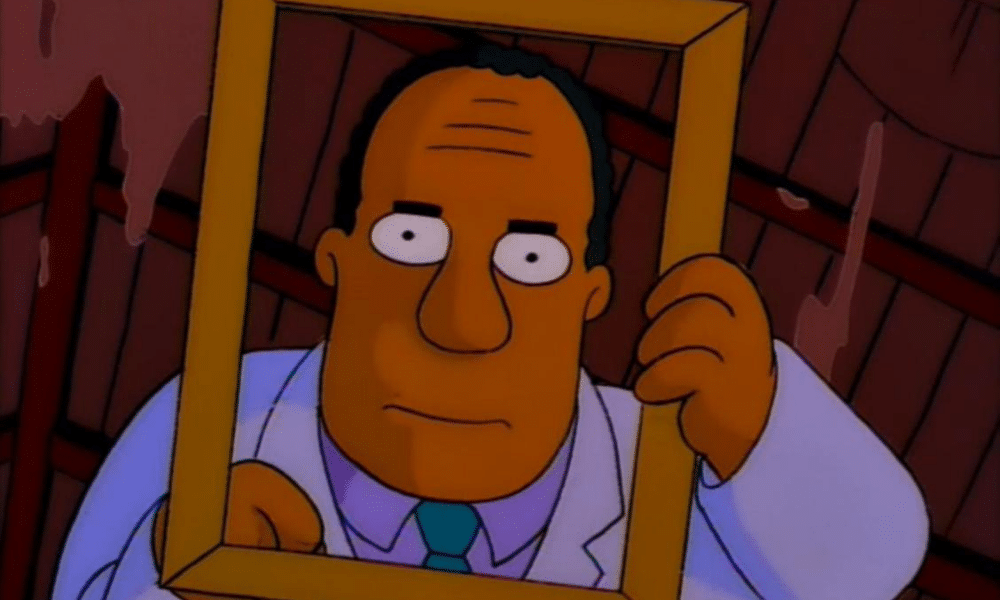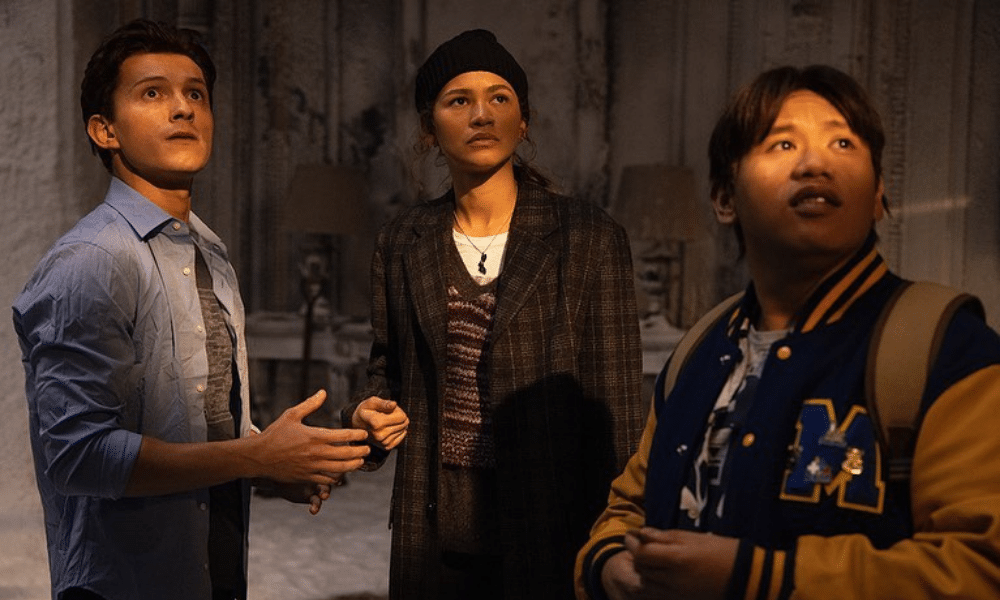Pourquoi l’hyperpop définit-elle notre époque ?
Disons-le d’emblée, cet essai s’adresse à un cercle plus large que celui des fans d’hyperpop, même s’il les rendra particulièrement heureux·ses. La façon dont Julie Ackermann fait du genre le symptôme mais aussi l’antidote au capitalisme numérique...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Disons-le d’emblée, cet essai s’adresse à un cercle plus large que celui des fans d’hyperpop, même s’il les rendra particulièrement heureux·ses. La façon dont Julie Ackermann fait du genre le symptôme mais aussi l’antidote au capitalisme numérique fascinera toute personne intéressée par la manière dont culture et société dialoguent.
Cette approche à la fois esthétique et sociologique débute cependant par un court récit de soi, celui de l’autrice, Julie Ackermann, critique pour divers magazines culturels, dont Les Inrocks, née dans les années 1990 et dont l’adolescence a été forgée par la culture Y2K, en particulier par la pop de cette époque.
Lorsqu’au mi-temps de la décennie suivante apparaît un nouveau genre musical, l’hyperpop, qu’elle définit comme “le rejeton stéroïdé de la musique de [son] adolescence et plus largement de cette pop culture créée pour faire consommer, détendre ou rendre productif”, elle s’en éprend tout de suite. Cette “pop hardcore” ou “pop extrême pour temps extrême” n’a rien en commun avec les successifs revivals musicaux qui la précèdent, qui ont plus à voir avec des modes nostalgiques qu’avec une nouvelle proposition esthétique ou avec “une sensibilité, une manière d’être au monde”.
État des lieux et fulgurances
Après avoir déjà signé un long article sur l’hyperpop pour la revue Audimat, Julie Ackermann sort donc cette semaine Hyperpop : La Pop au temps du capitalisme numérique, un brillant essai découpé en huit chapitres, chacun centré sur un aspect du genre (une petite histoire de l’hyperpop, le royaume du fake, I am cringe but I am free, ou encore Baby voices).
Le livre est marqué par quelques fulgurances, comme l’analyse du clip Faceshopping de Sophie, la façon dont elle fait d’Euphoria une série hyperpop, ou la catégorisation des tubes de la pop selon trois groupes : l’absence d’ironie de la pop ingénue (Baby One More Time, de Britney Spears), l’ironie de la pop des années 1990-2000 (Barbie Girl, d’Aqua) ou enfin la post-ironie propre à l’hyperpop d’aujourd’hui (Vroom Vroom, de Charli XCX).
Sans surprise, Sophie, la regrettée marraine du mouvement, y est abondamment citée, tout comme A. G. Cook et Danny L Harle, ses deux parrains. Côté français, les artistes Éloi, Oklou et Timothée Joly y apparaissent, et on croise aussi évidemment 100 Gecs, Hannah Diamond, Dorian Electra ou encore Kim Petras. Mais plus qu’un état des lieux des forces en présence dans l’hyperpop, le livre brille par la façon dont il applique les concepts des plus fin·es analystes de notre époque à cette pop mutante.
Une fertile ambivalence
On y retrouve notamment la notion d’accélérationnisme théorisée par Alex Williams et Nick Srnicek, mais aussi d’habiles références à José Esteban Muñoz, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Bret Easton Ellis, Donna J. Haraway, Judith Butler, Gilles Deleuze, Anne Carson ou encore Susan Sontag. Cet impressionnant arsenal de pensées, Julie Ackermann l’utilise pour démontrer à quel point l’hyperpop cultive une fertile ambivalence avec le capitalisme. Elle en exalte les charmes tout en dévoilant leur caractère factice, et en les chargeant d’une dimension queer, et plus spécifiquement trans, manifeste.
Si le succès (pourrait-on même causer de phénomène de société?) de l’album Brat, de Charli XCX, rend le livre d’autant plus actuel, il joue aussi contre l’une de ses thèses, à savoir que l’hyperpop serait depuis la fin de la pandémie dans “une forme de dépérissement”, voire qu’elle serait morte depuis l’arrêt de PC Music en 2023.
Prise de pouvoir ?
En plus de Brat, qui a de fortes chances d’être sacré meilleur album de l’année par plusieurs médias de référence, comme Pitchfork, A. G. Cook a également sorti un excellent album début mai, et Sophie fera son retour en septembre avec un disque posthume (qui fait un peu peur quand même, comme tous les projets posthumes).
A contrario, on pourrait affirmer qu’après une année 2023, qui a marqué une forme de diversification du genre – avec l’album hyperpop-rock de 100 gecs ou celui hyperpop-emo de Jane Remover –, elle est entré dans une nouvelle phase, celle de l’installation au centre de l’échiquier de la pop, bref celle d’une prise de pouvoir. Espérons que l’hyperpop n’y perde pas au passage sa puissance de subversion du capitalisme numérique, cette “voix encore balbutiante d’un futur qui n’a pas encore été complètement pensé, celle des mondes queers contenus dans les étincelles du présent”.
Hyperpop : La Pop au temps du capitalisme numérique, de Julie Ackermann (Façonnage Éditions), 146 p., 15 €. En librairie.