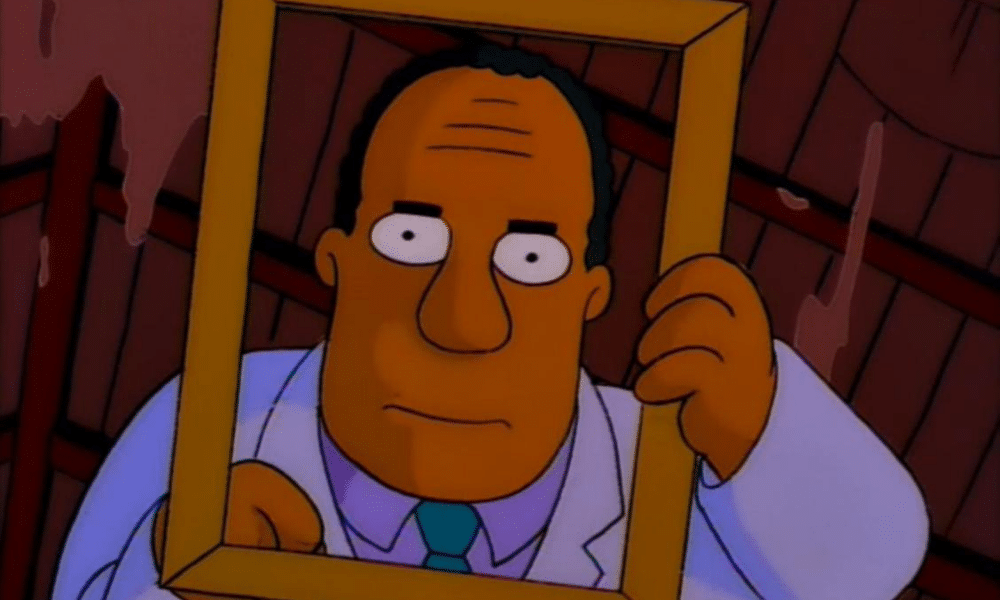Qui est Nâr, musicienne puissante programmée à Ideal Trouble ?
Il faudrait commencer par là, par décrire la façon dont s’est opérée la rencontre. Un festival pointu début avril (Closer Music), précédé d’un SMS d’un des programmateurs me conseillant d’arriver tôt (sans plus de détails). Pénétrer dans le...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Il faudrait commencer par là, par décrire la façon dont s’est opérée la rencontre. Un festival pointu début avril (Closer Music), précédé d’un SMS d’un des programmateurs me conseillant d’arriver tôt (sans plus de détails). Pénétrer dans le tout nouvel espace de la Station, déjà plein à craquer, se prendre dans le ventre un son impossible à définir, puis, comme aimanté, fendre la foule, s’arrêter à cinq mètres de la scène de peur de s’y brûler, rentrer lentement dans un état de tension proche de l’implosion, ressentir un saisissement pas commun, impossible de dire si c’est désagréable ou malicieux, et ce son qui semble être là depuis une éternité déjà, en nous depuis toujours : qui est cette fille qui arrive à faire surgir ça ? Qui est cette sorcière ? On a juste lu un nom, sur un flyer : Nâr. En turc, cela pourrait vouloir dire “grenade” (au sens petite bombe ?), mais Nâr n’est pas turque, elle est libanaise.
Sur scène, arrosée de rose liquide et de bleu Euphoria, les couleurs de la Station, cette Diamanda Galás druze donne l’impression d’une guerrière. Tout en intensité, sombre et fabriquant sous nos yeux des choses que l’on ne comprend pas, avec des instruments que l’on ne reconnaît pas. Posée sur une table, une valise dans laquelle sont tendues des cordes ; sous la table où elle disparaît parfois pour se cacher et hurler, des pédales d’effets avec lesquelles elle monte des boucles qui se répercutent sur sa voix. Grave, la voix. Incantant en arabe quelque chose qui ressemble à un appel à l’aide. Ou une prière. Ou un ordre. On n’a jamais vu ça, sinon un soir de l’Aïd à Beyrouth dans le quartier de Hamra quand, d’une mosquée à l’autre, les chants de dix muezzins se répondaient en une sorte de partition expérimentale, à la fois sacrée et belliqueuse. Ça nous avait mis, à l’époque, dans un état de confusion palpable.
Beyrouth
Il fallait que l’on sache. Alors rendez-vous fut pris, pour le surlendemain, à une terrasse au nom approprié (Cannibale), même si la force primitive est davantage du côté de l’artiste que de l’établissement. Nâr a 30 ans. En plein jour, aussi, elle impressionne. Par sa taille. Par le fumé de sa voix. Par sa grande douceur, que personne ne saurait déceler au 1er abord. Sur scène, elle ne sourit pas. Au café, oui. Mais pas quand il lui faut revenir sur son parcours : naissance en Suisse, un père grand collectionneur de disques, ami des plus grand·es musicien·nes de jazz. À quelques années près, Nadia aurait pu voir Nina Simone venir déjeuner à la maison après son concert à Montreux. À 8 ans, l’enfant exilée ne supporte pas d’inspirer la méfiance et demande de repartir à Beyrouth.
La méfiance est-elle tout à fait partie ? L’adolescente tarde en tout cas à se canaliser, Nadia se retrouve de nouveau en Suisse, puis ce sera Barcelone, où elle apprend la musique en jouant dans la rue, atterrit à Bruxelles, où elle devient Nâr. Nâr est déjà une aventure collective : Nadia ne peut penser alors ses lives sans une amie danseuse. Elles squattent les caves de Bruxelles et tous les lieux alternatifs suisses. En mars 2019, un label allemand sort sur une compil son morceau Tayreen, qui devient un petit tube sur NTS : on dirait Pere Ubu, ou Swans, faisant tourner en bourrique des cloches tibétaines. Pris par ce tournoiement, on n’avait pas remarqué à l’époque que la voix au loin chantait en arabe. L’admiration est proche parfois d’un état distrait.
Depuis ? Des morceaux enregistrés qu’elle ne lâche pas – une K7 devrait arriver sous peu pour solder une période, une époque. Mais ce que l’on voudrait entendre, elle s’apprête à l’enregistrer ce printemps pour un album à sortir sur BlauBlau Records, le meilleur label suisse du moment. Ce seront les musiques qu’elle fait depuis son installation à Beyrouth, il y a trois ans : “Depuis l’explosion, le 4 août 2020, tout le monde veut fuir Beyrouth. Moi pas. Tout est dur, mais c’est maintenant qu’il faut affronter cette ville.” À Beyrouth, elle est membre d’un collectif, Frequent Defect, qui organise des raves, des concerts, des soirées, à l’écart de tout : un vrai collectif, soudé, avec son mode de vie autarcique et ses personnalités déjà fortes – Jad Atoui, H.W.G.A., etc.
Selon elle, seule l’aventure collective permettra d’inventer des lignes de vie, pas nécessairement des lignes de fuite, face à la crise financière, politique, morale, psychique qu’affrontent le Liban et ses habitant·es depuis trois ans, depuis l’extinction de la belle insurrection d’octobre 2019, puis l’explosion du port de Beyrouth qui a rasé une partie de la ville, et l’effondrement de l’économie depuis. Une ville à plat, en ruine, pour une musicienne debout, cherchant ses réponses dans des improvisations qui flirtent avec les musiques de trance les plus hypnotiques, celles venues du fin fond du Maroc, du Niger ou du Soudan.
“Le futur ? Impossible de se projeter”
Une connaissance par les gouffres qui ne se satisfera pas de quelques maigres consolations. Sa musique change évidemment d’un concert à l’autre : “C’est une succession d’erreurs que je sacralise, une suite de choses non contrôlées qui m’emmènent dans une direction que je ne connais pas. Les textes, eux, jouent le rôle de balises, il me faut garder un cap quand même…”
Quelques jours plus tard, à La Bellevilloise, on ne reconnaît plus rien, sinon l’intensité et ces mêmes vers, “Alan / Hudur…”, répétés à l’infini. “En français, on pourrait traduire ça par ‘Maintenant / La présence’. Maintenant, c’est le seul moment du temps qui ne m’échappe pas. Le futur ? Impossible de se projeter. Le passé ? Je n’ai pas la force de me retourner. Alors je m’accroche pour tenir, et je répète ce mantra pour sortir de certaines souffrances par l’instant présent. Sinon, j’ai repris des textes de guerre, des chants de milices que j’entendais dans les villages, et je les transforme en chansons d’amour…”
À La Bellevilloise, Nâr nous montre sa table : “Tu vois, c’est lourd. Je fais de la musique avec des horloges. Un jour, j’en avais marre de ma guitare et, au même moment, on m’a donné un carillon, un timbre d’horloge. J’ai fait un concert uniquement avec des horloges que j’avais démontées et sur lesquelles j’avais soudé un micro. L’horlogerie suisse, c’est magnifique, c’est comme une machine à remonter le temps. Le timbre, le carillon, ce sont des tiges en laiton à partir desquelles je fais mes sons. Mais bon… la prochaine fois, je prendrai des Swatch, ce sera plus facile à emporter !” [rires]
Elle n’a plus aucun autre instrument sur scène en ce moment. “Je pourrais faire de la musique avec des cuillères. Je ne sais pas si je suis vraiment musicienne. Bon, en même temps, Blixa Bargeld d’Einstürzende Neubauten ne sait toujours pas faire un sol ou un fa, mais il reste un guitariste passionnant qui a changé la façon de faire de la musique.”
Avant de se quitter, elle nous demande à son tour d’où l’on vient. “Moi ? Du Sud-Liban, mon père s’appelle Nabih. Il avait trois passeports et trois dates de naissance différentes. Je n’ai jamais su quel âge il avait…” “Ah tiens, mon père aussi s’appelait Nabih, et il avait trois passeports. C’est drôle, tu ne trouves pas ?” Oui, c’est si rare de rencontrer des gens qui ont le même sens de l’humour.
En concert le 4 juin à Paris (festival Ideal Trouble, La Station – Gare des Mines).