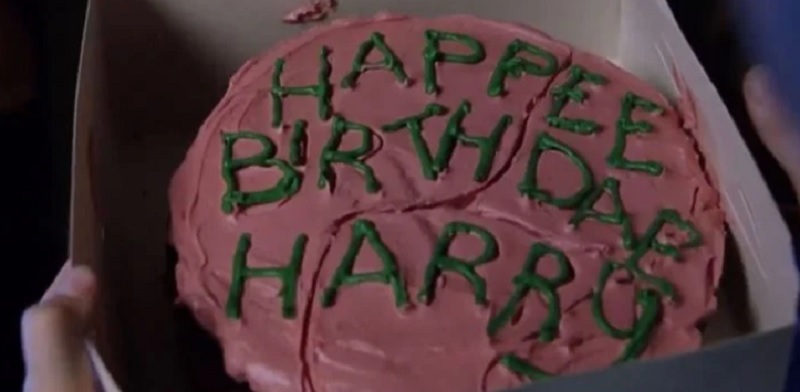Ryūsuke Hamaguchi : “J’ai l’ambition de représenter la lutte que les femmes mènent pour se libérer des carcans”
Comment se fait-il que vous ayez pu sortir deux films dans une temporalité aussi restreinte ? Ryusuke Hamaguchi – Les deux projets sont nés en même temps. Drive My Car a démarré fin 2018 et Contes du hasard et autres fantaisies début 2019,...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Comment se fait-il que vous ayez pu sortir deux films dans une temporalité aussi restreinte ?
Ryusuke Hamaguchi – Les deux projets sont nés en même temps. Drive My Car a démarré fin 2018 et Contes du hasard et autres fantaisies début 2019, mais j’ai avancé sur les deux projets de façon parallèle. J’ai tourné les deux 1ers épisodes de Contes du hasard… fin 2019, puis j’ai enchaîné avec Drive My Car en mars 2020, mais nous avons rapidement dû nous arrêter à cause de l’épidémie de Covid-19. Le tournage a été interrompu pendant huit mois et je me suis alors lancé dans le tournage du troisième segment de Contes du hasard…
Le Japon que vous filmez, surtout celui du dernier segment, mais aussi celui de Drive My Car ou d’Asako I & II, est à mille lieues du cliché du Japon grouillant. Loin de rendre compte de leur densité de population élevée, vos villes semblent presque désertiques.
Il y a une raison très simple à ce parti pris. Au Japon, les producteurs, ces dernières années, préfèrent qu’il y ait le moins de monde possible à l’écran, pour des questions de droit à l’image. Comme nous évoluons dans une économie très restreinte, nous sommes contraints de filmer à des heures creuses.
Ce dernier segment nous plonge dans une science-fiction minimaliste qui prend le contrepied du Covid-19, avec ce monde où toute interaction numérique est devenue impossible. Cette idée précède-t-elle l’épidémie ?
Non, j’ai clairement écrit ce segment à partir de l’épidémie et juste après l’interruption du tournage de Drive My Car. Nous étions dans un état d’urgence qui ressemblait au confinement français, en moins strict peut-être. Ça m’intéressait d’inscrire mon film dans son époque. Je ne voulais pas faire un film qui s’affranchisse complètement de l’état du monde. Mais j’ai voulu représenter l’exact opposé du monde sous Covid-19, en me disant que cette réalité alternative où seules les interactions physiques sont possibles était sans doute plus raisonnable que celle dans laquelle nous vivions.
Quelle a été votre vie pendant cette période d’arrêt forcé de votre activité ?
Le confinement a duré deux mois au Japon, d’avril à mai. Je pensais me reposer mais j’ai mené, avec Kōji Fukada et d’autres producteurs, une campagne de financement participatif pour tous les petits cinémas indépendants du Japon. Contrairement à la France, les cinémas ne sont pas soutenus par l’État et le confinement signifiait pour beaucoup d’entre eux la faillite. Nous avons décidé de lancer une action pour récolter des fonds et les redistribuer aux cinémas au péril. Cela m’a pris énormément d’énergie pendant quasiment un mois et demi. Finalement, 30 000 personnes nous ont envoyé l’équivalent de 250 000 euros. Je n’ai donc pas du tout regardé de films durant cette période.
Votre cinéma convoque à la fois des figures tutélaires – Hitchcock et Rohmer par exemple –, mais vous avez aussi le souci manifeste de l’inscrire dans le contemporain, à travers la représentation de la pandémie, mais aussi sur la place des femmes, la façon dont elles forment communauté et, dans le cas du dernier segment, sur la représentation du personnage de femme lesbienne.
Ma réponse va surement vous décevoir mais il y a très peu d’intentions chez moi de faire des films qui incluent des questions de société contemporaines. La question de la sororité était de plus déjà présente chez Rohmer je trouve, tout comme l’amour homosexuel chez Hitchcock, même si le traitement était différent. Je suis plutôt soucieux de ramener des éléments du réel qui nourrissent ma narration et la structure de mes films. Et comme j’évolue dans une sphère budgétaire extrêmement restreinte, je puise dans le quotidien. L’essence du cinéma est pour moi de puiser dans ma réalité. Je ne lutte pas contre ce qui se déroule et je veux le représenter, mais il ne s’agit pas d’un cahier des charges à remplir pour cocher les cases d’un film contemporain.
Tout de même, dans Senses, Asako I & II, à présent dans Contes du hasard et autres fantaisies, les femmes occupent dans votre cinéma une place centrale. Il y a récemment eu en France une rétrospective des films de la cinéaste et actrice Kinuyo Tanaka, dont les films causent aussi de la condition des femmes au Japon.
Tanaka est une cinéaste méconnue mais importante. La façon dont elle filme ses héroïnes est incroyablement puissante. Dans Mademoiselle Ogin, que j’ai vu récemment, il y a cependant cette idée que l’héroïne est forcément une victime, idée qui est sans doute propre à l’époque. À ce sujet, je me souviens d’une discussion que j’ai eue avec Isabelle Huppert récemment. Elle évoquait le fait qu’elle avait à cœur de renverser ce statut victimaire des personnages féminins. Cela résonne beaucoup avec ma conception des choses. Ce qui me plaît dans la représentation des femmes, c’est de me dire qu’elles vont au-delà de leur condition, qui est en effet parfois victimaire, mais sans aucune victimisation d’elles-mêmes, avec cette volonté d’aller de l’avant. Je ne sais pas si cela a un lien avec une vision contemporaine de la femme ou pas.
Avez-vous le sentiment que la façon dont vous mettez en scène les personnages féminins est en adéquation avec la place que les femmes occupent dans la société japonaise ?
Je ne veux pas spécialement décrire une femme progressiste, cela dit j’ai conscience que les femmes que je mets en scène ne sont pas totalement réalistes non plus, qu’elles sont peut-être plus émancipées que la moyenne. J’ai l’ambition de représenter la lutte que les femmes mènent pour se libérer des carcans. Peut-être que j’ai ce spectre-là parce que je suis un homme, mais ce qui m’intéresse, c’est la représentation du malaise ressenti dans une situation où l’on ne se sent pas à sa place. Je veux décrire en détail ce conflit entre un personnage et son environnement, explorer les ressorts sur lesquels ce personnage va s’appuyer pour s’en sortir, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Depuis Passion, et excepté Drive My Car, vos autres films ont pour personnages principaux des femmes. Vous semblez tout de même avoir plus d’intérêts pour la psychologie féminine que masculine. Pourquoi ?
Je crois que ce qui me plaît dans la représentation des femmes dans mon cinéma, c’est qu’elles ont le sens de l’effort, ce qui n’est pour moi pas forcément le cas des hommes contemporains. Il y a probablement chez ces derniers, du fait de leurs privilèges, une certaine fainéantise à se remettre en question. Ils prennent pour acquis beaucoup de choses et cela débouche sur un manque de volonté de changer. Ils ne sont pas si intéressants que ça à montrer. Quand je dois dépeindre un personnage masculin, ça ne suscite pas tellement ma curiosité et mon envie. Spontanément, je me dirige donc vers les portraits de femmes. Et les cinéastes que j’aime ont plutôt exploré la psychologie des femmes, cela m’a aussi influencé.
À propos de Passion, c’est un film qui a été vu par très peu de gens et mes amis m’avaient justement fait la critique que j’y représentais les femmes avec trop de clichés, comme si elles étaient des faire-valoir pour les personnages masculins. Je me suis énormément remis en question après ça. Par hasard, j’ai ensuite rencontré les quatre comédiennes de Senses. Et pour préparer le film, j’ai réalisé des entretiens avec de nombreuses femmes et j’ai eu le sentiment de comprendre pour la 1ère fois quels étaient les questionnements des femmes d’aujourd’hui. Et je me suis alors senti plus légitime à faire un portrait de femme ; j’ai senti que cela déclenchait un intérêt sans précédent chez moi.
Pour moi, les deux grands héritiers de Rohmer sont Hong Sang-soo et vous-même. On pourrait dire que Rohmer était un grand cinéaste de la parole. Chez Hong Sang-soo, cette parole est récoltée dans un dispositif de face-à-face autour d’une table et avec de l’alcool, tandis que chez vous, c’est plus frontal. Vos deux derniers films mettent en scène des personnages assis plutôt côte à côte ou alors filmés en champ-contre-champ. Hong Sang-soo est un cinéaste de profil, vous êtes de face.
Le mouvement des yeux du spectateur à l’intérieur du plan est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup. Le fait d’avoir deux visages de face dans le même plan permet d’avoir une richesse d’émotions et d’intensité que j’aime beaucoup. Je veux que mon spectateur travaille dans les images que je filme. Cela permet aussi de faire des plans plus longs. Et puis cela a aussi une raison budgétaire. Pour animer un plan restreint sur deux comédiens, sans décor, ni figurant, et que les spectateur·ices ne se lassent pas, je propose ce filmage de face de deux personnages qui dynamise mes séquences. Deux cinéastes m’ont aussi inspiré pour ce dispositif, Carl Theodor Dreyer et Yasuzō Masumura.
Pour faire travailler les spectateur·ices, vous avez aussi souvent recours à l’imaginaire. Chacun des segments de Contes du hasard et autres fantaisies déploie, par la parole, un récit imaginaire qui est un récit ou un souvenir. Comme s’il fallait que les spectateur·ices construisent leur propre film à partir de ce que expliquent les personnages.
À nouveau, il s’agit d’une contrainte financière qui m’a amené à réfléchir. Cela dit, à propos de cette puissance évocatrice du récit, je me suis aussi beaucoup inspiré de Jean Eustache et de sa façon de déployer des récits parallèles à l’image. C’est une gymnastique pour les spectateur·ices, qui doivent faire des allers-retours entre le présent de l’image et ce qu’il explique d’un événement, passé, futur ou imaginaire. Cela donne une double épaisseur, une double dimension à la mise en scène. Je veux que les spectateur·ices construisent le film, en reconstitue la trame, comme s’iels étaient un·e collaborateur·rice du cinéaste.
Finalement, ce que l’on vous souhaite le moins, c’est d’avoir de l’argent pour faire vos films. Pour vous, est-ce que le génie d’un cinéaste réside dans sa façon de faire à partir des contraintes du réel ?
Je suis très vigilant à ce sujet. Je ne veux pas perdre de vue ce dont j’ai vraiment besoin pour faire mes films, et peut-être que la contrainte financière en fait partie. Avec les récompenses et honneurs qu’ont récemment reçus mes films, je sens bien que je vais avoir plus d’argent pour faire mes films et je ne veux pas perdre de vue mon cinéma.
Vous voyez-vous réaliser un film en dehors du Japon ?
C’est une envie que j’ai depuis toujours. Cependant, ma méthode de travail se base énormément sur ma langue natale et je devrais pouvoir dépasser ça. Cela me demandera du temps pour appréhender une autre langue et être à l’aise avec.
Il y a une tension dans vos films et dans la façon dont vous en causez, entre une approche savante et référencée, presque comme un geek de cinéma, et un rapport intuitif et facile d’accès, qui met la vie au centre. Est-ce conflictuel pour vous ?
Quand j’avais une vingtaine d’années, j’étais entouré de cinéphiles bien plus savants que moi, au point où je me demandais si j’en étais un. Et pourtant, j’en ai vu un grand nombre et j’y ai pioché des idées de mise en scène, mais qui n’étaient que des idées. Et quand j’ai fait Passion à la fin de ma vingtaine, j’ai réalisé que ce bagage cinématographique n’était pas suffisant pour faire les films que je voulais faire. C’est pour ça que durant la trentaine, j’ai mis ces idées que j’avais piochées à l’épreuve en faisant du documentaire. Ça m’a vraiment permis d’accéder à l’humain. Et donc à la fin de la trentaine, j’ai pu rapprocher ces deux expériences pour faire Senses. Il y a deux polarités, d’un côté la technique, et de l’autre l’âme d’un film et de ses personnages. Elles ne sont pas contradictoires mais évidemment complémentaires. Chaque cinéaste doit trouver sa propre balance entre ces deux pôles.
Il y a dans beaucoup de vos films une disparition tragique toujours suivie d’une réapparition quasi magique. Et ce qui lie ces deux évènements c’est une croyance dans la persistance de l’amour malgré l’absence.
Quand vous évoquez le terme de réapparition, cela me cause beaucoup et très intimement. Ça m’évoque immédiatement un souvenir d’enfance. Quand j’étais petit, entre l’âge de deux et cinq ans, j’ai vécu en Iran avec mes parents, à Téhéran où mon père travaillait. Un jour, nous faisions nos courses dans une grande surface. Il y avait beaucoup de monde. À un moment, nous avons pris l’ascenseur avec plein d’autres personnes. Mes parents et mon frère aîné en sont sortis en me laissant à l’intérieur. Je n’ai pas pu descendre à cause du monde et les portes se sont refermées. L’ascenseur a continué à monter et j’ai eu le sentiment très clair que ma vie était terminée. J’avais beau avoir quatre ans, j’avais conscience d’être dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Je me suis dit : “Voilà, ma vie est finie.” J’ai beaucoup pleuré. Des Iraniens m’ont réconforté et pris dans leur bras mais j’étais inconsolable. Finalement, l’ascenseur est redescendu, les portes se sont ouvertes et mes parents étaient là. J’ai ressenti un soulagement immense.
Cette expérience est fondatrice dans ma vie. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience que la vie pouvait basculer à tout moment, pris conscience qu’une chose pouvait d’un coup disparaître, mais aussi réapparaître. Pour ce qui est de l’amour, cela m’évoque plutôt un film que j’aime beaucoup : Love Streams de John Cassavetes. Il y a une réplique de Gena Rowlands qui dit que l’amour est un flux continu. Ces mots m’interpellent beaucoup. Une fois qu’on a aimé quelqu’un, ce n’est pas qu’on l’aime encore mais la conscience de l’avoir aimé dure toujours. Même si on n’est pas dans le désir que l’histoire d’amour continue, on vit à jamais avec cet amour à l’intérieur de nous.
Propos recueillis par Bruno Deruisseau.










![[Vidéo] “Old” : l'intrigant teaser du prochain thriller de M. Night Shyamalan](https://statics.lesinrocks.com/content/thumbs/uploads/2021/02/09/1463306/width-715/old-gael-garcia-bernal.png?#)
![Un Si Grand Soleil en avance : résumé de l’épisode du lundi 18 janvier 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img1.acsta.net/newsv7/21/01/15/14/40/4886441.jpg?#)
![Plus belle la vie du mercredi 6 janvier 2021 : résumé en avance de l'épisode 4188 [SPOILERS]](http://fr.web.img6.acsta.net/newsv7/21/01/04/14/46/0078366.jpg?#)