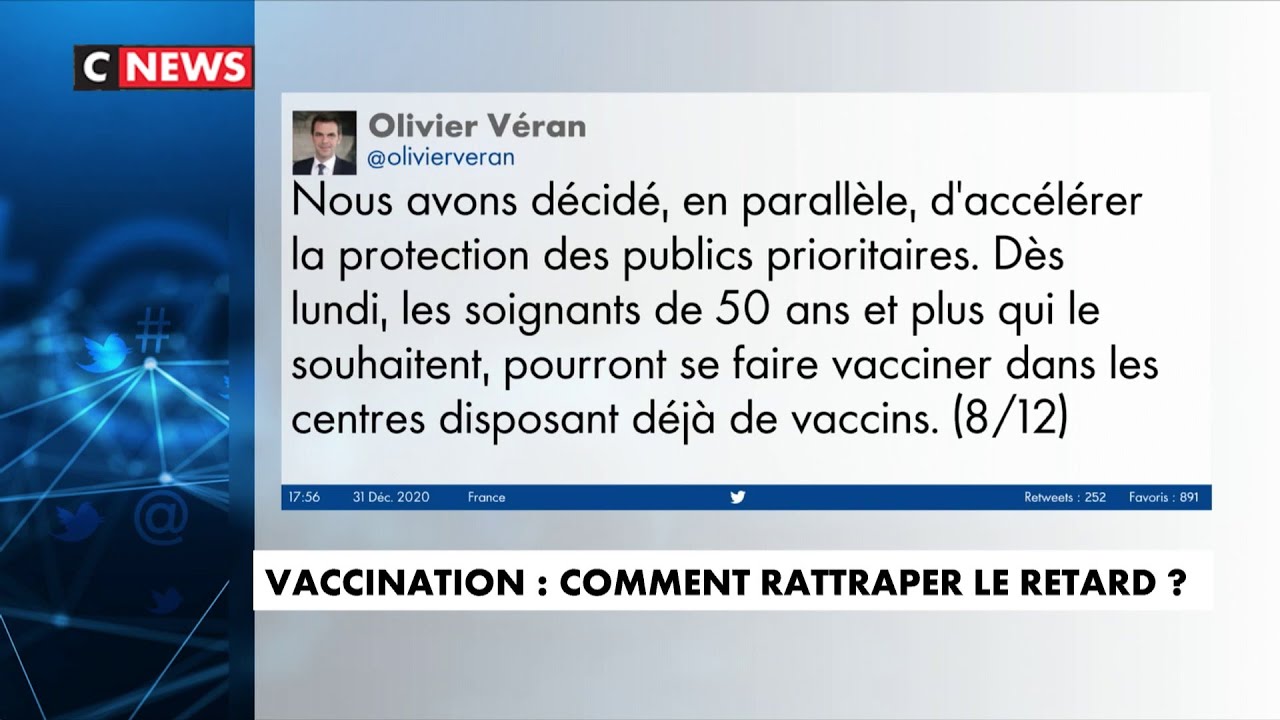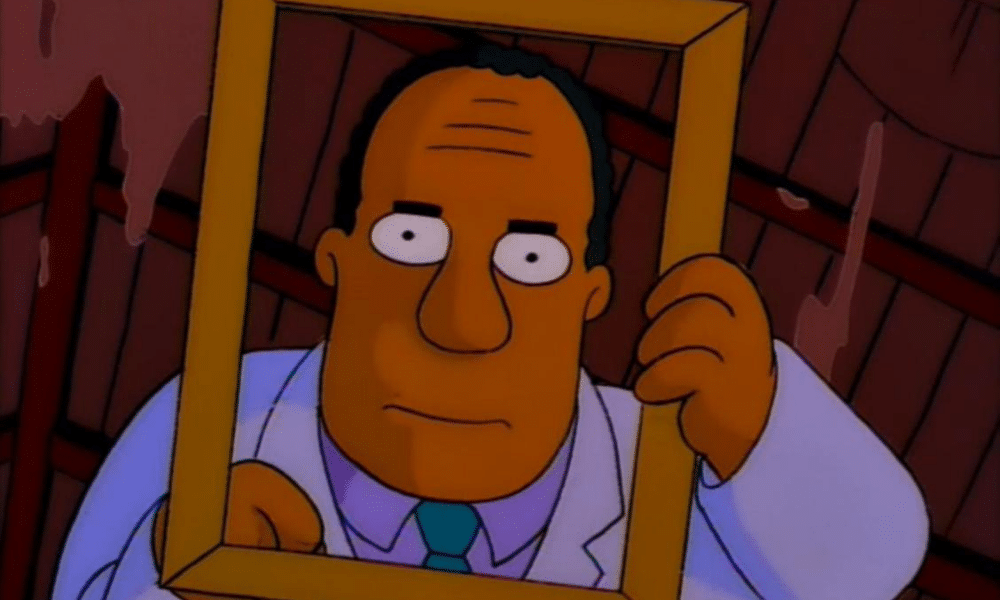Sandrine Kiberlain : “J’aimerais être très méchante”
Dans la précision sarcastique avec laquelle sont épinglées les absurdités banales du monde moderne, dans les petites mécaniques burlesques qui voient s’affronter les corps humains avec les métamorphoses technologiques, il y a du Tati dans Les Deux...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Dans la précision sarcastique avec laquelle sont épinglées les absurdités banales du monde moderne, dans les petites mécaniques burlesques qui voient s’affronter les corps humains avec les métamorphoses technologiques, il y a du Tati dans Les Deux Alfred, la facétieuse nouvelle comédie de Bruno Podalydès.
Ordonnatrice cassante des petites humiliations infligées par le monde du travail, Sandrine Kiberlain y déploie à nouveau son inénarrable verve comique, tout en trouvant un emploi en léger décalage avec ses prestations récentes. L’occasion d’investiguer sur presque trente ans de présence, inspirante et centrale, aux quatre coins du cinéma français.
Sandrine Kiberlain — Nous sommes plus ou moins de la même génération avec Bruno Podalydès, mais on ne se connaissait pas. J’aimais son cinéma depuis le début, depuis Versailles Rive-Gauche [1992]. Mais je ne l’ai rencontré que beaucoup plus tard, grâce à Alain Resnais, dont j’ai tourné dans le dernier film, Aimer, boire et chanter [2014]. A l’issue de l’enterrement d’Alain, Sabine Azéma a réuni quelques proches dans un restaurant. J’ai tout de suite eu envie de lui causer, nous avons sympathisé, et il m’a dit qu’il pensait à moi pour un prochain projet.
Votre inscription dans son cinéma paraît parfaitement naturelle…
Probablement parce que je me sens proche de son écriture, de la façon dont l’humour touche à une forme de poésie. Il y a quelque chose de très lié à l’enfance dans sa représentation du monde, dans laquelle je me sens assez à mon aise. Son cinéma appelle une façon de ne pas jouer au 1er degré sans être non plus dans la dérision. C’est cet alliage qui me touche chez la plupart des acteurs que je préfère.
Qui sont-ils ?
Shirley MacLaine, par exemple, a une fantaisie très gracieuse, une façon d’exprimer la douleur qui n’est jamais pesante. Diane Keaton est pour moi irrésistible, elle a un génie du dérapage. J’aime beaucoup Natalie Wood, dans un registre plus grave. James Stewart. Dans les acteurs ou actrices plus récentes, j’admire énormément Kate Winslet. Elle s’abandonne vraiment, tout en gardant quelque chose dans l’œil qui dit que c’est quand même du jeu et qu’elle y trouve un très grand amusement.
Julia Roberts m’émeut aussi beaucoup sans jamais qu’elle ne soit dans le pathos. Dès Pretty Woman, je suis tombée amoureuse d’elle et j’ai su que j’irais voir tous ses films. A l’inverse, il y a des acteurs que j’ai mis du temps à aimer. Quand j’étais jeune, Ingrid Bergman ne me touchait pas du tout et, d’un coup, elle m’a bouleversée et j’ai redécouvert beaucoup de ses films. Parfois, un film suffit à modifier la perception qu’on a d’un acteur.
Vous avez une idée des films qui ont modifié votre image ?
Non, j’essaie de ne pas m’en soucier. Au Conservatoire, j’ai toujours essayé d’alterner à la fois le registre dramatique et la comédie. Je me sentais à l’aise dans les deux. Mais le cinéma m’a d’abord entraînée vers des rôles assez sombres : En avoir ou pas [1995] de Laetitia Masson, Le Septième Ciel [1997] de Benoît Jacquot. La comédie est venue plus tard, avec Pierre Salvadori [Après vous, 2003], puis très régulièrement dans les années 2010.
“Dans Les Deux Alfred, j’ai pris du plaisir à être vraiment très irritante.”
À l’inverse, aujourd’hui, n’avez-vous pas l’impression qu’on vous envisage essentiellement pour des personnages de comédie, qui reposent sur un mélange de charme et de sympathie…
C’est un peu vrai. Mais je fais confiance aux cinéastes qui me connaissent personnellement pour penser à moi pour jouer aussi des choses très dark. (rires) Le succès du film de Dupontel [Neuf mois ferme, 2013] m’a cantonnée dans la comédie pour quelques années.
Mais c’est peut-être en train de changer : je vais jouer des sentiments plus graves dans le prochain film de Stéphane Brizé et un registre de dramédie dans celui d’Emmanuel Mouret. Les Deux Alfred est une comédie, c’est vrai, mais je ne joue pas un personnage sympathique, ce qui est déjà un peu en rupture avec ce que j’ai joué ces dernières années. J’ai pris du plaisir à être vraiment très irritante.
 © Jean-Francois Robert pour Les Inrockuptibles
© Jean-Francois Robert pour Les Inrockuptibles
Vous êtes arrivée dans le cinéma français à un moment de très fort renouvellement où une nouvelle vague de jeunes cinéastes s’associait à une génération de comédien·nes apparue dans les années 1990…
Oui, c’est vrai, avec souvent des tandems acteurs·trices/cinéastes. Valeria Bruni-Tedeschi chez Laurence Ferreira Barbosa ou Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric et Emmanuelle Devos chez Arnaud Desplechin, Romain Duris et Cédric Klapisch, Laetitia Masson et moi…
Effectivement, ça a été un moment très vivace pour le jeune cinéma français, où des cinéastes débutants ont fait émerger des nouveaux comédiens dans lesquels ils se projetaient très fortement. C’était un cinéma personnel, souvent un peu autobiographique.
Beaucoup de cinéastes apparus à ce moment-là ont d’ailleurs un peu disparu. Probablement parce que, pour un auteur, faire un film est une question vitale, et l’on ne trouve pas forcément la sève en soi. Mais ça peut revenir.
C’est ce qui s’est passé je crois pour Caroline Vignal, qui appartenait à cette génération et est revenue après vingt ans de silence avec Antoinette dans les Cévennes. Quand on voit le film – vraiment magnifique –, on se dit que ça valait la peine d’attendre.
>> A lire aussi : 2020 vue par Caroline Vignal : “Avec ‘Antoinette dans les Cévennes’, il n’y a pas eu une seule fausse note
Vous avez accepté des films dans lesquels vous ne croyiez pas, simplement pour travailler ?
Non, j’ai eu la chance de ne jamais faire des films par désespoir. Je dirais qu’il n’y en a qu’un seul, mais je n’ai pas envie de dire lequel, que je regrette d’avoir tourné et dont je déteste vraiment la personne qui l’a fait. Je sentais vraiment que je faisais de la merde et, en plus, que je n’étais pas respectée par le réalisateur, qui rudoyait les acteurs en disant qu’il était Maurice Pialat.
Je lui ai répondu que même Pialat ne se prenait pas pour Maurice Pialat, et ça n’a pas arrangé notre relation. C’est ma seule expérience vraiment affreuse. Après, je me suis arrêtée un moment, j’ai provisoirement perdu le goût de jouer. Je me suis inscrite à un stage intensif de dessin aux Beaux-Arts.
Les films de Pialat ont compté pour vous ?
Enormément, oui. J’ai vu A nos amours à sa sortie. J’étais adolescente et ça a été peut-être le plus grand choc cinématographique de ma vie. Sandrine Bonnaire, dans le film, m’a donné accès au désir de faire du cinéma.
Jusque-là, je n’avais pas une image de moi qui correspondait à l’idée que je me faisais d’une actrice. Et j’ai reconnu une partie de moi, de ce que je vivais à ce moment de la vie, à l’écran.
“J’ai dit à Maurice Pialat que ma fille s’appelait Suzanne, comme Sandrine Bonnaire dans A nos amours.”
Je connais le film par cœur. En plus, le personnage vit dans une famille qui travaille dans la confection de fourrure, comme ma famille. Le film exprimait tant de choses que je ressentais sans jamais avoir pu me le formuler. Je me suis sentie comprise par le film.
Avez-vous rencontré Maurice Pialat ensuite ?
Oui, beaucoup plus tard. Et une seule fois, par son épouse, Sylvie Pialat. Nous avons passé quelques heures ensemble à bavarder. Je lui ai dit que ma fille s’appelait Suzanne, comme Sandrine Bonnaire dans A nos amours. Et il m’a fait parvenir ensuite un exemplaire de la 1ère version de l’affiche lorsque le film s’appelait encore Suzanne. Ça m’a touchée.
Vous avez tourné récemment votre 1er long métrage de réalisatrice. Cela faisait longtemps que ça vous travaillait ?
L’écriture m’attirait, mais c’est d’abord passé par celle de chansons. J’ai enregistré deux albums dans les années 2000 avec, entre autres, Alain Souchon, et c’était déjà le signe d’une envie de m’exprimer autrement. Tourner un film, je n’ai longtemps pas osé. C’est l’envie de causer d’un truc qui a déclenché l’écriture d’un court métrage que j’ai tourné il y a cinq ans avec Chiara Mastroianni.
 © Jean-Francois Robert pour Les Inrockuptibles
© Jean-Francois Robert pour Les Inrockuptibles
Quel était ce truc ?
L’envie de causer d’un certain état de solitude qui vous submerge alors même que se multiplient les signes de reconnaissance. Mon long métrage cause d’une jeune fille juive en 1942 qui, dans la France occupée, rêve de devenir actrice. Ça cause évidemment aussi de moi, mais j’avais envie de passer davantage par de l’invention, de la fiction.
Vous avez un rapport personnel à la déportation ?
Oui bien sûr, elle a touché des personnes de ma famille. Mais j’ai aussi observé chez mes grands-parents maternels, qui ont eu la chance d’y échapper, une forme de culpabilité face à cet arbitraire du destin, un trouble profond et durable d’avoir survécu alors qu’autour d’eux tant de gens sont morts.
Récemment, vous avez joué votre propre rôle dans la dernière saison de Dix pour cent. Vous vous sentez proche de cette vision de Sandrine Kiberlain comme une personne fantasque et touche-à-tout ?
Pas vraiment, non. Mais ça m’a amusée de le jouer. La Kiberlain de Dix pour cent en a marre de ce qu’elle fait, a besoin de se trouver de nouveaux challenges, et je ne crois pas que ce soit mon moteur. En revanche, la non-peur du ridicule, la façon de ne pas m’arrêter quand j’ai une idée dans la tête et de me lancer dans la capoeira si tout à coup l’envie m’en prend, oui, ça me ressemble un peu. Mon entourage peut dire parfois que j’ai des lubies. (rires)
“Ce qui est dur, c’est de sentir un doute chez le metteur en scène”
Avez-vous le souvenir de la scène la plus difficile que vous ayez eu à jouer ?
Je n’y ai jamais pensé, mais là un souvenir me vient. La scène dans Quand on a 17 ans d’André Téchiné [2016] où j’apprends la mort de mon mari. André voulait que je pousse un cri et que ce cri soit très frappant. Il m’a conseillé de voir certains films japonais. Je lui ai dit que je ne travaillais pas comme ça, que je trouverais ce cri seulement au moment de crier. Mais quand même, je m’en faisais tout un monde. Ça me tourmentait.
Et je lui ai parlé de Georgia d’Arthur Penn [1981]. Quand le massacre surgit lors du mariage, la façon de crier de la mère est justement que le cri ne sort pas. Il y a seulement un rictus et un cri étranglé. Dans le film, c’est magnifique. Mais ça ne convenait pas à André. Il voulait entendre un cri. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Ce qui est dur, c’est de sentir un doute chez le metteur en scène. Et puis le jour J est arrivé, et puis bon, je l’ai fait. On ne sait jamais par où ça passe.
Est-ce que vous êtes attentive aux marqueurs d’une vie d’actrice où l’on vous demande de jouer quelque chose ?
Un peu. Pas tout le temps. Je sais, par exemple, que la 1ère fois que j’ai eu des enfants dans un film, c’était à un peu moins de 30 ans, dans Le Septième Ciel de Benoît Jacquot. Je ne m’étais jamais non plus évanouie dans un film avant celui-là. Ça paraît anodin mais, pour moi, c’est important.
L’évanouissement, c’est tout à coup le corps qui cause, qui prend le dessus, qui est plus fort que soi. Et c’est aussi très cinématographique, j’ai des souvenirs de films avec des évanouissements vraiment sublimes. C’était donc pour moi un enjeu très fort de m’évanouir pour la 1ère fois dans Le Septième Ciel.
J’ai le sentiment que vous n’avez jamais joué la mort d’un personnage à l’écran ?
En effet, jamais. Je crois que je ne suis pas prête. Ça me fait peur. Peut-être parce que j’ai trouvé qu’il y avait toujours un lien entre les films et ma vie. (rires) Sans faire de la superstition ni être complètement irrationnelle, je crois que ça communique un peu. Qu’on dégage quelque chose qui appelle ce qu’on vous propose.
Evidemment, je ne pense pas que les rôles influencent ensuite forcément votre vie. Mais c’est vrai que figurer le passage de la vie à la mort, on ne me l’a jamais proposé, et c’est sûrement lié au fait que ça me fait peur.
Très jeune, Isabelle Huppert a, elle, joué des morts très violentes au cinéma et est peut-être l’une des actrices que le cinéma a le plus confrontée à cette représentation.
Ah oui, c’est vrai ! J’ai en effet en tête beaucoup de morts jouées, de façon très frappante par Isabelle. Violette Nozière, Madame Bovary, La Cérémonie… Je me souviens quand j’ai vu La Pianiste, j’étais dans le jury du Festival de Cannes et on lui avait remis le prix d’interprétation. J’avais été vraiment impressionnée. Il n’y avait qu’elle pour jouer ça comme ça.
Mais, pour le coup, quand je la vois chez Haneke, je ne m’imagine absolument pas faire ce qu’elle fait. Néanmoins, probablement que, dans les années qui viennent, je vais jouer des choses plus dures, plus violentes. En tout cas, j’aimerais bien. Etre vraiment perverse ou très méchante. (rires) Heureusement, il me reste beaucoup de choses à interpréter pas encore abordées !
Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, avec lui-même, Denis Podalydès et Sandrine Kiberlain (Fr., 2020, 1 h 32). En salle le 16 juin