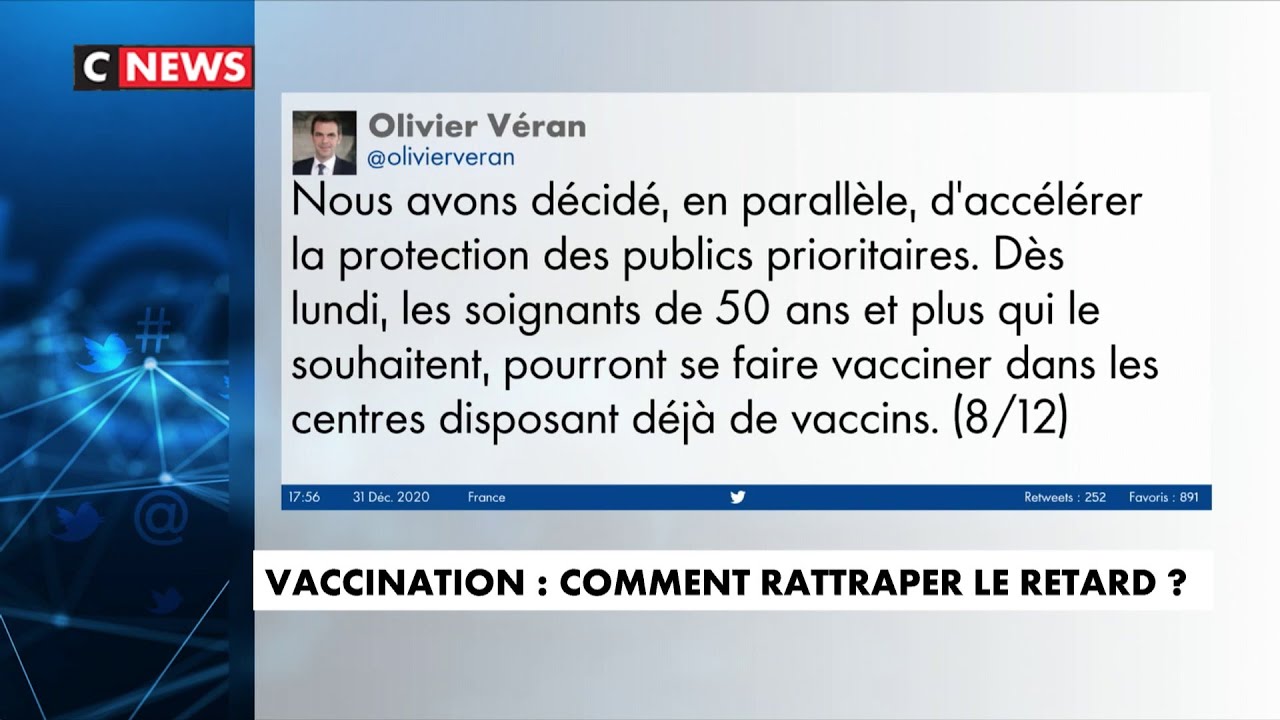Serge Gainsbourg, l’interview fleuve de 1989 : “En ligne de mire, je n’avais pas le bonheur”
Serge Gainsbourg — Je ne connais pas la nostalgie. J’ai une faculté d’oubli. C’est, je crois, une qualité. Elle est volontaire : il y a des épisodes que j’ai voulu effacer de ma vie. Il y a eu des incidents, sur le plan sentimental surtout....

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Serge Gainsbourg — Je ne connais pas la nostalgie. J’ai une faculté d’oubli. C’est, je crois, une qualité. Elle est volontaire : il y a des épisodes que j’ai voulu effacer de ma vie. Il y a eu des incidents, sur le plan sentimental surtout. Mon premier souvenir est musical. C’est mon père au piano. Je devais l’entendre quand j’étais encore à l’intérieur de ma mère… Il jouait Scarlatti, Bach, Chopin, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin. Ma première initiation. Plus tard, il m’a mis lui-même au piano, au piano classique. A la TSF, comme ça s’appelait à l’époque, on n’écoutait que du classique. Mon père s’y mettait par plaisir mais, de par son métier, il était obligé de jouer la Rhapsody in Blue, etc. Que j’ai essayée, mais je n’ai jamais pu, je n’avais pas assez de technique.
Avait-il gardé des relations étroites avec la Russie ?
Ah non, c’était impensable du temps du stalinisme, on ne pouvait pas avoir de correspondance. La patrie, c’est la France. La ville que j’aime le plus au monde, c’est Paris. Et le langage le plus beau, celui que je maîtrise le mieux, c’est le français. Mon père m’a appris le russe, je comprenais la culture cyrillique, je pouvais lire Gorki, mais j’ai oublié. Je comprenais ce que disaient mes parents.
Quand votre père vous a-t-il installé pour la première fois devant un piano ?
Je devais avoir 5 ou 6 ans.
Vous l’aviez demandé ?
Ah non ! (sourire) J’avais un mouchoir à gauche du clavier, parce que je savais pertinemment qu’à chaque leçon j’allais me faire engueuler. Je faisais une fausse note sur les gammes et… Il avait une voix assez âpre, j’étais blessé, je me mettais à pleurer. Mais c’était un bon professeur. Son ambition était de me faire faire ce que lui voulait faire : de la peinture.
Avait-il totalement renoncé à peindre ?
Il y a une histoire incroyable mais crédible, puisque c’est lui qui me l’a racontée. Il était dans le Transsibérien, il avait peint le portrait d’une femme qu’il avait aimée. Il s’est assoupi et on lui a piqué cette toile. Il s’est alors juré de ne plus jamais toucher à une plume ou à un pinceau. Ça paraît aberrant, mais c’est très slave. Alors il a dit : “C’est mon p’tit gars qui va prendre la relève.”
Quelle a été votre première réaction face à la musique et à la peinture ? Un attrait immédiat ?
Immédiat… La trilogie avec la musique, la peinture et les contes de Perrault, de Grimm, d’Andersen. Puis, un peu plus tard, la poésie avec Rimbaud et la littérature avec Baudelaire, les traductions de Poe. Un peu plus tard, Huysmans… Après, c’était instinctif, une démarche personnelle. L’évolution de mon père s’est arrêtée à Schumann, Debussy, Ravel, et moi j’ai continué avec Stravinski, Schönberg, Alban Berg… En jazz, le choc sera Billie Holiday, que j’ai adulée. Pour moi, c’est inégalable.
Et puis, un jour, à la TSF, j’en ai pris plein la gueule avec Gillespie : c’était le be-bop. J’ai trouvé ça remarquable. Le plus grand génie qui soit, au piano, c’est bien Art Tatum. Mais je ne pouvais pas l’égaler, j’avais une main gauche assez faible. Je jouais bien. En tant que pianiste de bar, j’avais un certain toucher, même si je n’avais pas la main gauche hallucinante d’Art Tatum ou de Count Basie. En tant que lyricist, Cole Porter est le plus grand pour moi. Quoique Ira Gershwin, le frère de George, c’est pas dégueulasse non plus.
A l’école, quels étaient les défauts et les qualités que l’on voyait en vous ?
II y avait déjà un a priori sur le fait de s’appeler Ginzburg. Ils écorchaient toujours ce nom, sous prétexte de faire comprendre qu’ils connaissaient mes origines. Ça me faisait chier. C’est pour ça que j’ai ajouté plus tard le “a” et le “o”. Ça a donné Gainsbourg, autrement c’était Jinzburg, Jinzberg, enfin c’était n’importe quoi. Mais ça me blessait, parce que je me sentais un petit immigré. Et juif de surcroît.
“Enfant, je n’avais pas de copains, j’aimais la compagnie d’hommes d’âge mûr”
Les autres enfants pouvaient-ils être cruels eux aussi ?
Non, non, j’étais solitaire dès ma première enfance. Je jouais seul dans mon coin. C’était ma nature, j’étais déjà misanthrope.
>> A lire aussi : Serge Gainsbourg : les années pop, zip, shebam, pow !
Pas encore misogyne ?
Ah non ! Je me souviens d’un moment fulgurant sur une plage de Deauville ou de Biarritz, où mon père jouait l’été dans les casinos – c’était avant les congés payés. Nous étions donc privilégiés : des petits enfants, mes sœurs et moi, qui allions dans les stations balnéaires, comme les gosses de riches. Et il y a une petite fille – je devais avoir 7 ou 8 ans. Nous avons eu un échange de regards que je n’oublierai jamais. C’était d’une grande pureté.
Je me souviens de cette petite, très mignonne. Avec, en fond musical, une chanson de Trenet diffusée sur la plage par des haut-parleurs : “J’ai ta main dans ma main, qui joue avec tes doigts, j’ai mes yeux dans les yeux et partout dans le loin”… Voilà, sur cette chanson je vois cette petite fille. Je n’avais pas de copains. J’aimais la compagnie d’hommes d’âge mûr. Plus tard, j’ai été copain avec un vieux monsieur qui avait une gueule à la Victor Hugo, qui était un poète en exil, du temps de Franco. “Mon p’tit gars, si tu veux t’initier à la poésie, il faut que tu apprennes l’anglais, l’allemand, le russe tu connais, il faut lire la poésie dans sa langue.”
Quelles étaient vos relations avec votre mère ?
C’était une affection sublime, ma maman… Le jeudi, on avait le droit d’aller à la boulangerie pour s’acheter un gâteau… (sourire) Et mon père me disait : “Ne traverse pas seul (ça, c’était du temps de la communale), demande qu’on te fasse traverser.” Alors je demandais, en levant les yeux : “Monsieur, est-ce que vous pouvez me faire traverser la rue ?” Et le monsieur disait : “Bien sûr, mon petit garçon” … (sourire) C’était rue Chaptal, dans le IXe arrondissement. C’est étonnant, parce que la Société des auteurs était à quelques centaines de mètres. Prémonition. Je vous ai parlé de mon entrevue avec Fréhel ? J’étais rue Chaptal et j’avais la croix d’honneur – j’étais un bon élève à l’époque.
Croix d’honneur, donc vareuse bleu marine avec un liseré rouge. Fréhel vivait près de la rue Chaptal, elle passait donc dans la rue. Un jour, mon père me la montre par la fenêtre et me dit : “Tu vois, c’est la plus grande chanteuse réaliste.” Je voyais une espèce de tas aviné en peignoir à fleurs, un pékinois sous chaque aisselle et le gigolo à distance réglementaire, à quinze mètres. Un jour, je reviens avec cette croix d’honneur et Fréhel me voit. Elle me passe la main dans les cheveux : “T’es un bon p’tit gars, et tu vas prendre un coup avec moi.” C’était en 1936, 1937, j’avais 8 ans. On s’est assis à la terrasse, elle a pris un ballon de rouge et m’a donné ce qu’on appelait un diabolo grenadine. Ce sont des images qui viennent d’années lointaines, mais qui restent fixées dans ma mémoire comme des plaques photographiques. Prémonition déjà de ma carrière.
 En 1934 © Hulton Archive/Getty Images
En 1934 © Hulton Archive/Getty Images
Avec votre père, les rapports semblaient moins idylliques qu’avec votre mère.
Je crois que j’ai commis une faute irréparable avec mon père : c’est de ne pas m’en être fait un ami quand je suis passé de l’adolescence à l’âge adulte. Lui était très réservé, moi aussi. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, un contresens qui me choquait quand j’étais petit. Il prenait sa ceinture, carrément, et ça y allait sec. Il me faisait mal, alors je pleurais, évidemment… Quelle sorte de bêtise ai-je pu faire pour mériter ce genre de punition carcérale ? Je ne sais plus, des conneries. Ce que je ne comprenais pas, c’est qu’après, au dîner, il était très affectueux, il s’excusait. Et dans ma petite tête d’oiseau, je me disais : “Mais comment, il était méchant, ben qu’il reste méchant. Pourquoi il s’excuse ? C’est un non-sens.” Alors que c’était de l’affection. Juste avant que le sommeil me prenne, les larmes coulaient sur mes joues, je sentais rouler ces perles, et là, j’avais une espèce d’extase, je me souviens très bien de ça, d’extase… Dans la recherche d’un idéal négatif, où je me disais : “Je suis le plus malheureux petit garçon de la terre.” (rires)
Lui reprochez-vous de ne pas avoir su établir ces rapports d’amitié entre vous ?
Oh non, je n’ai aucun reproche à lui faire. Il m’a très bien élevé, très bien guidé. Il était au carrefour de toute ma destinée puisqu’il m’a mis à la peinture, à l’architecture, au piano, à la lecture des grands écrivains… C’est même lui qui un jour a ouvert un canard et a vu qu’il y avait un hôtel particulier à vendre, rue de Verneuil.
Comment avez-vous vécu la guerre ?
A l’âge de 11 ans, j’ai commencé à porter l’étoile jaune – c’est quand même dur pour un p’tit gars. Je me souviens qu’à l’atelier venait un officier SS qui posait son chevalet à côté de moi. Et là, c’était le no man’s land, il n’y avait pas de politique, pas de guerre, l’atelier, c’était sacré. Un jour, c’était ma première émotion animale, une jeune femme, assez jolie – que je laisse passer car j’étais déjà courtois avec les jeunes filles –, va dans un coin et se déshabille. Bien sûr, c’était un modèle. Moi, je travaillais au fusain sur les plâtres, sur les statues grecques, romaines et décadence romaine. De voir ce nu, il y avait quelque chose d’instinctuel qui me disait qu’il devait se passer quelque chose. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai eu mon initiation animale.
Etiez-vous déjà très lucide sur ce qui se passait autour de vous, sur la signification de l’étoile jaune ?
J’avais beaucoup d’arrogance déjà, je demandais à ma mère que mon étoile soit nette. Après, on a commencé les sévices. Il fallait donc qu’on se casse – mes sœurs dans un collège religieux et moi dans un collège laïc en province. Où, un jour, le proviseur me dit : “Mon petit Ginzburg, il va y avoir une descente de miliciens pour savoir s’il n’y a pas de sémites ici ; alors tu vas prendre cette hache et tu vas aller t’enfoncer dans les bois. Si tu rencontres un SS, ou un type de la Wehrmacht, ou un milicien, tu dis que tu es un fils de bûcheron.” Avec le temps, c’est comme un conte de Perrault, mais sur l’instant, c’était assez dur. Quoique les bois, avec les oiseaux… J’y suis resté deux, trois jours, des petits enfants sont venus m’apporter des victuailles. Ensuite, on m’a dit : “Ils sont passés, tu peux revenir.” Pendant ce temps, mon père est passé en zone libre, parce qu’il était interdit aux juifs de travailler dans les bars, dans les boîtes. Il me faisait parvenir de l’argent.
C’était la première séparation avec votre famille.
Mais j’étais déjà adolescent et puis j’avais compris, on jouait notre peau.
Comment êtes-vous passé de l’enfance à l’adolescence ?
A mon insu, sans coupure. Je suis resté adolescent très longtemps. En même temps naïf et très lucide. Ce qu’a dit l’autre jour Peter Ustinov n’est pas con : il a dit que quand on devient âgé on retrouve la candeur de sa première jeunesse, l’enfant rejoint l’homme âgé. Je retrouve la pureté de mon enfance dans les rapports avec Charlotte et surtout avec mon fils.
Visiblement, le cadre familial de votre enfance était assez agréable…
Oui, très chaleureux, très simple mais très chaleureux.
“J’ai été initié à la peinture par de grands maîtres”
Le sentiment de tristesse qui, malgré tout, plane sur l’enfant puis sur l’adolescent que vous étiez n’est-il dû qu’aux événements historiques ?
Mon père me tenait au courant de ce qui se passait politiquement. Il y a eu la guerre d’Espagne en 1936, ensuite le démantèlement de l’Empire français, puis la Grande Guerre, l’hitlérisme. J’avais quand même conscience d’être dans un monde assez cruel. Je me suis enfui très vite dans les contes… Et aussi dans mes rêveries. Et puis je fantasmais sur le bord des trottoirs. Je me disais : “Voilà, je suis au bord d’un précipice et la rigole c’est un fleuve, je suis au bord de la falaise”, comme ça j’allais à l’école. Mais l’enfance est perturbée par les études : peu à peu, on nous retire notre personnalité…
En grandissant, êtes-vous toujours resté le chouchou de votre mère ?
Oui ! Ma mère n’a jamais porté la main sur moi. En revanche, elle laissait mon père me corriger. Elle laissait un temps et puis elle arrivait à mon secours. Il prenait carrément sa ceinture, et c’était dur… Mes sœurs étaient gentilles, bonnes élèves, premières, brillantes. Elles sont allées jusqu’aux licences… Et moi, je suis passé à la peinture. A l’âge de 13 ans, il m’a emmené dans une académie de peinture où j’ai été initié parallèlement à la musique classique et à la peinture. Viré du lycée Condorcet, je suis passé en archi, aux Beaux-Arts. C’était une astuce pour baiser mon père. Je lui ai dit : “Je vais faire archi”, il m’a répondu : “Mais c’est très bien.” Je suis allé aux Beaux-Arts (il ne fallait pas le bac à l’époque) et, un an après, écœuré par les hautes études mathématiques, je suis revenu à la peinture. J’ai été initié par de grands maîtres, dont Fernand Léger.
Et à l’amour ?
J’ai été initié à 17 ans, tardivement, par une prostituée de Barbès. Il y avait cinq jeunes femmes qui faisaient le trottoir et, par émotion, j’ai pris la plus toc. Emoi quand la porte s’est refermée… Et puis je trouve ça dégueulasse, je me dis : “Attends, dans quoi je m’enfonce ? Abject.” Elle me dit : “Mon p’tit gars, tu es très doué !” (rires)… Après, une blessure terrible. Je rencontre la petite-fille de Tolstoï, ou l’arrière-petite-fille.
Une jolie petite Ruskoffe, blanche. Je fantasmais sur son parfum – elle avait un parfum capiteux qui était étonnant, très envahissant, très… lourd, de promesses non tenues. Mon père m’avait donné une chambre mansardée pour que j’en fasse un atelier, parce que je continuais un peu à peindre, sporadiquement. Et j’amène cette fille, qui était pucelle, sur mon petit lit de camp. Je suis sur elle et elle prend peur. Je lui dis : “Bon, ben si tu as peur je ne te touche pas, tu reviendras demain.” Elle n’est jamais revenue. Ça, ça a été le commencement d’une misogynie forcenée. Elle m’a blessé, oh la vache…
J’étais extrêmement malheureux quand elle m’a lâché. J’aurais pu la violer, je la vois sous moi, je la vois encore, nue. J’étais désespéré, c’était une garce finie, elle n’est jamais revenue. Je faisais le pied de grue devant chez elle, elle me dédaignait. Première blessure. Donc misogynie qui commence à se dessiner gravement. J’ai eu ma revanche quelque vingt ans plus tard, en 1960 – c’était la guerre d’Algérie. J’avais fait L’Eau à la bouche, l’une de mes premières chansons qui marchait, j’étais célèbre déjà et, à Alger, ils me voulaient… Là, on m’envoie une carte de visite : “Olga Tolstoï, et puis un autre nom (elle s’était mariée), aimerait vous voir.” Et je revois cette fille, usée par les ménages et les enfantements, que je reconnais à sa dentition, à son sourire. Là, elle était d’accord, mais moi je ne l’étais plus.
Vous parlez de misogynie. Etait-ce vraiment un sentiment profond ou de la parade ?
C’était déjà latent avec cette première idylle foireuse, ensuite c’était dans mon destin, c’était déjà inscrit… inscrit au vitriol. En fait, j’étais un vitriolé.
>> A lire aussi : En 2021, Gainsbourg est-il devenu problématique ?