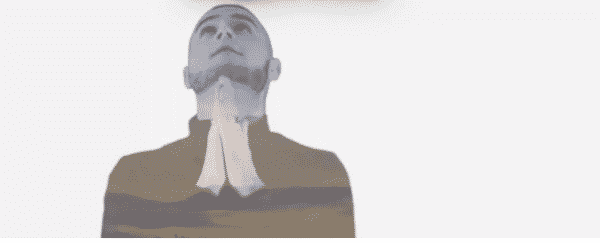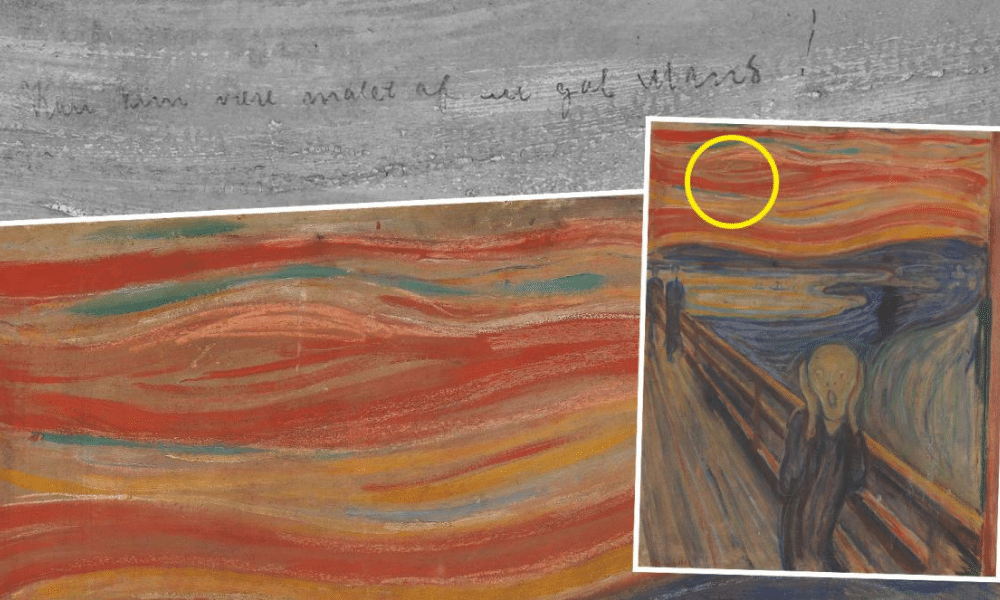Sparks, cinquante ans au top de la pop
“Le groupe préféré de votre groupe préféré.” C’est par cette formule maligne qu’Edgar Wright qualifie Sparks sur l’affiche de The Sparks Brothers, l’opulent documentaire qu’il consacre aux frères Ron et Russell Mael à l’occasion des 50 ans leur...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
“Le groupe préféré de votre groupe préféré.” C’est par cette formule maligne qu’Edgar Wright qualifie Sparks sur l’affiche de The Sparks Brothers, l’opulent documentaire qu’il consacre aux frères Ron et Russell Mael à l’occasion des 50 ans leur 1er album.
En deux heures et vingt minutes frénétiques, éblouissantes, fantasques et tordantes, le réalisateur britannique de Baby Driver (2017) aura déployé les grands moyens et beaucoup d’astuces visuelles et narratives pour tenter de répondre à cette interrogation : pourquoi l’un des groupes les plus influents de toute l’histoire de la pop est-il encore aussi mal connu ?
Vu des États-Unis, d’où le duo est originaire, l’énigme est encore plus épaisse car Sparks n’a jamais véritablement connu le succès qui l’a furtivement mis en lumière à des périodes différentes dans certains bastions européens.
En Angleterre dans les années 1970, en France et en Allemagne au cours des années 1980 et sur l’ensemble du continent en 2015 lors de sa fusion avec Franz Ferdinand le temps d’un album sous le nom de FFS. Plus de quarante ans après un projet avorté avec Jacques Tati, un film baptisé Confusion que le réalisateur de Mon oncle n’est jamais parvenu à financer, c’est encore un Français et encore un film qui propulsent en cet été qui promet d’être étincelant le nom de Sparks au fronton des cinémas.
Une pierre angulaire de la pop internationale
Dans le dossier de presse d’Annette, Leos Carax confesse avoir volé leur album Propaganda (1974) à l’âge de 14 ans et être allé les voir dans la foulée à l’Olympia, donnant au passage une définition personnelle de l’art sparksien à laquelle on ne peut que souscrire : “Ces chansons sont, parmi celles que je connais, celles qui me donnent le plus fort sentiment de joie, pourtant elles sont poignantes aussi par endroits. La musique de Sparks est pour moi comme une maison d’enfance, mais vide de fantômes.”
Quant à Edgar Wright, il a rameuté sans les prier un casting stupéfiant de musiciens de toutes les époques (de Steve Jones des Sex Pistols à Duran Duran en passant par Beck, Thurston Moore, Björk, Alex Kapranos ou les membres de New Order ou de Red Hot Chili Peppers) parmi tous ceux qui considèrent le duo californien comme une pierre angulaire de la pop internationale, ainsi que trois de leurs producteurs emblématiques, Todd Rundgren, Tony Visconti et Giorgio Moroder, qui ont accompagné certaines de leurs métamorphoses insensées depuis un demi-siècle.
Car Sparks est un cas unique, presque une anomalie par sa longévité, son endurance et le kaléidoscope de styles contenus dans ses vingt-cinq albums, certains des plus brillants étant parus depuis les années 2000. Quel autre groupe au monde peut s’enorgueillir d’avoir été des poster boys du temps du glam rock, des héros du disco, un modèle déposé (le type mutique au clavier et le chanteur feu follet) pour toute l’electropop des années 1980, de Soft Cell aux Pet Shop Boys ou Bronski Beat, d’aligner dans son fan-club les noms de Ian Curtis, Morrissey, Kurt Cobain ou Paul McCartney (qui apparaît grimé en Ron Mael dans le clip de Coming Up en 1980), d’avoir fait des duos avec Les Rita Mitsouko, un featuring sur le dernier SebastiAn (Handcuffed to a Parking Meter) et d’avoir joué dans un film catastrophe (Le Toboggan de la mort, de James Goldstone en 1977) ?
“Il arrive que l’on soit fatigués l’un de l’autre, plaisante Ron Mael, mais jamais lorsqu’on fait de la musique ensemble, c’est ce qui importe.” Et son frère cadet d’enchaîner : “Nous avons depuis toujours une vision parfaitement synchrone de ce que nous voulons faire. C’est ce qui fertilise notre travail au quotidien et fait que l’on ne se lasse jamais de travailler l’un avec l’autre. Nous n’avons jamais connu ce syndrome des frangins dans un groupe qui finissent par se taper dessus comme les Kinks ou Oasis, Dieu merci.”
Nourris aux films et au rock’n’roll
Dans les prodigieuses images de jeunesse qu’ils ont confiées à Edgar Wright, on les voit constamment collés l’un à l’autre, jusqu’à apparaître parmi les spectateurs d’un concert des Ronettes au début des années 1960. Ron n’est pas encore ce Chaplin émacié et inquiétant, il est même un peu en surpoids, et Russell n’arbore toujours pas ses bouclettes, mais leur vie a déjà connu des épisodes cocasses et douloureux dont les fils entremêlés constituent le roman type de l’Amérique des classes moyennes de l’après-guerre.
Ils sont nés successivement en 1945 (Ron) et 1948 (Russell) dans une famille de descendants juifs russes et autrichiens, d’un père dessinateur et caricaturiste et d’une mère bibliothécaire, installés dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Durant leur prime enfance, ils posent en photo dans des catalogues de vente par correspondance, avant de grandir dans les salles de cinéma où leur père a décidé d’aiguiser leur regard, nourrissant également leurs oreilles des 1ers disques de rock’n’roll.
La disparition précoce de Meyer Mael agit comme un foudroiement d’adolescence d’où ils continuent six décennies plus tard à faire remonter leur désir vital d’embellir leur futur à travers un art joyeux et pétri d’érudition taquine : “Ce fut un choc très perturbant”, dit Ron Mael, qui conserve précieusement les 78t d’Elvis et de Little Richard qui appartenaient à son père.
“Je les ai placés dans un endroit, sous une table, qui permettra de les épargner en cas de tremblement de terre. Les enfants grandissent avec l’idée que leurs parents mourront vieux, mais lorsque ça ne se produit pas comme prévu, on perd au passage une forme d’invulnérabilité que l’on s’était fabriquée. Comme notre père était un grand amateur de musique, qu’il nous a fait découvrir des choses qui ont tellement compté pour nous, faire de la musique nous-mêmes était sans doute une façon inconsciente de continuer à le faire vivre.”
Un 1er album publié en 1971 dans une indifférence totale
C’est après la mort de leur père que Ron étudie le piano et que Russell s’oriente vers des études de cinéma à UCLA, allant même jusqu’à réaliser un petit film sous l’influence de la Nouvelle Vague, avec des noms d’acteurs français bidon, quand il ne présente pas son physique de jeune playboy sur les terrains de football ou participe à la chorale de l’université, où sa voix capable de fameux toboggans d’octaves fait déjà sensation.
Leur 1er groupe en commun, en 1966, possède un nom déjà absurde – The Urban Renewal Project. Ron y joue de la guitare, porte une vague coupe afro et une moustache de camionneur, mais son génie encore en couveuse lui a fait accoucher d’une chanson baptisée Computer Girl alors qu’il n’a jamais croisé le moindre ordinateur de sa vie – quant aux filles, cela reste encore un mystère à ce jour.

Leur second groupe, Halfnelson, auquel émargent une autre fratrie, Earle et Jim Mankey, ainsi que le batteur Harley Feinstein, sera le bon, vite repéré par Todd Rundgren, qui les signe sur son label Bearsville Records et produit leur 1er album, publié en 1971 dans une indifférence totale. Il sera pressé une seconde fois, sans plus de réussite, mais sous le nom Sparks, qui claque mieux et s’inspire de leurs idoles The Marx Brothers, dont Ron est à lui seul un genre de synthèse.
Leur deuxième album, A Woofer in Tweeter’s Clothing, publié deux ans plus tard, esquisse plus précisément un style, mélange de rock trépidant et d’exubérance théâtrale, en décalage total avec la Californie du folk-rock et des campus protestataires. En tournée en Angleterre, le groupe découvre en revanche sa Terre promise, celle des fantaisies pailletées du glam que T. Rex et Bowie font éclore dans le cœur des teenagers en croisant rock primitif, mélodies pop et transgression queer dans une orgie électrique et baroque.
La bascule Top of the Pops
Ron et Russell Mael, anglophiles convaincus depuis que leur mère les a conduits en voiture jusqu’à Las Vegas pour aller applaudir les Beatles en 1964, reviennent à Londres sans le reste du groupe, embauchent des musiciens sur place capables de porter à ébullition leurs chansons folles, décrochent un contrat chez Island Records et approchent du bingo le plus réjouissant des années 1970.
La 1ère fois qu’ils se pointent à Top of the Pops, le producteur les vire lorsqu’il se rend compte qu’ils sont américains et qu’ils n’ont pas le permis de travail nécessaire selon les règles de la BBC. La seconde est une déflagration.
Des millions de Britanniques découvrent à la fois une chanson qui rebondit comme une guêpe sous amphétamines sur des orchestrations en pièce montée et un duo chant-clavier qui transperce le tube cathodique. Le fabuleux This Town Ain’t Big Enough for Both of Us n’est même pas achevé que John Lennon lui-même décroche son téléphone pour appeler Ringo Starr : “Tu ne croiras pas ce que je viens de voir à la télé. Marc Bolan joue un morceau avec Adolf Hitler !”
Le single s’écoule à 200 000 exemplaires dès le lendemain, et Sparks éclabousse l’année 1974 de son extravagance radioactive en plaçant deux albums, Kimono My House et Propaganda, dans le Top 10. Les textes de Ron Mael, emplis à ras bord de références à la pop culture comme au music-hall et assaisonnés d’allusions salaces, passent au-dessus de leur public ado qui se contente de ses musiques et mélodies tout aussi foisonnantes et tordues, témoignant d’une évidence dont leurs suiveurs, Queen en tête, sauront faire leur miel.
Enfants de Doris Day ?
En entrevue, le groupe s’amuse à expliquer n’importe quoi, comme lorsqu’ils lâchent à un journaliste que leur mère n’est autre que l’actrice et chanteuse Doris Day. “C’était une blague, rigole encore aujourd’hui Ron Mael, mais elle nous a poursuivis pendant longtemps, au point que cela figure encore dans certaines biographies. Un jour, nous avons même reçu un chèque de royalties que nous avons dû remettre à Terry Melcher, le producteur, qui lui était le vrai fils de Doris Day.” À sa mort, en 2019, jamais à cours d’une fantaisie, le compte Twitter du groupe publiait un montage photo des frères Mael avec Doris Day et un message saluant la mémoire de leur (fausse) maman.
Au creux des années 1970, l’euphorie n’a pas duré, et le pourtant génial Indiscreet (1975), produit par Tony Visconti, marque le pas commercialement, le groupe tentant un coup un peu foireux en publiant en single une reprise anachronique d’I Want to Hold Your Hand des Beatles orchestrée façon Broadway.
Le public ne répond plus à l’appel excentrique d’un groupe capable d’intituler une chanson The Wedding of Jacqueline Kennedy to Russell Mael ou d’en consacrer une autre à l’allaitement (Tits) et ses ravages sur la vie sexuelle des couples. Résultat des courses, les frères Mael plient leurs gaules et repartent tenter leur chance à la maison mère, auréolés de leur éphémère succès européen qu’ils dilapident dans l’indifférence brutale que leur opposent toujours les Américains.
À part la fantastique pochette signée Richard Avedon, qui leur colle une image outrageusement gay dont ils n’ont jamais confirmé l’authenticité, le plus rugueux Big Beat (1976), qui témoigne d’un bref passage à New York, ne fait pas d’étincelles, pas plus que Introducing Sparks l’année suivante pour leur retour en terre californienne, influences Beach Boys incluses. Un coup de bluff génial va encore changer le cours des choses.
La greffe Gorgio Moroder
“Nous répondions à une question d’une journaliste allemande qui nous demandait avec qui nous allions faire le prochain album. On avait adoré I Feel Love de Donna Summer, alors on a répondu Giorgio Moroder, avec qui nous n’avions pourtant aucun contact. Il se trouve que la journaliste, elle, connaissait Moroder. On s’est arrangés pour qu’elle nous le présente.”
Enregistré entre Munich et Los Angeles dans un environnement uniquement constitué de machines électroniques, N°1 in Heaven représente un virage à 180 degrés par rapport à tous leurs albums précédents, mais le caméléonisme des frères Mael provoque à nouveau un choc thermique heureux au contact des cavalcades synthétiques du maître de l’italo-disco, et La Dolce Vita, Beat the Clock et surtout The Number One Song in Heaven leur permettent de se refaire une santé commerciale.
Ils posent surtout les charpentes d’une esthétique pop électronique qui irradiera la décennie 1980. Dans les chambrettes de Basildon où Depeche Mode est encore en construction comme sur la platine des membres de Joy Division et futurs New Order qui font tourner l’album en boucle lors de l’enregistrement de Love Will Tear Us Apart, le vieil escadron Sparks a encore indiqué le futur.
Artistiquement, pourtant, le duo va pas mal s’éparpiller au cours des années 1980, malgré un autre album avec Moroder, Terminal Jive (1980), assez laborieux mais qui leur offre leur unique gros tube français, le joli et virevoltant When I’m with You. Leurs tentatives un peu désordonnées de revenir à leur style d’origine sur Whomp That Sucker (1981) ou Angst in My Pants (1982) possèdent un charme qui manque toutefois de consistance.
Plantés par Tim Burton
Sur les albums qu’ils publient en rafale au cours des années suivantes leur son finit par se calcifier en une sorte de musique de club mal fichue ou de pop anémiée dont ils confessent involontairement l’essoufflement en intitulant l’un de leurs morceaux Sparks in the Dark. Seule la parenthèse bienvenue que leur offrent Les Rita Mitsouko en 1988 en enregistrant deux titres en commun, dont le hit du Top 50 Singing in the Shower, sauve la décennie du naufrage.
Si un trou de sept ans, faille unique dans leur discographie, sépare le médiocre Interior Design de 1988 et leur retour en fanfare avec Gratuitous Sax & Senseless Violins de 1994, c’est parce que les frères Mael se sont fait balader une nouvelle fois dans le labyrinthe d’un projet cinéma – une adaptation musicale du manga Mai, the Psychic Girl – avec Tim Burton aux manettes, qui les plantera pour aller faire L’Étrange Noël de monsieur Jack.
Mais un nouveau single tapageur et futé, When Do I Get to Sing “My Way”, replace ces increvables sur l’échiquier pop des années 1990, où leur musique devient une sorte de concentré énergique de toutes les périodes précédentes, du disco à l’opéra pop, au point qu’ils ressortent sous le nom Plagiarism (1997) des nouvelles moutures assez plaisantes de leurs singles, avec en invités Jimmy Somerville, Erasure ou, hum, Faith No More.
Un XXIe siècle particulièrement prolifique
Personne, en revanche, ne s’attend au choc que va provoquer Lil’ Beethoven à l’entrée des années 2000. Un disque d’une inventivité prodigieuse, enregistré avec un orchestre et un chœur classiques, qui s’inscrit dans les traces de Steve Reich et de John Adams, jouant avec des formes hypnotiques (la même phrase répétée 204 fois sur My Baby’s Taking Me Home) tout en perpétuant leur esprit de ludions iconoclastes qui culmine sur le bouleversant I Married Myself.
En 2008, ils se lancent dans un pari aussi fou que merveilleux : jouer sur scène les vingt et un albums que compte leur catalogue à l’époque. Pas moins de 266 chansons répétées en quatre mois et jouées dans l’ordre chronologique, face B comprises, en vingt et une soirées uniques et déraisonnables, vues d’aujourd’hui par Ron comme “un piège qui s’est refermé sur nous avec notre assentiment. Mais qui nous a permis de réévaluer certains albums en leur accordant un nouvel éclat”.
Depuis, ils n’ont pas chômé, quatre autres disques de haute volée sont venus épaissir leur turbulent corpus, dont les derniers et très réussis Hippopotamus (2017) et A Steady Drip, Drip, Drip (2020), alors qu’un nouveau est déjà annoncé pour l’an prochain.
D’ici là, leur nom scintillant aura sans doute piqué au vif la curiosité des spectateurs d’Annette, aussi sûrement que la bande originale du film et son irrésistible So May We Start auront fait de nouveaux adeptes en Sparksophilie. Rien n’est ainsi plus réjouissant en 2021 que d’imaginer Ron et Russell Mael, 146 ans à eux deux, fouler le tapis rouge de Cannes, se voir enfin célébrés à la hauteur de leur génie burlesque et devenir, qui sait, le futur groupe préféré de ceux et celles qui ne les connaissent pas encore.
Sparks, Annette, a film by Leos Carax – Selections from the Motion Picture Soundtrack (Milan/Sony Music). Sortie le 6 juillet
The Sparks Brothers d’Edgar Wright (G.-B., E.-U., 2021, 2 h 15). En salle le 28 juillet