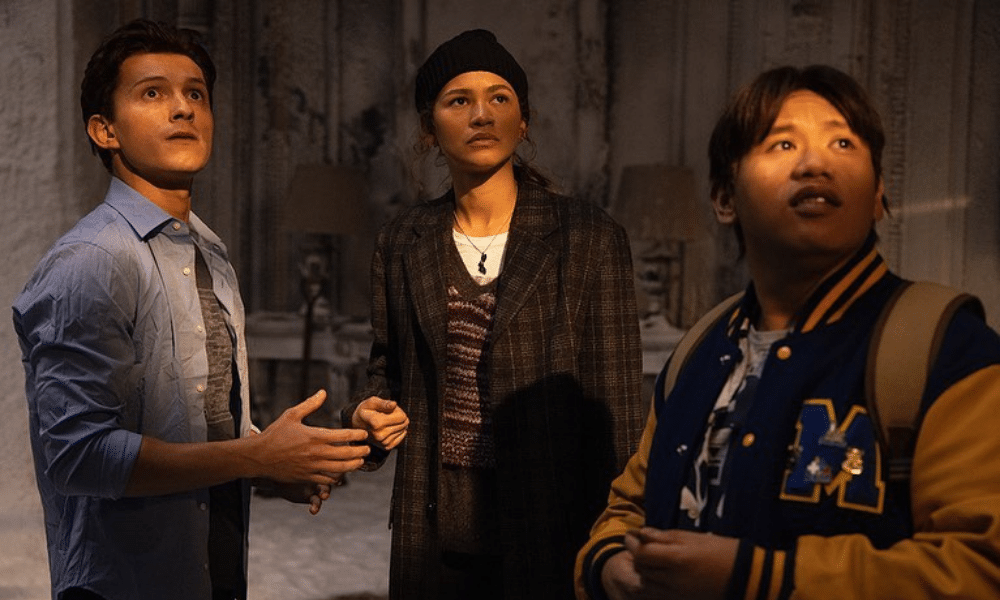Tahar Rahim : “J’ai tout fait pour prendre la place dont je rêvais”
Depuis sa révélation dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009, Tahar Rahim a imprimé au cinéma français sa silhouette féline et son jeu instinctif, tissant des personnages sur le fil de la loi (Gibraltar de Julien Leclercq en 2013, Les Anarchistes...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Depuis sa révélation dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009, Tahar Rahim a imprimé au cinéma français sa silhouette féline et son jeu instinctif, tissant des personnages sur le fil de la loi (Gibraltar de Julien Leclercq en 2013, Les Anarchistes d’Elie Wajemanen en 2016) ou brûlés aux rayons d’amours impossibles (Love and Bruises de Lou Ye en 2011, Grand Central de Rebecca Zlotowski en 2013). Alternant les grosses productions et les films d’auteur plus intimistes, sa carrière s’est rapidement déployée à l’international, sondant les blessures du génocide arménien sous le regard de Fatih Akin (The Cut, 2014) ou donnant vie à Judas dans Marie Madeleine de Garth Davis en 2018.
On le retrouve cette année dans deux rôles diamétralement opposés : celui de Mohamedou Ould Slahi, Mauritanien emprisonné à tort pour suspicion de terrorisme dans Désigné coupable de Kevin MacDonald (sortie prévue en juin), et celui de Charles Sobhraj, célèbre tueur dont la série britannique Le Serpent, disponible sur Netflix, retrace la traque et les méfaits. Look 70’s, cheveux lissés et prothèses faciales, il y compose une partition glaçante et à contre-emploi. L’occasion de faire le point sur son approche du métier d’acteur.
Qu’est-ce qui t’a intéressé dans le rôle de Charles Sobhraj ?
Tahar Rahim — J’ai toujours voulu explorer le mal chez un personnage, comme on a envie d’étudier d’autres langues. En déroulant le script que m’ont adressé les Anglais, je lis « escroc », « meurtrier », « tueur »… Et puis je vois le nom de Charles Sobhraj. Quand j’avais 16 ans, j’avais lu le livre de Richard Neville (The Life and Crimes of Charles Sobhraj) qui traînait sur la table de chevet de mon frère. Il m’avait fasciné autant qu’effrayé, mais j’étais suffisamment naïf pour ne pas me rendre compte de l’horreur qu’il relatait. Ce que je voyais en 1er lieu, c’était un acteur qui ne cessait de changer d’identité, qui avait du bagou et du charme, qui cambriolait et s’évadait de prison… et qui était français ! Donc j’ai un peu fantasmé l’idée de l’interpréter un jour.
Quand j’ai rencontré l’équipe du Serpent, je leur ai raconté cette histoire, en ajoutant des détails qui ont mené à la réécriture de certaines scènes. Une fois sorti de la pièce, Tom Shankland, le réalisateur des quatre 1ers épisodes, aurait dit à Richard Warlow, le scénariste : « S’il nous a menti, c’est notre homme parce que je l’ai cru. » Je sais que ça paraît étrange que je connaisse cette histoire, mais non, je n’ai pas menti.
Tu as fait beaucoup de recherches sur le personnage en amont du tournage ou tu y as insufflé une grande part de fiction ?
J’ai fait beaucoup de recherches. D’abord, j’ai utilisé tous les éléments fournis par la production : des écrits, des témoignages, des enregistrements audio de Charles et les rares vidéos de lui. J’ai également rencontré Stéphane Bourgoin, spécialiste du profilage criminel et des tueurs en série, pour appréhender la psychologie de ce genre de personnages, comment on devient un terrain fertile à de tels agissements. Mais comprendre ne veut pas dire excuser : quand on décide de faire le mal, c’est un choix qu’on fait.
Tu es méconnaissable dans la série, de par ta transformation physique, la rigidité de ta posture, l’imperméabilité de ton visage… Comment as-tu bâti cette armure ?
J’avais les éléments nécessaires pour construire mon personnage de l’intérieur mais je n’y arrivais pas, parce que je ne trouvais pas de connexion directe avec lui – heureusement ! (rires) J’ai donc décidé de le façonner de l’extérieur, en commençant par son look, son corps, sa physicalité… J’ai fini par m’inspirer d’un animal, le cobra – ce qui, je l’apprendrai plus tard, était un des surnoms donnés à Charles. Pour son mélange de froideur et de charme, sa façon de chasser et son caractère hypnotique. Mais ça ne suffisait toujours pas parce que j’avais besoin de ressentir quelque chose à l’intérieur.
Trois choses se sont passées. J’avais vraiment besoin de me concentrer sur le plateau, qui était très animé. Je me suis souvenu de Mark Strong, un grand acteur anglais qui jouait mon père dans un film et qui m’avait dit : « Un roi ne joue pas le roi, c’est son entourage qui fait comprendre par son comportement qu’il est le roi.” J’ai donc décidé, pendant un temps, de ne plus causer à mes partenaires entre les prises. Ça a fini par créer une espèce de gêne, un mood, quelque chose d’étrange qui n’était plus à jouer.

La seconde fut la venue sur le tournage de la vraie Nadine Gires, la voisine française de Charles, qui est jouée par Mathilde Warnier dans la série. Et c’est quelqu’un qui ne mâche pas ses mots, elle pointait nos erreurs : « Ce n’est pas le même chien, c’était ça comme race…« Donc je me dis : « Quand ça va etre mon tour, elle va me faire sauter en l’air », et je l’esquive un peu. Mais le soir, à l’hôtel, mes collègues me disent : « Quand elle t’a vu, elle a ressenti la même chose que quand elle a découvert la vraie nature de Charles et qu’il était dans le coin. Elle est traversée par les mêmes peurs.«
Et la dernière chose qui a ancré le personnage en moi, la pierre angulaire, c’est une phrase qu’il dit dans l’épisode 3 : « Si j’avais dû attendre que le monde vienne à moi, j’attendrais encore. Tout ce que j’ai toujours voulu dans ma vie, j’ai dû le prendre.« Là, j’ai trouvé un lien, parce que c’est ce qui m’est arrivé en tant qu’acteur. Je venais de province, je n’avais aucun contact dans le milieu, j’ai pris mon train, j’ai travaillé, passé des castings… J’ai tout fait pour prendre la place dont je rêvais.
C’est un personnage caméléon, et pourtant ta composition est très cohérente. Comment fait-on tenir ensemble autant de facettes sans s’éparpiller ?
Je me suis posé la question de le jouer comme des personnages différents, dans le comportement, les démarches… Ça n’aurait pas marché ! Quand tu comprends que tout ça, finalement, relève du jeu, c’est plus simple. C’est un mec qui adorait jouer, avec son entourage, avec les autorités. A tel point qu’il a fini par jouer à être Dieu, à s’arroger un droit de vie ou de mort sur les gens. Mais il n’est pas schizophrène, sa personnalité profonde ne change jamais. Tout est contrôlé chez lui, il a beaucoup trop de confiance et d’ego pour s’effacer.
Dans les derniers épisodes de la série, j’ai eu l’impression de te voir réapparaître timidement entre les lignes du personnage, qu’on découvre plus jeune, plus humain… Est-ce que tu as senti une connexion avec certains de tes anciens rôles ?
Peut-être que tu ressens ça parce qu’il y a Stacy Martin en face et qu’on a déjà travaillé ensemble dans Joueurs [le 1er film de Marie Monge, sorti en 2017]. Mais l’idée de le rendre un peu plus accessible, sensible et humain, c’est parce que je voulais que la différence existe entre l’avant-meurtrier et l’après. Parce que, quand on le voit à cette époque-là, il n’a jamais tué. Le monologue de la fin de l’épisode 1, qui ne figurait pas dans la 1ère version du scénario et que j’ai tenu à ajouter, fixe ce point de bascule. Alors qu’il manquait d’argent pour aller d’une ville à une autre, il a drogué un chauffeur de taxi avant de l’enfermer dans le coffre. Au volant de la voiture, il prend une fille en stop, mais derrière ça tape, alors il drogue à nouveau le type, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il meure. Ses 1ères réactions ne sont absolument pas naturelles : il calcule comment faire pour se débarrasser du corps, il implique l’autostoppeuse dans le crime pour qu’elle n’aille pas le dénoncer à la police… A partir de là, il devient celui qu’on voit dans la série.

Le tournage de la série a été interrompu pendant plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid. Quelle influence a-t-elle eue sur ton approche du personnage et de la narration ?
De façon générale, ça a eu une influence très positive. Comme on avait beaucoup tourné avant l’interruption, l’équipe a eu plus de temps pour monter et repenser l’écriture. Mais quand on arrête la 1ère session de prises de vues en décembre 2019, ce n’est pas à cause de la Covid, mais parce qu’on est en retard. Ils veulent qu’on revienne en janvier, sauf que moi je dois aller tourner The Mauritanian [Désigné coupable, de Kevin MacDonald], un film pour lequel je dois perdre beaucoup de poids, et qui fut une tout autre expérience, pour ensuite revenir à Charles Sobhraj, en Thaïlande. Là, j’avais du mal, alors j’ai demandé à voir ce qu’ils avaient déjà monté pour pouvoir me remettre dedans, j’ai réécouté des choses, et ensuite BOUM ! Pandémie. J’ai bien vécu le 1er confinement : j’étais absent depuis neuf mois, du coup j’ai rattrapé le temps perdu avec ma famille, je me suis reposé. On a terminé le tournage quasiment un an plus tard, en août, en Angleterre et sous protocole sanitaire. Pas très agréable, mais bon, qu’est-ce que tu veux !
Ces dernières années, ta carrière internationale a pris une nouvelle ampleur. La 1ère fois que tu as tourné dans une production anglo-saxonne, c’était dans L’Aigle de la neuvième légion, de Kevin MacDonald. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience ?
Un très beau souvenir : c’était un film d’époque dans lequel je jouais un barbare, j’étais complètement peint, je devais causer en gaélique ancien… Mais je ne maîtrisais pas assez l’anglais, ce qui a limité ma relation avec Kevin. Tout le processus de confiance que tu traverses quand tu te fais un ami peut se nouer très vite avec un réalisateur. Sur ce point, j’avais une petite frustration. Heureusement, dix ans plus tard, on fait The Mauritanian ensemble, et là ça se passe super-bien.
The Mauritanian, qui relate l’histoire vraie d’un homme qui a passé des années en prison, sans inculpation ni jugement, dans des Etats-Unis en pleine paranoïa terroriste après le 11 septembre 2001, est un film avec une charge politique très forte. Comment as-tu abordé ce rôle ?
Quelque part, c’était une faveur de passer de Charles Sobhraj à Mohamedou Ould Slahi. Dans le scénario, le personnage est traversé par de la colère, de l’incompréhension, de la tristesse… Et de mon côté je ressentais une admiration sans borne pour cet homme. Parce que c’est quelqu’un qui subit encore des difficultés à vivre comme un homme libre alors qu’il n’y a aucune charge contre lui, qu’il a gagné son procès, qu’il n’est plus là-bas [à Guantánamo], et pourtant il ne peut pas rejoindre sa famille qui vit à Berlin. Le film a certes une dimension politique, mais il a aussi une magnifique aura d’humanité. C’était un tournage très éprouvant, mais qui avait du sens. Je pense que c’est le film qui m’a le plus marqué dans ma carrière.
C’est important pour toi de garder un équilibre entre la France et l’international, les grosses productions et les projets plus fragiles ?
Très vite, j’ai voulu travailler avec des réalisateurs étrangers, sans pour autant changer ma cohérence en tant qu’acteur. Ce qui me plaît, c’est d’explorer des personnages que je n’ai pas abordés avant, d’être surpris par des scénarios… C’est une idée générale directive, productrice et, par chance, prolifique. Ça réunit tout type de productions, aussi grosses soient-elles, et tout type de film, que ce soit un 1er ou un cinquième.

Jouer dans une langue étrangère, ça te met à distance du personnage ou ça t’aide à le trouver ?
Tous les outils que tu peux manier pour devenir quelqu’un d’autre sont utiles. Quand tu découvres une langue qui appartient à un personnage, tu as le sentiment qu’un lien plus fort va s’installer. Le français, on le connaît depuis qu’on est petit, on l’a retourné dans tous les sens, et encore plus quand on est acteur. S’en écarter, c’est presque redécouvrir une forme de virginité dans le jeu. Et en même temps une langue étrangère, c’est forcément une autre fréquence, d’autres mots, une autre façon de causer, de bouger le visage… C’est comme une réaction en chaîne, le corps suit, et les émotions empruntent d’autres chemins.
De La Commune au Serpent en passant par The Looming Tower et The Eddy, tu as joué dans un certain nombre de séries. Est-ce que le fait de suivre un personnage dans la durée te pousse à envisager différemment ton travail d’acteur ?
On l’envisage forcément d’une autre manière. La grammaire d’une série et celle du cinéma sont complètement différentes. Souvent, la narration télévisuelle s’étire dans le temps, et les scénaristes peuvent s’éclater à écrire plus de facettes d’un personnage. Mais ça ne veut pas dire qu’on a plus d’espace pour aller les chercher en profondeur sur le plateau. Parce qu’une scène de huit minutes existe rarement en série. Au cinéma, c’est plus fréquent. Et quand tu joues pendant huit minutes face à quelqu’un, tu creuses la situation, tu découvres des choses, parfois des accidents surviennent…
Dans The Eddy, on t’a vu chanter et jouer d’un instrument dans des conditions live. C’est quelque chose que tu aimerais explorer davantage ?
Sincèrement, j’aimerais, mais c’est très laborieux. Je n’avais jamais tripoté un instrument de ma vie, et la 1ère fois que je m’y mets, forcément c’est le plus difficile, la trompette ! Je m’en suis acheté une, mais j’aurais besoin d’un prof pour vraiment progresser. Là, je vais être obligé d’explorer le chant et la danse pour un tournage à venir. La danse, ça me fait triper, le chant, c’est plus difficile. Mais bon, à partir du moment où il y a un challenge et que j’ai le sentiment qu’il est possible que je faillisse, ça m’excite.
Quels seraient tes désirs de jeu pour les prochaines années ?
D’abord, continuer à travailler en France comme à l’étranger. Et explorer des mythologies qu’on n’a pas ici. Par exemple, j’adorerais me retrouver dans un western, ou alors me promener davantage en Asie, où il existe un cinéma très fort. Ou jouer un super-héros qui balance des boules de feu dans le ciel ! Le cinéma, ce n’est pas que le sérieux, le politique, c’est aussi le divertissement. Faire des comédies, ça me brancherait. J’en ai tourné deux, sans recevoir de propositions derrière, mais ça viendra !
Que dirait le Tahar de 20 ans si on lui révélait sa carrière à venir ?
« T’as eu raison d’être naïf et rêveur. »
Et aujourd’hui, quel regard jettes-tu sur tes quinze ans de tournages ?
Ils m’ont appris qu’il fallait faire confiance à ses choix, rester patient, et ne pas avoir peur de travailler. Qu’il fallait savoir dire non, aussi. L’important c’est d’avancer tout en se laissant surprendre.
Le Serpent de Richard Warlow et Toby Finlay avec Tahar Rahim, Stacy Martin, Billy Howle. Sur Netflix






















![Plus belle la vie en avance : résumé de l'épisode du lundi 17 octobre 2022 [SPOILERS]](http://fr.web.img3.acsta.net/newsv7/22/10/13/11/50/1856008.jpg?#)