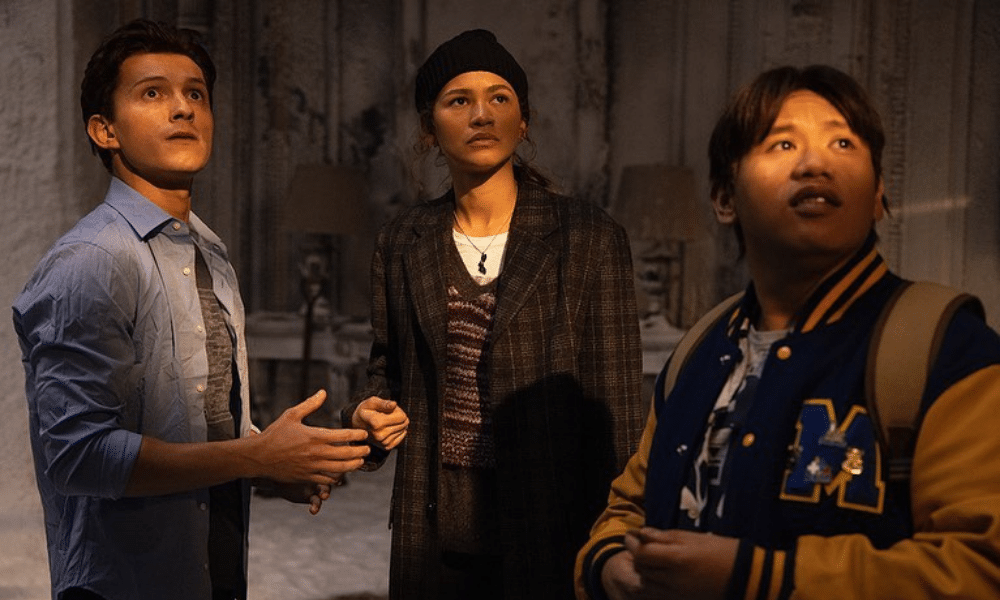Une dernière nuit avec Steve Albini
C’était un mercredi 8 mai 2024 en Bourgogne, à contempler les vignes de Fixin depuis le jardin, quelque part sur la route des Grands Crus. Ce qui devait être un jour férié sans histoires s’est terminé dans le brouhaha de batteries martyrisées...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

C’était un mercredi 8 mai 2024 en Bourgogne, à contempler les vignes de Fixin depuis le jardin, quelque part sur la route des Grands Crus. Ce qui devait être un jour férié sans histoires s’est terminé dans le brouhaha de batteries martyrisées et les hurlements abrasifs de guitares et de ces mots mâchés, qui tentent de surnager au milieu du vacarme puis sont recrachés comme on balance des insanités.
Steve Albini venait de mourir, la tuile, victime à l’âge absurde de 61 ans d’une crise cardiaque dans le studio d’enregistrement qu’il avait monté en 1997 à Chicago, Electrical Audio. Un peu comme si Mario passait soudainement l’arme à gauche, là, sous l’évier de votre cuisine, une clé de douze à la main – Steve se voyait d’ailleurs comme une sorte de plombier, c’est ainsi qu’il s’est présenté à Nirvana avant l’enregistrement d’In Utero (1993). Albini mort, plus question dès lors d’écouter du folk au coin du feu, dans la nuit de la côte de Nuits, avec une tisane de pissenlit.
J’aurais pu me repasser We All, Us Three, Will Ride, belle ballade triste à pleurer extraite de Viva Last Blues (1995), l’album de Palace Music, ou Things We Lost in the Fire (2001) de Low, avec ce morceau si poignant chanté par Mimi Parker, Laser Beam. Ou, je sais pas, Dogs (2000), le 1er album de Nina Nastasia, avec les cordes et la guitare délicate de Stormy Weather. Chacun de ces disques a été produit par Steve Albini, qui savait aussi faire dans la dentelle. Mais non, je voulais sentir la brutalité instinctive du type, son côté râpeux, indocile, morveux, colérique, et épuiser les réserves d’électricité de la centrale nucléaire la plus proche.
Tout naturellement, j’ai lancé Big Black, son 1er vrai groupe, en commençant par le début : l’EP Lungs (1982). Industriel comme c’est pas permis, avec cette boîte à rythmes glauquissime qui annonçait presque paradoxalement le son reconnaissable entre mille des batteries heavy et imposantes made in Albini. Le moment est vite venu de passer à Atomizer (1986), le 1er album, avec son ouverture stoogienne (les cris de jouissance pervers, le chaos, la voix de gredin), puis Songs about Fucking (1987), le suivant, culte, avec cette reprise démentielle de Kraftwerk, The Model.
Punk dans l’âme
Sur ma lancée, j’ai mis quelques titres de Rapeman, le groupe qu’il a fondé ensuite et dont il dira plus tard regretter grandement le nom, et enfin tous les Shellac, sauf To All Trains, le nouveau venu, pas encore sorti au moment d’écrire ces lignes. Les journalistes ont toujours l’occasion d’écouter les albums avant qu’ils ne soient disponibles sur le marché, mais ce privilège n’a plus cours lorsque l’on cause de Shellac. Même Emily Pothast, la journaliste du magazine britannique The Wire qui signe la cover story du numéro de juin consacré au groupe, n’a pas pu entendre ce foutu disque, alors qu’elle a eu la chance d’entrevueer le groupe : “Nous n’avons jamais sollicité la presse, donc nous n’envoyons ni copie ni lien d’écoute, tout simplement parce qu’on s’en fout”, assène ainsi Bob Weston, le bassiste.
Je me souviens de la dernière fois que j’ai vu Shellac en concert. Pas plus tard que l’année dernière, à Madrid, dans le cadre du festival Primavera Sound. Le son était massif, stressé, sans répit. Le trio n’était pas venu pour se faire des ami·es mais pour jouer fort. Albini avait ce look éternel à mi-chemin entre l’ado grunge et Jeff Goldblum dans Independence Day, et raillait la programmation reggaeton de la scène au loin, avec ce côté pince-sans-rire qu’on lui connaissait bien.
Le type écrivait dans des fanzines punk-rock dans sa jeunesse, dont l’essentiel Forced Exposure. Il a non seulement l’art des tournures qui font mouche, mais la culture de la confrontation. “Steve Albini était une personne de passions et de contradictions, écrivait Thurston Moore à l’heure de lui rendre hommage. […] Il a très tôt su articuler avec intelligence les raisons de ne pas mettre les pieds dans les rouages indignes et délétères des grandes maisons de disques, tout en parvenant à accepter l’idée que tout coexistait au sein d’un monde absurde. Derrière son air renfrogné, il avait toujours un sourire véritablement touchant.”
Last man standing
Cette image de Shellac au milieu de ce grand raout festivalier, où cohabitent le pire de l’industrie du divertissement et la fine fleur de l’indie, c’est ce dont cause Thurston Moore. C’est comme quand Albini s’amusait à dézinguer les Rolling Stones ou Steely Dan (“Je serai toujours ce genre de punk qui chie sur Steely Dan. Mon Dieu ! Toute cette énergie dépensée pour finir par sonner comme l’orchestre du SNL”, écrivait-il l’année dernière) dans des saillies punitives gratuites, cultivant malgré lui une image de type ronchon. Ce n’était pas du sectarisme, mais de la passion pure ! Une envie d’en découdre qui aura été le moteur de son indépendance absolue et une façon de créer de l’exaltation. Ruban Nielson, éminence grise du groupe Unknown Mortal Orchestra, l’a bien compris : “Merci Steve Albini. Navré d’avoir grandi en aimant aussi Steely Dan.”
Le pote Albini était peut-être le dernier role model de la culture indie globale, celui qui me donnerait presque envie de monter un groupe, même à ça de la quarantaine. Last Man Standing, comme dirait Bruce Springsteen. “On s’efforce juste d’être dans un processus confortable pour nous et de garder autant que possible les choses sous notre contrôle. Le label à qui nous avons affaire est le même depuis le début. On appelle le même type depuis trente ans et c’est ce même type qui nous répond”, confiait Albini à The Wire, dans ce qui pourrait bien être sa toute dernière entrevue.
Je lance Yanqui U.X.O. (2002) de Godspeed You! Black Emperor, cet aperçu grandiose de l’apocalypse mis en son par Steve, puis Rid of Me (1993), l’album qu’il a enregistré avec PJ Harvey.
“Yeah, you’re not rid of me
Yeah, you’re not rid of me
I’ll make you lick my injuries
I’m gonna twist your head off, see.”
Ça, Steve Albini nous l’a bien tordue, la tête.