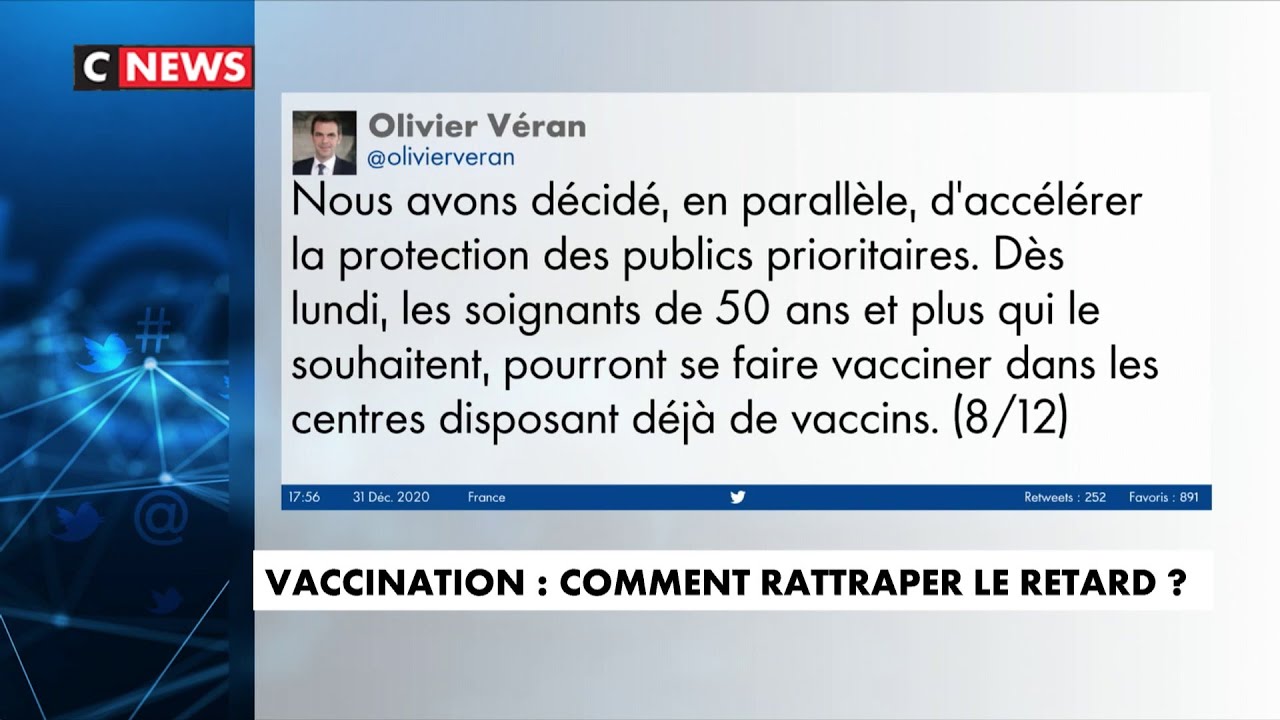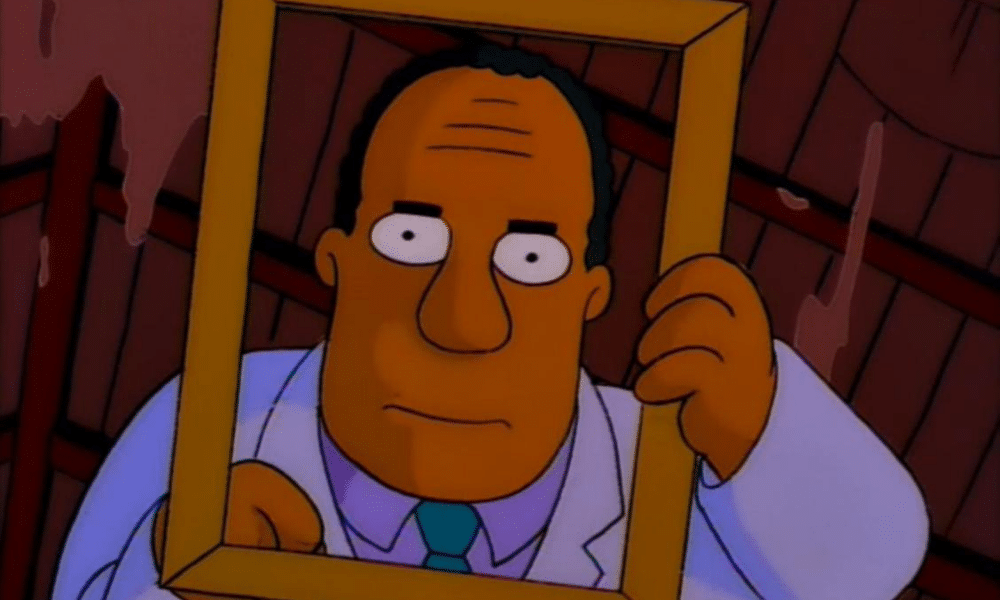Willy Kurant, chef opérateur éclectique et maître de la caméra portée, n’est plus
Lorsqu’un directeur de la photographie s’éteint, il est d’usage de rappeler ce qu’éclairait sa lumière. Né en 1934 à Liège, en Belgique, Willy Kurant faisait partie, à l’instar de Pierre Lhomme ou Raoul Coutard, de cette génération d’opérateurs...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Lorsqu’un directeur de la photographie s’éteint, il est d’usage de rappeler ce qu’éclairait sa lumière. Né en 1934 à Liège, en Belgique, Willy Kurant faisait partie, à l’instar de Pierre Lhomme ou Raoul Coutard, de cette génération d’opérateurs qui ont accompagné et stimulé les bouleversements techniques et esthétiques de la modernité cinématographique du tournant des années 60.
Un parcours peu commun
Contrairement à ces derniers, et notamment en raison de l’absence d’école de cinéma en Belgique à l’époque (l’IAD et l’INSASS ont été créées respectivement en 1959 et 1962), il ne suit pas suivi la voie classique consistant à gravir les échelons d’une équipe de tournage comme assistant caméra. Il se forme d’abord dans un laboratoire photographique spécialisé dans l’analyse comparative des pellicules couleurs. Il en garde d’ailleurs un savoir-faire précieux dans le traitement photochimique de l’image, et quelques techniques iconoclastes (éclairer les comédiens à l’aide de parapluies de photographes ou de papier d’architecte Frost).
Dans le sillage de la Nouvelle Vague
Influencé par les photographes américains de la Grande Dépression (Paul Strand, Dorothea Lange…) et la pratique documentaire de Robert Flaherty et Joris Ivens, il signe l’image de quelques courts-métrages – dont Klinkaart de Paul Meyer, qui obtiendra le 1er prix du Festival d’Anvers en 1956 – avant d’œuvrer comme opérateur d’actualités pour la télévision belge. Il en tire la musculature nécessaire aux prises de vues à l’épaule, l’endurance requise à la captation de plans longs, mais aussi un petit pécule qui lui permet d’acheter sa propre caméra portative, reliée à un enregistreur. De quoi le prédisposer à croiser la route des cinéastes de la Nouvelle Vague, friands de tournages légers en équipes réduites et en décors naturels.
>> A lire aussi : La Nouvelle Vague en 10 films
Après avoir effectué un stage dans les studios de Pinewood grâce à une bourse d’étude du British Council, il s’installe à Paris et fait la connaissance de Marin Karmitz, futur fondateur de la société MK2, et de Jacques Rozier, camarade de promotion à la Fémis. Ce dernier l’embarque sur les tournages de ses courts-métrages Dans le vent (1962) et Roméo et Jupettes (1966).
C’est à cette époque que Willy Kurant croise la route de Maurice Pialat, qui l’embarque à Istanbul pour une série de courts-métrages documentaires dont on lui a passé commande. Envoûtantes et hypnotiques malgré une fascination orientaliste un peu datée, ces Chroniques turques (1963) saisissent l’ébullition d’une ville écartelée entre l’Orient et l’occident, la tradition et la modernité.
Après avoir rencontré Agnès Varda lors d’une émission belge de cinéma, Willy Kurant travaille avec elle sur Les Créatures (1966), fiction insulaire en CinemaScope portée par Catherine Deneuve et Michel Piccoli. Après avoir visionné des rushes du film, Jean-Luc Godard le contacte pour tourner Masculin Féminin, radiographie libre et engagée d’une jeunesse tiraillée entre les idéaux consuméristes et révolutionnaires des années soixante filmée, malgré sa légèreté d’exécution, avec une caméra très lourde.
Charmé par le film, Jerzy Skolimowski en récupère le chef opérateur et les deux acteurs principaux, Jean-Pierre Léaud et Catherine Duport, pour son 1er film tourné hors de Pologne, plus précisément à Bruxelles. Embrassant le passage à l’âge adulte d’un jeune homme passionné de courses automobiles qui cherche par tous les moyens possibles une voiture pour participer à un rallye (et tombe amoureux en cours de route), Le Départ semble conçu à la mesure de Léaud, dont il embrasse le jeu très libre et la corporalité éruptive.
Dans les Cahiers du Cinéma, Serge Daney célèbre le cinéaste comme un homme qui dit : « Voilà un personnage, si je le filme de loin, c’est de la comédie musicale, de plus près, c’est du mélodrame, d’encore plus près, c’est du cinéma-vérité ». La singularité du film doit beaucoup à l’apport de Willy Kurant, qui a su composer avec les contraintes du tournage pour nouer un véritable corps à corps sportif avec le comédien. Il y expérimente également un développement de la pellicule plus long que de coutume pour obtenir des noirs et blancs très contrastés (le film, d’ailleurs, s’achève sur une pellicule brûlée).
>> A lire aussi : Maurice Pialat aura le droit à une rétrospective cet été
Dans les années 80, Kurant tourne quelques séquences d’A nos amours avant de retrouver Pialat pour Sous le soleil de Satan. Cette œuvre formaliste et habitée sortie en 1987 met en scène Gérard Depardieu parfois plongé dans une nuit américaine (c’est-à-dire tournée de jour et retravaillée en post-production, comme dans les productions classiques), technique qu’il a déjà expérimentée sur le visage de Marlon Brando dans La Nuit du lendemain d’Hubert Cornfield et Richard Boone (1968).
Un coloriste inspiré
Si le chef opérateur reste associé à une pratique instinctive et débrouillarde à même d’investir des projets économes nécessitant une certaine rapidité d’exécution, celui qui se disait marqué par « le ciel bleu métallique, les nuages noirs, le contraste très élevé » de sa Belgique natale s’est également révélé un coloriste inspiré et un formaliste en puissance, maniant les teintes primaires comme un aquarelliste.
Sortie en 1967, la comédie musicale Anna de Pierre Koralnik semble nouer le classicisme et la Nouvelle Vague au service d’une modernité pop, donc les prémices étaient déjà visibles dans Masculin féminin et Le Départ (les inserts sur des affiches publicitaires, notamment). Sa bande originale signée par Serge Gainsbourg a, semble-t-il, anticipé la collaboration au long cours entre le chef opérateur et le musicien – cinéaste, qui œuvrent ensemble sur Je t’aime, moi non plus (1976), Equateur (1983) et Charlotte Forever (1986).
Dans l’ombre et à la lumière du Welles tardif
Après avoir signé l’image d’Au pan coupé de Guy Gilles et Michael Kohlaas de Wolker Schlöndorff (tous deux sortis en 1968), Kurant croise le chemin d’Orson Welles, démiurge en exil qui se démène pour monter ses projets et s’initie enfin à la couleur. Après l’échec de The Deep, thriller maritime resté inachevé, les deux hommes tournent Une histoire immortelle pour la télévision française.
>> A lire aussi : Jeanne Moreau, une star immortelle
Tiré d’une nouvelle de Karen Blixen, ce métrage onirique et érotique met en scène un homme d’affaires vieillissant (interprété par Welles) décidé à donner corps à une vieille légende de marins en provoquant l’union sexuelle de deux jeunes inconnus. Nimbé dans une gamme de couleurs vibrantes, on en retient notamment des plans stupéfiants de beauté sur le personnage de Jeanne Moreau, saisie entre deux bougies ou des voilages blancs. Hélas, l’Héroïne, conçu comme une suite de l’Histoire immortelle, ne voit jamais le jour.
Expériences américaines et retour en France
Après avoir officié sur Live at Pompeii, le concert culte et sans public de Pink Floyd dans les ruines de la cité antique, Willy Kurant s’exile aux États-Unis, où il tourne notamment des productions Roger Corman, qu’il signe sous le pseudonyme Willy Curtis.
Le crépuscule de sa carrière se noue à deux longs-métrages de Philippe Garrel qui semblent synthétiser sa patte stylistique, la nervosité de la caméra portée en moins : Un été brûlant et ses couleurs chatoyantes en 2011, et le noir et blanc charbonneux et contrasté de La Jalousie en 2013.











![Un Si Grand Soleil en avance : résumé de l’épisode du mardi 26 janvier 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img4.acsta.net/newsv7/21/01/25/11/48/1143812.jpg?#)

![Demain nous appartient : ce qui vous attend dans l'épisode 863 du mardi 16 février 2021 [SPOILERS]](http://fr.web.img5.acsta.net/newsv7/21/02/15/16/35/5051210.jpg?#)







![Plus belle la vie en avance : résumé de l'épisode du lundi 17 octobre 2022 [SPOILERS]](http://fr.web.img3.acsta.net/newsv7/22/10/13/11/50/1856008.jpg?#)