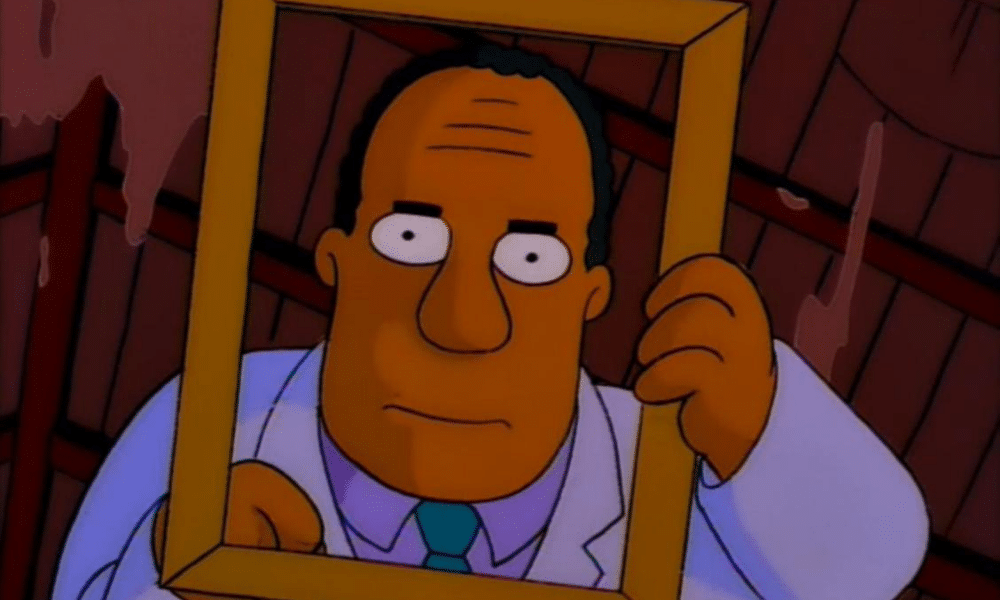“Zack Snyder’s Justice League” vs “Wonder Woman 1984” : la guerre est déclarée
Pour les critiques cosmiques chargé·es de suivre l’évolution des différents univers (DC, Marvel, MonsterVerse, etc.), l’échec de Justice League et la sortie conjointe du 1er Wonder Woman en 2017 marquent une étape cruciale. Quelque chose comme...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Tu penses avoir un don pour la rédaction ?
Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.
Pour les critiques cosmiques chargé·es de suivre l’évolution des différents univers (DC, Marvel, MonsterVerse, etc.), l’échec de Justice League et la sortie conjointe du 1er Wonder Woman en 2017 marquent une étape cruciale. Quelque chose comme un glissement tectonique des plaques. Ou une supernova. Jusqu’alors, en effet, l’univers DC s’était construit à partir d’une seule brique ADN – la note sombre, viriliste, de Christopher Nolan puis de Zack Snyder.
Et d’un seul coup, la réalisatrice Patty Jenkins et l’actrice Gal Gadot ont fait basculer ce monde sévère dans un grand bain radieux de femmes et de couleurs. A leur suite, et pendant quelques années, les films DC ont ouvert grand les vannes de la polychromie queer (Aquaman, Shazam!, Birds of Prey). Et on a cru un temps que ce serait pour toujours.
Mais la réception internationale mitigée de Wonder Woman 1984 et l’extraordinaire hype entourant, à l’inverse, la sortie de la Snyder Cut de Justice League semblent indiquer un retournement possible des cartes. Comme en France les deux productions arrivent en même temps, la confrontation est encore plus nette. Alors, Snyder/Jenkins, le rematch quatre ans après, quels sont les arguments ? Et doit-on vraiment s’attendre au début d’une nouvelle ère glaciaire chez les super-héros·oïnes ?
La coupe de l’auteur
Côté Snyder, tout le monde sur les réseaux a l’air bien convaincu que ce nouveau montage change absolument la donne et transforme le flop de 2017 en Grand Œuvre tragique. A l’époque, on s’en souvient peut-être, Snyder avait dû abandonner la postproduction pour des raisons personnelles et les studios avaient engagé Joss Whedon pour faire des reshoots et remonter entièrement le film. Depuis lors, les fans n’avaient pas lâché l’affaire, réclamant à corps et à tweets de voir Justice League dans sa forme originale. Aujourd’hui, ces mêmes fans se réjouissent presque autant du film que d’avoir eu gain de cause contre toute attente. Difficile de ne pas soutenir jusqu’au bout ce qu’on a pratiquement contribué à produire.

D’autant plus que, chose remarquable, cette vox populi soutient la voix singulière d’un auteur. Depuis le début, c’est la vision non entravée d’un artiste que réclame la masse et non pas sa bête satisfaction. Certain·es n’hésitent pas ainsi à formuler un espoir – cette nouvelle coupe, ne serait-ce pas la pièce manquante, ce “blockbuster d’auteur” qui pourrait renverser la mauvaise réputation des productions numériques ?
Après la Snyder Cut, veut-on croire, Martin Scorsese ne pourra plus assener, comme il le fit en 2019, que les films de super-héros ne sont pas du cinéma mais des “parcs d’attraction” tout juste bons à étourdir leur public puisque le public lui-même se bat pour l’indépendance de l’artiste ! Qu’importe dès lors que l’opus soit réussi ou non, il est impératif de le défendre puisqu’il incarne en soi tout le prestige du genre.
Cette nouvelle mouture enfin a été sérieusement upgradée. Si la pandémie de Covid avait contraint Wonder Woman 1984 à une sortie hybride, assez précipitée, à la fois en salle et sur HBO Max, la Zack Snyder’s Justice League est clairement pensée pour le service de SVOD de la Warner. Elle peut être regardée en une fois ou en six chapitres. Loin d’être une vieille chose rapiécée des années 1910, elle apparaît plutôt comme le 1er blockbuster de l’ère des streamers. Même son ratio étrange (4:3, un format presque carré, prévu pour IMAX) lui donne un cachet distinctif, pictural, quand on visionne le film sur son portable.
Supériorité des cyborgs
La Snyder Cut ressemble ainsi beaucoup à l’un de ses personnages principaux – Victor Stone aka Cyborg. Champion de football américain, Victor “meurt” avec sa mère dans un accident de voiture, mais son scientifique de père le ressuscite sous forme d’androïde grâce à un peu de technologie extraterrestre. Furieux contre cette décision paternelle et sa nouvelle physiologie, il met un certain temps à accepter sa monstruosité. A la percevoir comme une opportunité et non comme un handicap.

Son arc narratif, avec sa bascule progressive, avait été pas mal sacrifié dans la version de Whedon. Il retrouve ici toute son ampleur. Quand Cyborg écoute, à la fin du film, un message audio laissé par son géniteur qui se réjouit d’avoir été “deux fois son père” (“A Father Twice Over”, titre de l’épilogue), pas besoin d’être super-malin pour comprendre le sous-texte. Snyder lui aussi est fier de son blockbuster cyborg – mort en 2017 et ressuscité aujourd’hui sous une autre forme.
Something darker
Hourra donc pour les films morts-vivants et le cinéma d’auteur à effets spéciaux ? Hélas, la réalité n’est pas aussi simple. Il existe, il est vrai, dans Zach Snyder’s Justice League des moments, assez précieux, d’intensité plastique et musicale. Et il arrive que l’on soit ponctuellement surpris, ravi même, de suivre un très lent accident de voiture au son de Song to the Siren. Ou de voir s’effacer Jason Momoa au bout d’une jetée, pris entre deux vagues, comme dans une vidéo contemplative de Bill Viola.
Mais ces rares éclats ne permettent pas vraiment de sauver l’ensemble. Non seulement parce que, sur le fond, l’histoire racontée est toujours la même (après la “mort” de Superman, Batman réunit une troupe hétérogène de super-héros·oïnes pour empêcher une invasion d’aliens) – et soit dit en passant il est à craindre que ce script seul suffise à rebuter Scorsese.
Mais surtout parce que les productions Zach Snyder souffrent toujours du même défaut : elles ne connaissent que la noirceur machiste comme unique point de vue. C’était le problème dans Man of Steel (2013), qui transformait déjà Superman en bloc de testostérone tombé du ciel. Et ça l’est encore huit ans plus tard dans la Justice League #21 qui promeut une version noire (littéralement) du même super-héros. Coincés entre un Batman plus massif que jamais et un Black Superman tout aussi taiseux, il n’est pas facile d’exister pour les autres personnages. Et en particulier pour les femmes, condamnées à n’être que des veuves éplorées, mères et épouses, ou des guerrières aussi dures que leurs modèles masculins.

De fait, dans cette nouvelle coupe, comme dans le reste de sa filmographie, Zach Snyder n’est vraiment à son meilleur que dans de brèves scènes de cauchemar où il peut racler le fond du sombre pendant quelques minutes (dans Man of Steel, le héros s’enfonçait tout de même dans un champ de crânes !). Mais ces courts délires oniriques ne suffisent pas à sortir le monde snyderien de sa terrible monotonie – du noir au plus noir, et inversement.
Arabesque amazone
Et c’est justement cet élément inespéré de pluralité versicolore que Patty Jenkins apportait sur un plateau, en 2017, à l’univers DC. Et c’est de nouveau cette même contrepartie que promeut Wonder Woman 1984. Attention cependant : il ne s’agit pas seulement d’applaudir la nouvelle explosion chromatique. Même si elle est poussée ici à son paroxysme à la fois par le choix d’époque (ah la mode des années 1980 !) et de scènes joyeusement gratuites (Gal Gadot et Chris Pine dans un jet invisible traversant, pour le fun, un feu d’artifice). Mais il faut aussi noter, au-delà de la cinématographie arc-en-ciel, tout ce que Jenkins et Gadot ont réussi à modifier, en profondeur, dans les films de super-héros·oïnes – et en particulier dans les séquences de combat.
De ce point de vue, rien de plus éclairant que de comparer la façon dont Wonder Gadot se bat dans Justice League et dans Wonder Woman 1984. Côté Snyder donc, une brutalité mécanique et sanglante qui ne la distingue en rien des autres combattants. Côté Jenkins, en revanche, tout est souplesse et glissade, changement de vitesse et rotation. Les combats de Wonder Woman 1984 tiennent du cirque et de l’acrobatie. Et ils s’articulent entièrement autour du lasso. Le lasso leur donne à la fois leur principe gymnique (la courbe, l’arabesque lumineuse) et leur principe moral. De fait, le “lasso de vérité” n’est pas une arme létale. C’est même à peine une arme. Plutôt un lien entre les gens.

En revanche, WW bloque toutes les balles et détruit les pistolets. Quand elle arrache le volant d’un camion, l’héroïne s’adresse au chauffeur dans sa langue pour lui préciser qu’il n’a pas à s’inquiéter, que les freins de son véhicule continuent de fonctionner. Si l’on poussait un peu, on dirait qu’elle introduit le soin dans la lutte, le care dans l’ultimate fighting.
Wonder ou Wanda
Il faut bien admettre pourtant que ce second épisode déçoit aussi. De façon assez banale, il souffre du problème récurrent des sequels qui consiste à refaire la même chose que la 1ère fois simplement en plus lourd et en plus coûteux (toute la séquence inaugurale sur l’île de Themyscira, cette fois très ratée). Plus profondément, il montre aussi les limites du couple Jenkins/Gadot et leur difficulté à intégrer de nouvelles individualités.
On attendait beaucoup de l’inclusion (imprévue) de la géniale Kristen Wiig dans l’univers super-héroïque. Et le résultat n’est pas hélas à la hauteur des attentes. Jenkins, qui a l’œil pour la souplesse musculeuse de Gadot, ne sait pas quoi faire du corps sec et burlesque de Wiig. Rapidement remplacée par son pâle avatar numérique (la vilaine Cheetah), elle affronte Wonder Woman dans un duel final sans saveur.
A lire aussi : Avec “WandaVision”, Disney invente le sitcom Marvel
Le film partait pourtant d’une belle idée scénaristique. Un chef d’affaire frauduleux, Maxwell Lord, acquiert une pierre magique qui lui donne la possibilité de satisfaire tous les vœux de ses interlocuteur·trices en retour d’une contrepartie cachée. C’est grâce à cette même pierre que Wonder Woman obtient de faire ressurgir des morts son grand amour, Steve Trevor, perdu au 1er épisode, pendant la Première Guerre mondiale. Pour le garder en vie, ne serait-ce que de façon illusoire, elle doit néanmoins accepter de perdre ses super-pouvoirs, ce qui l’empêche – malheur ! – de sauver la Terre du désastre.
Le plus étonnant dans ce script est sa proximité troublante avec celui de WandaVision, la 1ère série lancée par Marvel sur Disney+ en début d’année. Dans WandaVision, en effet, Wanda Maximoff crée une bulle imaginaire pour ressusciter son amour perdu, le synthézoïde Vision, quitte à asservir tout un village pour parfaire l’image trompeuse du bonheur familial. De façon concurrente, donc, chez Marvel comme chez DC, deux super-héroïnes réinventent le travail de deuil au prisme des effets spéciaux. Et on y verrait bien un signe pour l’avenir du genre numérique – peut-être qu’il est temps de dire adieu au Super Mâle ?
Hélas, la comparaison entre Wonder et Wanda laisse peu de chance à la 1ère. Sans doute parce que la forme sérielle permet plus de subtilité sur ce type de sujet que le bloc unique du blockbuster. Sans doute aussi parce que Elizabeth Olsen est une actrice plus fine et émouvante que Gal Gadot, athlète irréprochable mais tragédienne plus limitée.
Le cas Snyder
Alors, Snyder/Jenkins, qui sort vainqueur du second round ? Personne a priori, du moins de façon simple et évidente. Il est certain que la Snyder Cut marque un retour du péplum obscur sur nos écrans – même si son triomphe est surtout poussé par les fans. Mais Wonder et Wanda montrent de façon tout aussi déterminée que le temps glacial, exclusif de l’hétéro-normativité dans le film de super-héros est derrière nous.
Dès lors, il faut sans doute envisager le genre, dans sa totalité, oscillant entre ces tensions contradictoires durant les prochaines années. Après tout, si l’on pense que les blockbusters numériques sont, comme les opéras de la fin du XIXe, des œuvres d’art total aimantées par l’esprit du temps, il ne faut pas trop s’étonner d’y retrouver ce type de débat électrique et d’affrontement non résolu.
Dans Le Cas Wagner en 1888, Nietzsche opposait ainsi à la lourdeur teutonique de Wagner l’attrait solaire, méditerranéen, de Bizet. Au charme capiteux de la “mélodie continue” du maître allemand, il préférait les airs précis et structurés du musicien français. Car ce qui est bon est léger, disait le philosophe. Et tout ce qui est divin marche d’un pied délicat. Disons donc que la Snyder Cut est notre Ring [Der Ring des Nibelungen, un cycle de quatre opéras] et Wonder Woman, notre Carmen.
Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, avec Gal Gadot, Chris Pine et Kristen Wiig (E.-U., G.-B., Esp., 2020, 2 h 31). En VOD le 7 avril
Zack Snyder’s Justice League de Zack Snyder, avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot (G.-B., E.-U., 2021, 4 h 02). En VOD